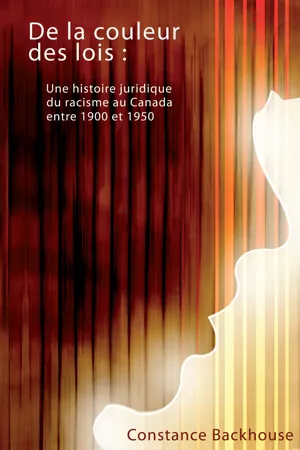![]()
I
Introduction
Nous sommes en 1901, à la veille du premier recensement réalisé pour le Canada au XXe siècle. Le gouvernement fédéral vient de distribuer à ses fonctionnaires chargés de sonder la nation un ensemble bien ordonné et succinct d’instructions dont voici un extrait : [TRADUCTION] « Les différentes races humaines doivent être désignées au moyen des lettres suivantes : “b” pour Blanc, “r” pour Rouge, “n” pour Noir et “j” pour Jaune. » Il manquait la couleur brune, qui était parfois associée à la race, mais qui aurait pu semer la confusion entre les différentes catégories puisqu’il y avait déjà une race désignée par un « b ». Ce qui ressort clairement de ces instructions, c’est que la couleur et la race, deux conceptions jumelles, étaient indissociablement liées.
Advenant que les recenseurs fussent incapables d’établir immédiatement les distinctions de couleur lors de leurs démarches de porte à porte, ils devaient suivre les instructions que voici :
[TRADUCTION] Les Blancs sont, bien entendu, les gens de la race caucasienne, tandis que les Rouges désignent les Amérindiens, les Noirs désignent les Africains ou les Nègres et les Jaunes sont les Mongols (Japonais et Chinois). Cependant, seuls les Blancs de race pure seront classés dans la catégorie des Blancs ; les enfants issus d’un mariage entre un Blanc et toute personne d’une autre race seront classés comme des Rouges, des Noirs ou des Jaunes, selon le cas, et ce, peu importe l’intensité de la couleur de leur teint de peau1.
Blanc, Rouge, Noir et Jaune. Bien entendu. La locution prépositive est curieusement placée juste après les trois premiers mots d’ouverture. Faut-il donc en déduire que la race est universellement identifiée par la couleur ? Hormis pour ceux qui ont franchi la barrière des couleurs et seront appelés à recevoir une identification raciale déterminée « selon le cas » ? Que la couleur est un état irrévocable, sauf lorsqu’il est question de « pureté » et d’ « intensité » ? Qu’une touche de couleur autre que le blanc immaculé « teinte » le classement par la couleur au-delà de toute discussion ? La préséance accordée à la race blanche se manifeste de multiples manières à l’époque et ressort clairement de l’ordre de ces listes où la race blanche occupe la première place. On reconnaît en outre cette prédominance à l’emploi de l’adjectif « pure », dans la mesure où il est uniquement réservé à la race blanche. Les couleurs « rouge », « noire » et « jaune » désignent non seulement leurs pigmentations intrinsèques, mais englobent également toutes les variantes découlant de ces tons de peau.
Le barème de couleurs primaires choisi par les représentants du gouvernement, avec ses coups de pinceau de rouge et de jaune francs, était un choix curieux. La palette visée pour le recensement s’étend au-delà de ces teintes vives jusqu’aux limites de la gamme des couleurs. Elle déborde littéralement du spectre jusqu’aux tons de noir, lesquels représentent l’absorption de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel, tandis que les tons de blanc n’absorbent aucune couleur. Comme la plupart des observateurs l’auraient sans doute admis si on les y avait exhortés, ces catégories sont des plus inexactes dans la mesure où aucun être humain ne naît affublé de couleurs aussi nettes et primaires.
Et pourtant, la désignation raciale au moyen de la couleur était omniprésente en ce début du XXe siècle au Canada. Qu’il s’agisse des romanciers, des poètes, des politiciens, des commentateurs ou des historiens, tous décrivaient couramment les peuples racialisés en termes de teintes selon la palette de couleurs déterminée par les responsables du recensement. Malgré le caractère artificiel inhérent à une classification des gens à l’aide de couleurs n’ayant qu’une très vague ressemblance avec leur véritable teinte de peau, le recensement suivit son cours sans faire de vagues. En 1901, les registres officiels créés à partir du recensement dépeignent donc la composition raciale du Canada selon une gamme de couleurs de teintes vives, quoique inégale. Les Blancs constituent la vaste majorité de la population officielle avec un pourcentage de 96,2. Les Rouges représentent 2,4, les Jaunes 0,41 et les Noirs 0,32 pour cent. Les quelques personnes que les recenseurs sont incapables de cataloguer avec certitude sont désignées comme des gens « d’origines diverses » et de race « indéterminée », représentant un total de 0,66 pour cent2.
Un demi-siècle plus tard, les questions de race et de couleur seront décrites de manière beaucoup plus nuancée ; on cessera de se référer à la palette de couleurs franches que sont le blanc, le rouge, le noir et le jaune. Les recenseurs avaient pour instruction de poser aux gens des questions sur leur « origine ». Dans le rapport du recensement de 1951, on concède que les résultats d’un sondage de cette nature révèlent des renseignements qui tiennent « en partie de la culture, de la biologie et de la géographie ». Dans le rapport, on reconnaît que les méthodes de classification ont changé au fil du temps en ajoutant, pour rassurer la population canadienne, que les objectifs généraux du recensement, eux, sont demeurés les mêmes :
[TRADUCTION] Au cours du passé, le terme « origine » a été, dans la terminologie propre aux recensements, différemment qualifié par des attributs tels que « raciale » et « ethnique », mais le but de cette enquête est demeuré essentiellement le même. Il s’agit, en bref, de s’efforcer de distinguer les groupes qui, au sein de la population, ont des caractéristiques culturelles semblables, fondées sur un héritage commun3.
Et les données du recensement demeurèrent en majeure partie identiques. Les personnes « d’origine européenne », qu’on nommait anciennement les « Blancs », représentent 96,95 pour cent de la population canadienne. Ceux et celles qui décrivent leurs origines comme étant « Autochtones et Esquimaux » totalisent 1,18 pour cent. Les personnes d’origine asiatique, désormais décrites comme des « Chinois », des « Japonais » et « autres Asiatiques », représentent 0,52 pour cent. Les « Noirs » constituent 0,13 pour cent. Le seul groupe de non-Blancs dont le nombre s’est accru pendant la première moitié du siècle, décrit de manière indéfinie comme « autre origine et pas de réponse », totalise 1,22 pour cent. Dans leur tentative pour expliquer cette augmentation, on peut lire dans le rapport du recensement que ce groupe comprend [TRADUCTION] « les personnes ayant déclaré qu’en raison de leur ascendance mixte ou pour d’autres motifs, elles ignoraient à quel groupe d’origine elles appartenaient ». Le rapport poursuit en annonçant qu’il [TRADUCTION] « faudra s’attendre à ce que ce problème gagne en importance4… ».
LA NOUVELLE DÉFINITION DU CONCEPT DE « RACE »
ET LA CONSTANCE HISTORIQUE DU « RACISME »
La signification du mot « race » a profondément changé au cours des derniers siècles. Ce concept, dont l’origine remonte aussi loin que le siècle des lumières, avait au début pour objectif de marquer les différences de classes au sein de la société européenne. Au cours des XVIIIe et XIXe siècles, lorsque des empires furent créés aux quatre coins du globe, les Européens commencèrent à exploiter l’idée de « race » comme justification commode au droit qu’ils s’étaient arrogé de dominer les peuples « primitifs », bâtissant ainsi les assises des hiérarchies coloniales qu’ils étaient en train d’instaurer. Avec l’essor de la « science » surgie dans la foulée de la Révolution industrielle, les nouvelles disciplines telles que l’ethnologie, l’anthropologie, l’eugénisme, la psychologie et la sociologie servirent d’adjuvants « professionnels » pour favoriser la réalisation de cet objectif.
Bon nombre de scientifiques, de diverses disciplines, tous blancs, entreprirent la tâche complexe consistant à définir des catégories « raciales » et à extrapoler, à partir des données sur les « races », les multiples distinctions entre les êtres humains. La pigmentation de la peau n’était qu’un facteur parmi d’autres dans la longue liste des variables humaines énumérées ; on retrouvait également la stature, la forme de la tête, la capacité crânienne, la couleur et la texture des cheveux, la forme des yeux, l’indice nasal et diverses autres caractéristiques faciales. Et pourtant, aucun de ces aspects du physique humain n’est en soi intrinsèquement si manifeste qu’il justifie qu’on en fasse une catégorie à part. On peut même s’étonner qu’ils ne soient pas allés jusqu’à diviser les êtres humains en races caractérisées par des grandes oreilles et celles qui en ont des petites. Cependant, malgré la multitude des caractéristiques physiques servant à fixer les classifications raciales, certains cas demeuraient inclassables. Certains individus qui avaient « l’air » d’être de race blanche disaient appartenir à des groupes victimes d’oppression raciale ou étaient classés comme tels par d’autres personnes. Afin de remédier à ces incohérences, on avait ajouté à la liste des éléments d’identification « raciale », les caractéristiques telles que la langue, la religion, la résidence géographique, la manière de se vêtir, les habitudes alimentaires, l’intelligence, la réputation et le nom5.
La classification raciale fonctionnait comme un prétexte facile, à portée de main, pour nombre de groupes disparates qui cherchaient à justifier le fait qu’ils détiennent davantage de ressources, de pouvoir et un statut supérieur par rapport aux autres. On sait à quel point l’adoption de la notion de « race » a permis de justifier l’esclavage des Noirs. Il est tout aussi manifeste que l’idéologie « raciale » a servi de prétexte pour s’emparer des terres des Premières Nations. Le concept de « race » a servi d’explication définitive pour infliger un traitement punitif aux immigrants d’origine asiatique à la fin du XIXe siècle. La terminologie « raciale » a également été employée afin de rationaliser le phénomène de l’exploitation entre Blancs eux-mêmes. Des distinctions « raciales » ont historiquement été établies entre les communautés saxonne, celte, normande, irlandaise, écossaise et anglaise. En Amérique du Nord, on réfutait facilement les revendications d’appartenance à la race blanche présentées par les immigrants en provenance d’Europe du Sud et de l’Est, de Syrie, d’Arménie, d’Arabie, d’Inde et des Philippines. Le traitement discriminatoire réservé aux Franco-Canadiens, aux personnes affiliées à des religions autres que le protestantisme ainsi qu’aux groupes d’immigrants en provenance de l’Europe du Sud et de l’Est a également été idéologiquement rattaché aux notions de « race »6.
Les historiens spécialisés dans l’étude des théories intellectuelles entourant le concept de « race » ont soutenu que les revirements majeurs dans la façon de penser sont survenus durant la première moitié du XXe siècle. Selon leurs recherches, la communauté scientifique blanche aurait atteint, au cours de ces deux premières décennies, une sorte d’apogée dans l’évaluation, la quantification et la description des distinctions physiques existant entre les « races ». Dans les années 1930, une nouvelle génération d’anthropologues entreprit de déconstruire la pyramide de connaissances précédemment édifiée en vue de parvenir à un ensemble de données et de conclusions uniformes.
Ces scientifiques de la nouvelle mouture avancèrent l’idée que les distinctions raciales manquaient d’une structure définie. Bien qu’ils ne reniassent pas complètement l’existence des races, ils introduisirent le concept d’ « ethnicité » en soutenant qu’il était plus aisé d’expliquer les différences humaines à l’aide de facteurs sociaux, politiques, économiques et géographiques que par la biologie uniquement. On peut observer un revirement dans le mode de pensée à la lecture du recensement canadien de 1951, où les références à la « culture » et à la « géographie » sont combinées à celles de la « biologie » à titre de caractéristiques définissant l’organisation humaine. Comme le rapport du recensement de 1951 le souligne, cependant, le changement est davantage de nature sémantique que substantive. La croyance voulant que l’humanité soit répartie en groupes distincts et qu’il est possible de différencier ces groupes au moyen de caractéristiques précises demeure, on le constate, inébranlable7.
À la fin des années 1930 et au début des années 1940, on admet en général que la théorie des races atteint son apogée avec la philosophie « arienne » de la race supérieure sur laquelle se fonde le nazisme prôné par Hitler. Avec un retard notable, les forces alliées ont fini par reconnaître certaines des conséquences atroces de la discrimination raciale. Sous l’égide des Nations unies, organisation créée à la fin des années 1940, les gouvernements des pays occidentaux adoptèrent un ensemble de politiques affirmant leur intention d’éliminer la discrimination fondée sur la race. Mais encore une fois, cette réforme fut de nature plus théorique que pratique. La plupart des actes de discrimination raciale demeurèrent impunis, la seule différence étant qu’il n’était plus de bon ton de passer pour un raciste8.
Est-il possible de parler d’histoire « raciale » compte tenu de la nature fugace de la « race » ?
L’étude du concept de la « race » à travers le temps illustre, au-delà de la controverse, que la notion même a été édifiée sur des sables mouvants. La nature éphémère et changeante de la « race » ne nous paraît jamais aussi manifeste que lorsqu’on l’examine avec le passé pour toile de fond. S’ensuit-il pour autant que toute enquête menée sur l’histoire « raciale » est vouée à l’échec dès le début ? Étant donné le caractère artificiel des désignations raciales, peut-on quand même se permettre d’étudier les répercussions historiques de la notion de « race » ? D’aucuns soutiennent qu’il est quasiment impossible, pour ces raisons, de procéder à des évaluations crédibles au sujet de l’ampleur du racisme à travers l’histoire et qu’il faudrait rejeter tout débat concernant les catégories raciales. Cette attitude radicale serait, à mon avis, la plus grave des erreurs. La « race » est une conception mythique, ce qui n’est pas le cas du « racisme ».
L’histoire canadienne se fonde sur les distinctions, hypothèses, lois et mesures de nature raciale, aussi fictif le concept de « race » puisse-t-il être. En omettant de scruter avec rigueur les registres de notre passé pour en extraire les principes profondément enracinés de l’idéologie et de la pratique racistes, on en viendrait à abonder dans les sens de la méprise répandue au Canada selon laquelle notre pays ne saurait vraiment être accusé d’avoir exercé une exploitation raciale systémique, alors que rien ne saurait être plus manifestement erroné.
Des termes tels que « Blanc », « Esquimau », « Indien », « Chinois », etc., posent bien entendu problème dans l’optique de la construction sociale et précaire, sur le plan historique, du concept de « race ». Malgré la nature artificielle de cette terminologie, cependant, de telles désignations raciales étaient communément employées au Canada au cours de la première moitié du XXe siècle. Qui plus est, les concepts de race avaient des retombées importantes sur les plans économique, social et politique pour les personnes qui établissaient ces distinctions. Explorer les significations rattachées à ces désignations raciales fait donc partie intégrante de la tâche dévolue à l’historien des races.
Tout au long de cette période, ce qui ressort avec la plus grande constance, c’est l’hypothèse prédominante selon laquelle, quelle que fût la manière dont on la décrivait, la définissait ou l’utilisait, la race constituait un attribut distinct qui permettait de différencier les êtres humains. Face aux classifications arbitraires et aux théories intellectuelles susceptibles de fluctuer de façon radicale, la vaste majorité des observateurs provenant des milieux universitaire, gouvernemental, juridique, de la presse et du grand public demeuraient inébranlables. Ils refusaient de revenir sur leur sentiment que les distinctions raciales constituaient un fait avéré. Les textes de doctrine influents continuaient de dépeindre les races en termes de couleurs « noire », « rouge » et « jaune » jusqu’au milieu des années 1960 et au début des années 1970. Lorsqu’on poussait les gens à définir la manière dont ils concevaient la race, il leur arrivait de rester embourbé dans des paroxysmes de confusion. Mais tout un chacun était convaincu de savoir reconnaître, « instinctivement », une race aussitôt qu’il en rencontrait une9.
Les Canadiens étaient fermement persuadés que la race était, quelle que fussent les différentes raisons qui les poussaient à le croire, une classification valable et fondée. Il arrivait que certains groupes se déplacent d’une communauté raciale à une autre, en fonction de différents facteurs tels que la classe sociale, le lieu géographique, la langue, le comportement, la culture ou les caractéristiques physiques. Les groupements raciaux pouvaient évoluer et changer au fil du temps. À la fin de cette période, certains commencèrent à parler des « origines » plutôt que de « race » ou de « couleur ». Ce qui demeurait cependant constant, c’est l’emploi de la notion de « race » à titre de caractéristique pour différencier les peuples. Et le « racisme » – soit l’utilisation de catégories raciales en vue de créer, d’expliquer et de perpétuer les inégalités – demeurait de façon récurrente statique. L’omniprésence du racisme justifie en soit que l’on mène des recherches sur les questions raciales, aussi terriblement vides de sens ces catégories raciales fussent-elles.
DÉFINITION DES TERMES « RACE » ET « RACISME »
Les termes que j’ai choisis pour décrire les différents groupes racialisés cités dans ces causes...