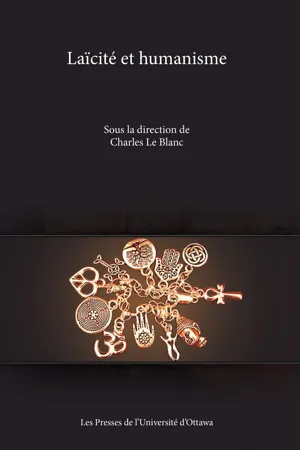![]()
Laïcité et identité
Thomas De Koninck
Le préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 s’ouvre par la constatation que « la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ». C’est ce qu’il convient d’appeler dignité ontologique, puisqu’il s’agit du constat que tout être humain, quel qu’il soit, possède une égale dignité, de par son être même.
Aussi, le cinquième « Considérant » ayant proclamé à nouveau la foi des peuples des Nations Unies « dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des hommes et des femmes », l’article premier précise que « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ». L’article 3 affirme que « tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne » ; l’article 5 : « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » ; l’article 7 : « Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi 1. » Et ainsi de suite. La liste des droits et libertés énumérés jusqu’à l’article 30 comme découlant de la simple « reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine » est, à la vérité, impressionnante.
L’accent que met l’article 3 sur le droit à la vie, comme étant le plus fondamental – que présupposent, par la force des choses, et le droit à la liberté et le droit à la sûreté de sa personne –, s’avère particulièrement significatif. On l’aura remarqué, il anticipe, dans les termes mêmes et dans leur ordre, l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui se lit : « Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. » Ce droit à la vie est la condition sine qua non de tous les autres droits fondamentaux, y inclus la liberté elle-même, pour la raison évidente qu’enlever la vie à quelqu’un c’est supprimer sa liberté, alors que l’inverse n’est pas vrai. Il n’empêche qu’entre tous les autres droits, c’est le droit à la liberté auquel on reconnaît l’absolue priorité.
Or c’est ce droit prioritaire à la liberté qui met en lumière le caractère nécessaire de la laïcité de l’État, mais aussi ce en quoi elle doit consister et ce qui doit l’inspirer. Aussi l’exposé qui suit se découpera-t-il en quatre étapes : 1) le droit à la liberté ; 2) la liberté la plus exigeante ; 3) la laïcité contre le laïcisme ; 4) l’identité humaine.
1. Le droit à la liberté
Cette priorité du droit à la liberté ne doit pas étonner. Déjà selon Dante, « le plus grand don que Dieu dans sa largesse fit en créant, le plus conforme à sa bonté, celui auquel il accorde le plus de prix, fut la liberté de la volonté : les créatures intelligentes, toutes et elles seules, en furent et en sont dotées 2 ». La liberté, en bref, résumerait l’essentiel en ce qui nous concerne, ses deux composantes principales étant l’intelligence et la volonté, toutes deux immenses, comme nous le révèle d’ailleurs l’expérience interne de penser et de vouloir.
On retrouve pratiquement ces deux composantes dans la définition qui « domine toute l’histoire de la notion de personne » (Paul Ladrière), celle de Boèce (environ 480 à 525 de notre ère) : « substance individuelle de nature raisonnable 3 ». La manière à la fois la plus simple et la plus accessible de voir ce lien entre les notions de personne et de liberté, c’est la notion de causalité telle que reflétée dans le langage ordinaire d’abord. Le mot grec aitia, « cause », a pour premier sens celui de « responsabilité », d’« imputation » comme dans une accusation ; le mot latin causa connaît une évolution analogue, et désigne d’emblée un procès : les mots accuser, excuser, récuser en portent encore les traces. Si je vous traîne en justice pour vous faire un procès, c’est que je vous juge responsable de (ayant à « répondre de ») quelque chose ; je vous reconnais ipso facto comme personne : on ne saurait faire un procès à un être qui ne peut d’aucune façon répondre de ses actes. « […] Traiter un individu comme une personne, c’est le considérer comme responsable de ses actes devant les tribunaux, au sens littéral ou figuré, de la loi ou de la morale – ou même, pour certains, devant les tribunaux du jugement divin » (Alan Montefiore). John Locke n’aura donc pas tort, à cet égard, de voir dans le terme « personne » un « terme de tribunal » (forensic) 4.
La perception de l’inhumain n’est possible qu’à partir du vif sentiment de son opposé, de ce qu’on a appelé le sens de l’humain. Quand je reconnais l’humanité d’autrui, je le fais grâce à une connaissance antérieure de cette humanité qui ne peut être au bout du compte que celle que j’ai de ma propre humanité. Le mot latin persona signifie en premier lieu « masque de théâtre », le mot grec correspondant, prosôpon, signifie premièrement la « face », le « visage », ce qui est donné au regard de l’autre, puis aussi « masque ». Viendront ensuite naturellement d’autres sens, désignant le personnage, le rôle qu’il joue et l’acteur qui joue ce rôle. Ces mots ne désigneront que plus tard celle ou celui qui parle, pour ainsi dire, derrière le masque, la personne au sens qui nous est familier. Cette évolution de sens est tout à fait naturelle. Car nous ne voyons jamais de nos yeux corporels la personne, mais toujours un masque, un visage demeurant du reste souvent énigmatique, que chacune ou chacun compose plus ou moins délibérément. Mais alors, comment parvient-on à la personne au sens plus profond ?
Lorsqu’il est conscient, l’esprit humain est immédiatement présent à soi. Mais je ne puis être présent à autrui de la même manière qu’à moi-même. Comme le déclarait Fichte, « Je ne peux pas du tout être immédiatement conscient d’une liberté en dehors de moi ». La question est à vrai dire : « Comment l’être humain en vient-il à assumer et à reconnaître qu’il existe des êtres rationnels semblables à lui en dehors de lui, puisque de tels êtres ne sont pas immédiatement ou directement donnés ou présents en sa pure conscience de soi ? » S’agissant de liberté, Fichte faisait observer en outre que la conscience de ma propre liberté n’appartient pas à la sphère de la conscience immédiate, mais bien plutôt à celle de la clarification de la conscience complète. Elle n’est d’abord qu’implicite, et s’explicite par la médiation intersubjective : essentiellement dans la prise de conscience du fait que ma liberté limite celle d’autrui et réciproquement.
Bref, j’en viens à connaître autrui en le reconnaissant et en le traitant avec le respect dû à sa liberté, c’est-à-dire en reconnaissant que sa liberté limite la mienne. La question de l’autre se confond presque avec celle du droit 5. Comme l’écrit Walter Schulz, « une des intuitions les plus profondes de Fichte est d’avoir su expliquer que, d’un point de vue théorique et abstrait, autrui peut, au même titre que le monde des objets, être nié par moi en tant que sujet conscient de soi, et que seul l’aspect moral m’en empêche en m’invitant (auffordert) à me limiter par rapport à autrui et ainsi à le reconnaître 6 ».
Il reste que ce n’est initialement que grâce à l’accès intérieur à moi-même que je le reconnais. On dit bien, et pour cause, re-connaître. Une personne est un être qui pense, sent, aime, comme nous. Nous savons par conséquent tous on ne peut mieux ce qu’est une personne, par l’expérience que nous avons de vivre la vie de personnes. Nous voilà au cœur même de l’éthique, la connaissance de soi. « Agis de telle sorte que tu traites l’humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre toujours en même temps comme fin, et jamais simplement comme moyen », déclare avec justesse l’impératif kantien. Barbare est ainsi avant tout celui ou celle qui est pervers au point de méconnaître autant sa propre humanité que celle des autres. Tout le problème est qu’il ne sait pas qu’il l’ignore. « En quoi consiste la barbarie, demandait Goethe, sinon précisément en ce qu’elle méconnaît ce qui excelle 7 ? »
Le sens de l’humain est dès lors donné par la conscience morale, par cette exigence de nous-mêmes à l’égard de nous-mêmes qui nous fait pressentir qu’en causant injustement un tort à autrui, c’est immédiatement à nous-mêmes que nous faisons du tort. C’était là la portée de la thèse défendue par Socrate (dans le Gorgias de Platon), selon laquelle il vaut mieux subir une injustice qu’en commettre une. Il est aisé de voir que le droit implique le devoir, puisqu’ils sont comme l’envers et l’endroit d’une même réalité. Si une chose vous est due, il s’ensuit que c’est pour d’autres un devoir, une obligation de vous la rendre ; de même que pour vousmême, ce qui est dû à d’autres. Voici qu’apparaît clairement la relation à autrui. Nous voilà en fait déjà au cœur de la justice, qui se distingue de l’amitié par le fait que dans la justice l’autre est en quelque sorte séparé; si j’éprouve pour vous de l’amitié, voire simplement une sympathie naturelle, les gestes qui en résulteront ne seront pas le fait de la justice comme telle. La justice se vérifie plutôt dans la reconnaissance d’une dette, d’un dû, à l’égard de l’ autre comme autre. Sa grandeur se vérifie le plus clairement dans les cas où l’altérité est la plus prononcée : plus l’autre est loin de moi, moins j’ai d’affinité avec lui, plus le devoir à son endroit relèvera de la justice proprement dite. Toutes les manières d’éliminer pratiquement autrui participent de l’injustice ; ainsi les multiples formes d’intolérance et de discrimination : racisme, sexisme, fanatisme prétendument religieux, etc. ; il en est de subtiles, comme la calomnie, la médisance, le « meurtre civil » (détruire sa réputation), et le reste 8.
Telle est aussi bien la signification de la règle universelle, dite d’or : « ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse » (Entretiens de Confucius, xv, 23) ; « Faites aux autres ce que vous voudriez qu’ils vous fassent » (Matthieu 7, 12). Il y a là une expression de la solidarité humaine la plus fondamentale. Or le sol de cette solidarité est précisément la conscience, par laquelle « l’homme lui-même, l’individu humain, devient l’universel, devient une totalité de sens ». Car, comme l’explique lumineusement Robert Spaemann, « parler de la conscience revient à parler de la dignité de l’homme. Cela revient à parler de ce que l’homme n’est pas un cas d’une entité universelle, un exemplaire au sein d’une espèce, mais que chaque individu est lui-même, en tant qu’individu, une totalité, qu’il est lui-même déjà “l’universel” 9 ».
Le développement de la conscience a cependant besoin de l’aide d’autrui. On voit très distinctement chez les enfants qu’il y a en tout être humain une disposition de la conscience, une capacité de discerner entre le bien et le mal. Comme le rappelle Spaemann, « ils ont un sens très développé de la justice. Ils sont indignés lorsqu’ils voient que la justice n’est pas respectée. Ils possèdent un sens de ce que sont les notes justes et les notes fausses, la bonté et la sincérité ; mais s’ils ne voient pas ces valeurs incarnées dans une autorité, cet organe s’atrophie ». Les mots, les paroles sont pour eux le médium de la transparence et de la vérité. Mais pour peu qu’ils découvrent l’utilité de mentir, voire le mensonge chez les adultes, cet éclat disparaît petit à petit et des formes atrophiées de la conscience se développent. Ici encore, les médias aggravent la situation. Huxley conseillait avec humour et profondeur à la fois qu’il faille leur enseigner « l’art de la dissociation », afin de les prémunir contre les amalgames publicitaires et les fausses associations du politiquement correct ; leur faire voir, par exemple, qu’il n’y a guère de rapport entre une jolie femme et les mérites d’un dentifrice, puis, à des degrés plus profonds, aucun lien nécessaire non plus entre la grandeur de la politique ou de la religion et la guerre. C’est une autre manière de redire combien est essentiel le développement du sens critique, du jugement, le mieux servi ici sans doute par les disciplines qui contribuent à aiguiser l’esprit, à lui donner de la précision, de la clarté, en enseignant à « abstraire, comparer, analyser, diviser, définir et raisonner correctement » (Newman) 10.
Le recours au dialogue présuppose la liberté des interlocuteurs, la capacité d’infléchir le jugement d’autrui, comme celle de laisser infléchir le sien, en vue du bien commun. Il y a pathologie politique lorsque des régimes suscitent des fatalismes défaitistes, invitant à une acceptation résignée d’un destin qu’on ne saurait mettre en cause – un trait classique des tyrannies, d’ailleurs. Comme l’a fait observer John R. Saul, il n’y a pas de démocratie, pas de vote, pas de choix, pas de citoyens, si tout est contrôlé par des forces économiques inéluctables, si le monde est vu comme constitué d’individus atomiques, de plus en plus détachés de toute collectivité, esclaves de la rapacité de quelques-uns. Il n’y a donc pas lieu de s’étonner de la coïncidence curieuse, constatée par Habermas, d’un sentiment d’impuissance politique avec le soi-disant triomphe planétaire de la démocratie. À quoi s’ajoute le paradoxe suivant, que rapporte Federico Mayor, directeur général de l’Unesco : « Plus le monde se globalise et plus il s’individualise et se fragmente. En réalité, c’est justement parce qu’il se mondialise qu’il s’atomise à vue d’œil : car dans un marché qui devient global, la fragmentation, loin de comporter des sanctions, est profitable, et les institutions médiatrices qui fondaient le lien social – la nation, le travail, la famille et l’école – sont en proie à un processus de dissociation 11. »
« Deviens ce que tu es », le précepte dérivé de Pindare, veut dire qu’on est appelé à constituer soi-même son propre « séjour » (êthos), son propre être en ce sens, qui revêt ainsi la dignité d’une fin qu’on est invité à se donner, à la hauteur des trésors reçus en héritage. La vertu est une « force » (virtus), une « excellence » (aretê), telle ou telle virtualité portée à son sommet. Dans le flux de la vie, la vertu donne un être, une identité ferme, qu’incarne bien la vertu de force ou de courage. L’acquisition de la vertu, d’un « sens des valeurs », peut dès lors se décrire comme une naissance continuelle à soi : « elle est le résultat d’un choix libre, et nous sommes ainsi en un sens nos propres parents » (Grégoire de Nysse) ; Aristote parlait de l’homme comme « principe et générateur de ...