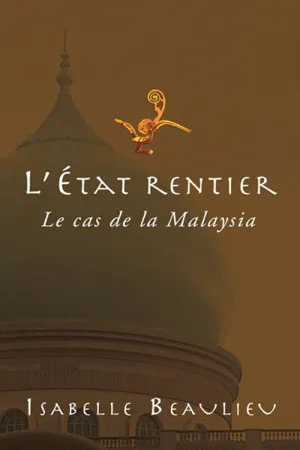![]()
CHAPITRE 1
Le cas malaysien :
Clés factuelles et cadre d’analyse
Cette étude du cas malaysien explore un type de développement politique et économique souvent négligé par la littérature spécialisée. Cette économie mondialisée depuis des décennies évolue dans un contexte politique national tout à fait stable, mais néanmoins marqué d’autoritarisme. Pour entreprendre l’analyse de ce cas, les grands repères factuels ainsi que les clés théoriques seront présentés dans ce premier chapitre qui s’articule en trois parties : les jalons historiques et économiques; la mise en place des institutions politiques et les clés théoriques. Cette dernière partie propose un cadre d’analyse pertinent et novateur : celui de l’État rentier et de ses institutions.
1.1 Les grands repères de l’histoire politique et économique
Afin de mieux comprendre les racines du pouvoir dans ce pays, intégré à l’économie mondiale depuis longtemps, rappelons les grandes lignes de l’histoire politique de la Malaysia avant son indépendance en 1957. Cet amalgame de petits sultanats est devenu une entité nationale à force de volonté politique et d’années de patiente construction institutionnelle. L’impact de la présence britannique est incontestable, ayant administré cette colonie pendant 170 ans; elle a modelé l’économie, les institutions et même influencé la création des partis politiques. La coopération entre les élites locales et coloniales a toujours été cordiale et, comme nous le verrons, la décolonisation s’est déroulée sans conflit.
1.1.1 Malacca, sur la route des épices
L’histoire de la Malaysia est étroitement liée à l’évolution du commerce en Asie. Zone de passage depuis des siècles, la Malaysia1 a subi des influences multiples. Son histoire politique est faite de conquêtes et de reconquêtes2. Étant donné son emplacement sur la route commerciale reliant la Chine et l’Inde, dès l’an 1000 et jusqu’à l’arrivée des Européens au XVIe siècle, elle subit les influences des grands empires de l’époque (mongol, thaï, khmer, etc.) ainsi que celles des mondes persan et arabe (SarDesai, 1994 : 40–58). Au cours du premier millénaire de notre ère, l’hindouisme et le bouddhisme vont pénétrer l’archipel malais3, puis à partir du XIIIe siècle, l’islam s’y répand sous l’influence des marchands musulmans venus d’Inde (Jacq-Hergoualc’h, 2002). La ville de Malacca et son port, fondés par un prince de Sumatra vers 1402, regorgent d’activités commerciales dès le XVe siècle alors que le reste du pays malais demeure à l’écart de ces activités. Situé au passage le plus étroit du détroit du même nom, le port devient un lieu stratégique pour le commerce des épices et est fréquenté assidûment par les navires venus d’Occident et d’Orient. Les Portugais s’en emparent en 1511. Ils y restent plus d’un siècle sans parvenir à se concilier la faveur des sultans malais. Les Hollandais, profitant du déclin de l’empire portugais et de la division des sultans, se saisissent de Malacca en 1641. Ils y resteront jusqu’en 1824, sans toutefois déployer d’efforts de peuplement ni de développement, préférant concentrer leurs activités à Jakarta et dans les îles voisines, aujourd’hui devenues l’Indonésie.
1.1.2 Les Straits Settlements: Des comptoirs commerciaux sous contrôle britannique
Au XVIIIe siècle, l’Empire britannique commence à s’intéresser au détroit de Malacca. Afin de soutenir leur commerce qui s’est fortement développé dans la région, notamment entre l’Inde et la Chine, les Britanniques mettent en place un réseau de comptoirs portuaires sur les rives du détroit de Malacca (De Koninck, 2005 : 58–62). Ils ont besoin de ports d’escale et d’entrepôts pour les tissus et l’opium indien, le thé et la porcelaine de Chine, et aussi pour le fer et les produits manufacturés au Royaume-Uni, importés dans la région. Les Britanniques s’installent donc le long de la péninsule de la Malaisie en 1786, d’abord au nord à Penang, ensuite, en 1819, ils achètent Singapour puis, en 1824, les Hollandais leur cèdent Malacca. Cette entente entre les Hollandais et les Britanniques est conclue dans la foulée du Congrès de Vienne et des jeux d’alliances au lendemain des guerres napoléoniennes qui ont bouleversé l’Europe4.
En 1826, la Compagnie des Indes orientales fusionne en une seule administration ces trois villes situées sur le détroit de Malacca : Penang, Malacca et Singapour. Ces comptoirs deviennent alors les « établissements des détroits » ou Straits Settlements comme les désigne l’administration coloniale (Caldwell et Mohamed, 1977; Ginsburg et Roberts, 1958). À ce moment, en Asie du Sud-Est, la couronne britannique ne cherche qu’à consolider un système de ports et de défense pour soutenir sa présence dans la région et protéger son commerce avec la Chine et l’Inde. Pour ce faire, elle estime que ses possessions portuaires suffisent. Le Colonial Office s’en tient alors à sa politique de non-intervention et ne cherche pas à pénétrer dans les terres de la péninsule, contrôlées par les sultans malais. La région est stable, la navigation est encore sécuritaire et le libre-échange rend florissante l’économie des ports.
Contrairement au Colonial Office, les marchands anglais établis dans les Straits Settlements souhaitent exploiter le potentiel économique de l’arrière-pays malais, notamment les mines d’étain. Le développement commercial de la région et la présence de nouveaux compétiteurs, français entre autres, ainsi que l’instabilité chronique des sultanats finiront par convaincre la métropole d’abandonner sa politique de non-intervention5. Les disputes dynastiques entre les nombreuses familles princières malaises et la dispersion du pouvoir dans les sultanats affaiblissent considérablement les sultans au profit des Britanniques. Le jeu d’alliances est singulièrement compliqué par la fragmentation du pouvoir au sein de chaque sultanat (Kessler, 1978). De plus, sur les rivières, seul moyen de transport, la piraterie est très répandue, menaçant la circulation commerciale à l’intérieur du pays. L’instabilité intérieure freine les investissements britanniques. L’activité minière, naissante elle-même, vient accroître cette instabilité. En effet, l’extraction de l’étain est assurée par des travailleurs immigrés de Chine placés sous la férule des Chinese Captains6. Ces caïds chinois, qui contrôlent majoritairement le secteur de l’extraction minière, sont à la tête de sociétés secrètes rivales, liées elles-mêmes aux sociétés secrètes en Chine, qui, au gré des disputes dynastiques, s’allient avec différents chefs et sultans malais pour garantir leur accès au précieux minerai (Azizan, 2002; Chin, 1998; SarDesai, 1977; Jackson, 1961).
Deux facteurs externes importants viendront aider les marchands britanniques dans leur lobby en faveur d’une intervention de Londres : la demande croissante d’étain et la compétition des autres puissances coloniales (SarDesai, 1994). La demande mondiale pour l’étain croît rapidement avec l’avènement des aliments en boîtes de conserve au XIXe siècle; la demande explose quand l’usage se répand en Europe et en Amérique7. Au même moment, d’autres puissances européennes s’installent dans la région, à la faveur des formidables avancées technologiques dans les transports et les communications (bateaux à vapeur rapides, télégraphe, percement du canal de Suez). À la fin de 1873, le Colonial Office donne finalement son feu vert à l’administration anglaise basée à Singapour pour promouvoir et supporter l’expansion de la présence coloniale britannique à l’intérieur des terres, soit dans les sultanats malais.
En conséquence, la Couronne britannique établit des protectorats dans les sultanats en signant des traités avec les sultans. Du point de vue juridique, un protectorat ne perd ni sa souveraineté ni son chef, le sultan, mais il accepte de se placer sous la protection de la Couronne britannique. Les sultans gardent leur autorité en matière de coutumes et de religion, mais cèdent l’administration de leur territoire aux Britanniques; de cette façon, la Couronne met en pratique sa formule de contrôle indirect des territoires conquis. Afin d’y parvenir, les Britanniques ont usé davantage de diplomatie que de menaces : pour obtenir la coopération des Malais et assurer leur propre prospérité, ils évitent de porter atteinte au prestige des sultans et prennent le contrôle de l’économie (Marshall, 1996; Bowle, 1974; Windstedt, 1935). La position des sultans a été rehaussée plutôt que minée par ces traités. En reconnaissant la souveraineté des sultans malais et en octroyant postes et pensions aux princes malais, les Britanniques ont renforcé la société traditionnelle malaise (Stockwell, 1977 : 482). Cet arrangement permet aux sultans et à leur famille de s’enrichir; ils reçoivent des salaires honorifiques, des droits sur l’exploitation minière, des redevances symboliques sur le commerce et une partie des taxes sur le jeu. Ce système sera perturbé seulement par la guérilla communiste qui s’amorce dans les années 1930.
1.1.3 La menace communiste : Tremplin du nouveau pouvoir des élites locales
Le prochain chapitre traitera plus en détail de cet épisode mais rappelons ici qu’un mouvement communiste naît dans les années 1930 et se développe sous l’occupation japonaise, pendant la Deuxième Guerre mondiale. À leur retour, en 1945, les Britanniques doivent affronter une guérilla communiste bien armée et appuyée par plusieurs milliers de combattants8. Entraînés à lutter contre les Japonais, les communistes (presque exclusivement chinois) dirigent leurs forces contre l’occupant colonial. Deux éléments vont nourrir l’ardeur de la guérilla : d’abord l’idéologie communiste qui, en Asie, porte davantage le discours nationaliste de la libération contre l’impérialisme colonial que le discours marxiste; mais également la problématique du statut légal des populations chinoises dans l’avenir politique de la Malaysia9. Toutefois, dès 1945, Londres est déterminé à reprendre en main la lucrative Malaisie. Le secrétaire d’État aux colonies, Creech Jones, déclarait au Cabinet de Londres en 1948:
La Malaya est de loin la source la plus importante de dollars de l’empire colonial et la stabilité du dollar dans la totalité de la zone Sterling serait gravement affectée si des interférences sérieuses ralentissaient les exportations de la Malaya (cité dans Deery, 2002 : 10).
De même que les revenus tirés de la Malaisie ont largement contribué au trésor britannique à la fin de la Première Guerre mondiale (Tarling, 1992 : 354), Londres, lourdement endetté envers les Américains au sortir de la Seconde Guerre, comptera sur les revenus du caoutchouc et de l’étain de la Malaisie pour la survie économique du Royaume-Uni: « En fait il n’est pas exagéré de dire que le redressement de l’économie britannique aurait été problématique sans la contribution cruciale de la Malaisie » (Morgan, 1984 : 533).
Pour enrayer le mouvement communiste, le Royaume-Uni agit sur différents fronts, non seulement militaire mais aussi politique et social. En 1950, le secrétaire d’État à la guerre déclarait:
Je ne crois pas que seule l’armée peut en venir à bout… Pour en finir avec le mouvement communiste il nous faut déployer des efforts militaires mais aussi développer une force policière, et déployer des efforts politiques et administratifs (Memorandum from John Strachey to Malaya Committee; 17 juin 1950; cité dans Deery, 2002 : 28).
La stratégie doit être globale et conséquemment, le pouvoir colonial développe sa collaboration avec les élites locales. En 1951, on adopte une stratégie qui vise à gagner les cœurs et les esprits (to win hearts and minds) de la population locale afin d’affaiblir son engouement pour les communistes. C’est alors que l’on introduit les premières réformes politiques, des élections, des réformes du travail, et l’établissement de syndicats modérés, des réformes agraires pour réduire la pauvreté et consolider le soutien des Malais, et les premiers programmes de discrimination positive promalaise (Jomo et Hui, 2003 : 2). Les Britanniques parviennent à endiguer le mouvement communiste; ils peuvent alors négocier leur départ tout en protégeant leurs intérêts économiques et stratégiques (Tarling, 1992 : 354).
Devant la menace communiste et l’éventualité d’un retrait des Britanniques, les élites locales, de leur côté, s’organisent et fondent leurs partis politiques. L’administration britannique accepte à ce moment l’idée de créer une assemblée législative10. En 1955, le Gouverneur général organise les premières élections législatives, avec succès. Une nouvelle coalition réunissant trois principaux partis politiques remporte 51 des 52 sièges du nouveau Parlement fédéral. Cette victoire électorale décisive accélère le départ des Britanniques. En 1957, ils octroient la souveraineté à la Malaisie. La nouvelle coalition au pouvoir n’a pas été constituée par des mouvements anti-impérialistes, au contraire. Les élites locales se sont coalisées pour protéger leurs intérêts. Le haut-commissaire britannique en poste à Kuala Lumpur de 1954 à 1957 écrivait à ce sujet:
La période d’urgence a été une bénédiction finalement. Au cours des années 1948 à 1953 toute l’attention s’est portée sur l’importante de vaincre les terroristes communistes. La menace d’un ennemi commun a fait plus que n’importe quoi d’autre pour rapprocher les communautés, les faire travailler ensemble, à l’unisson dans un effort commun et important (MacGillivray, 1958 : 159).
L’administration coloniale britannique régnera sur les territoires qui deviendront la fédération de Malaysia pendant quelque 170 ans. Elle aura marqué l’organisation administrative autant que l’économie et le paysage multiculturel, frappé de profonds clivages. Cette fédération compte aujourd’hui treize États, inégalement répartis sur deux territoires géographiques distincts : la Malaysia péninsulaire (onze États) et la Malaysia orientale (deux États).
1.1.4 Un territoire et une population cloisonnés
La fédération de Malaysia, située juste au nord de l’équateur, a pour voisins immédiats la Thaïlande, Singapour, l’Indonésie et Brunéi. Cet ensemble territorial est situé au cœur de l’Asie du Sud-Est. La Malaysia péninsulaire regroupe onze des États de la Fédération sur une étroite bande de terre qui s’allonge au sud de la Thaïlande et s’arrête aux ponts menant à l’île de Singapour. Plus de 80 % de la population réside dans la péninsule, dont la superficie ne couvre que 40 % du territoire national (De Koninck, 2005 : 182). La Malaysia orientale c...