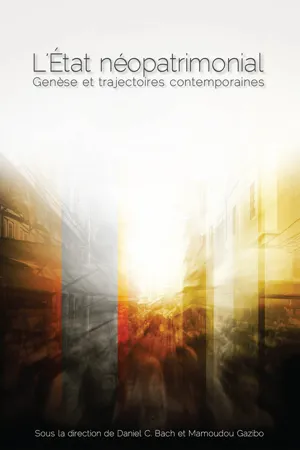I
Le concept de patrimonialisme et ses interprétations contemporaines
Hinnerk Bruhns
Depuis une trentaine d’années, les concepts de patrimonialisme et de néopatrimonialisme sont associés à l’analyse de certaines formes de construction étatique et de gouvernance tant en Afrique, qu’en Amérique latine et qu’en Asie. Comme le soulignent les chapitres qui suivent, on cherche ainsi à rendre compte de diverses facettes des obstacles rencontrés sur le chemin de la démocratisation et du développement politique en général. Ces préoccupations remontent au début des années 1970 lorsque, dans un contexte de remise en cause des théories de la modernisation, Shmuel N. Eisenstadt s’interrogeait sur « la justification à utiliser le terme patrimonial – un terme dérivé de l’analyse de systèmes politiques historiques traditionnels – pour analyser des systèmes politiques modernes. » Et d’ajouter qu’une telle utilisation « pourrait en fait être extrêmement productive… dans la mesure où le terme patrimonial est utilisé pour qualifier non pas tant un niveau de “développement” ou une différenciation entre régimes politiques, qu’une manière particulière d’aborder une question essentielle de la vie politique, un problème susceptible de traverser les différents niveaux de “développement” ou de complexité structurelle ». Dans le même texte, Eisenstadt suggère également de distinguer les régimes patrimoniaux traditionnels des formes de patrimonialisme moderne, à propos desquelles il introduit les concepts de « néopatrimonialisme » et de « régimes post-patrimoniaux »1. Le distinguo doit au premier chef permettre de mieux saisir les différences entre des régimes patrimoniaux antiques et médiévaux d’une part, modernes de l’autre. Pour lui, la différence essentielle entre régimes patrimoniaux et néopatrimoniaux réside « dans les problèmes politiques auxquels étaient respectivement confrontés les régimes traditionnels et modernes, et […] dans la constellation de conditions à même d’assurer la continuité d’un régime patrimonial spécifique »2. Dans les régimes néopatrimoniaux, les liens entre centre et périphérie étaient plus intenses et sollicités. Les conséquences en étaient l’établissement d’un cadre politique plus large et unifié, l’intégration de nouveaux groupes, et l’émergence de nouvelles dimensions d’identités collectives. La tendance expansive de ces régimes les rendait tout à la fois plus fragiles et sujets à des crises.
S. N. Eisenstadt réagissait ici à une évolution dans l’emploi du concept de patrimonialisme initialement proposée par Guenther Roth3. Celui-ci avait observé que, dans beaucoup de nouveaux États, la tradition avait perdu sa force légitimatrice sans avoir été remplacée par une modernité légale-rationnelle. En conséquence, des formes de domination personnelle, qui ne correspondaient à aucun des trois types wébériens de légitimité (légal-rationnelle, traditionnelle, charismatique), devaient essentiellement leur maintien à des « incitations et des récompenses matérielles », notamment le clientélisme et la corruption. Pour rendre compte de cette évolution, G. Roth avait suggéré de saisir conceptuellement ces formes de domination en distinguant le patrimonialisme traditionnel d’un patrimonialisme personnalisé, dé-traditionnalisé, ultérieurement dénommé néopatrimonialisme.
Depuis, certaines nuances et distinctions ont été introduites dans l’emploi du terme néopatrimonialisme. Un premier exemple en est la définition donnée par Jean-François Médard qui, contrairement à Eisenstadt, situe la différence dans le fonctionnement interne des deux régimes :
La conception néopatrimoniale du pouvoir se situe dans le prolongement historique de la conception patrimoniale traditionnelle, mais ne peut être confondue avec elle, dans la mesure où elle ne s’enracine dans aucune légitimité traditionnelle. Il existe une différence entre les États néopatrimoniaux « rationalisés » c’est-à-dire régulés par un mode de régulation spécifique fondé sur la redistribution particulariste, et les États purement prédateurs et kleptocrates qui débouchent sur une criminalisation et une privatisation de l’État. Ce dernier cas qui rappelle le « sultanisme » de Max Weber, correspond au cas limite et paroxystique du néopatrimonialisme qui détruit l’État dont il se nourrit. C’est le stade ultime du néopatrimonialisme4.
Notre deuxième exemple est tiré d’un texte plus récent dans lequel le problème central des discussions entre Africanistes sur le concept de néopatrimonialisme est ainsi défini :
All the attempts to define neopatrimonialism (or « modern patrimonialism ») deal with, and try to tackle, one and the same intricate problem: the relationship between patrimonial domination on the one hand and legal-rational bureaucratic domination on the other, i.e. a very hybrid phenomenon. […] The term clearly is a post-Weberian invention and, as such, a creative mix of two Weberian types of domination: of a traditional subtype, patrimonial domination, and legal-rational bureaucratic domination5.
La différence entre patrimonialisme et néopatrimonialisme se situe pour les auteurs de ce texte dans le rapport privé/public. Dans le patrimonialisme, toutes les relations (politiques et administratives) entre gouvernants et gouvernés sont des relations privées : « il n’y a aucune différenciation entre domaines public et privé ». Dans le néopatrimonialisme, la distinction public/privé existe, au moins formellement, et elle est acceptée. L’exercice « néopatrimonial » du pouvoir se fait « dans le cadre et avec la revendication d’un cadre étatique (stateness) moderne de type légal-rationnel »6. Les deux auteurs proposent en conséquence une définition du néopatrimonialisme « tirée des concepts de patrimonialisme et de bureaucratie légale-rationnelle chez Weber ». Le néopatrimonialisme, ajoutent-ils « est le fruit de l’interpénétration de [ces] deux types de domination qui coexistent… »7. Le préfixe « néo » ne doit pas être compris comme un synonyme de « moderne »8.
La référence à Weber se lit de façon un peu différente chez Blundo et Médard, qui écrivent, à propo...