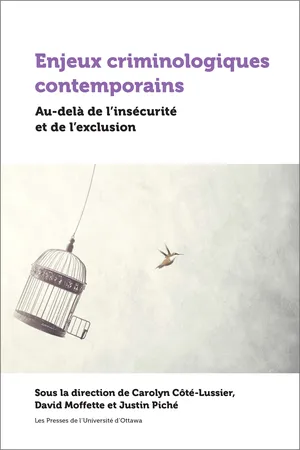CHAPITRE 1
La théorie de la neutralisation de la rationalité pénale moderne : Une théorie du désistement ?
Richard Dubé et Sandrine Ferron-Ouellet
Un récent projet de recherche financé par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada s’était donné comme objectif d’analyser l’ensemble des débats parlementaires portant sur les projets de loi introduits entre 2006 et 2015 par le gouvernement conservateur de Stephen Harper pour modifier et durcir le Code criminel canadien. Comme on pouvait s’y attendre, l’analyse de ces débats a pu clairement montrer l’influence déterminante de la rationalité pénale moderne et des théories de la dissuasion et de la dénonciation1 dans la justification de la répression conservatrice (Dubé et Garcia, 2017 ; 2018). Un cas en particulier retient ici notre attention : le projet de loi C-2, Loi sur la lutte contre les crimes violents. Introduit pour la première fois à la Chambre des communes le 18 octobre 2007 et ayant obtenu la sanction royale le 28 février 2008, C-2 se distingue en effet des autres projets de loi étudiés (une vingtaine au total) du fait qu’on y abandonne soudainement les rhétoriques de la dissuasion et de la dénonciation au profit de celle préétablie par la théorie de la neutralisation : une théorie de la peine pourtant très peu évoquée ailleurs dans le corpus empirique. Si ce qui inspire C-2 continue d’être le carcéral et la répression, le changement observé dans la manière de légitimer cette orientation représente aujourd’hui pour nous, dans le cadre de ce texte, une énigme à résoudre. Comment expliquer l’intervention de la théorie de la neutralisation dans le cas de C-2 ? Quel avantage politique cette théorie de la peine pouvait-elle représenter par rapport aux théories de la peine plus usuelles ? La thèse explorée dans ce chapitre est que les critiques que l’on a traditionnellement adressées à la prison, notamment par rapport à son manque d’efficacité en matière de réhabilitation et de dissuasion, sont facilement enrayées par la théorie de la neutralisation. Sur la base de l’analyse empirique, nous souhaitons ainsi démontrer comment l’argument de la neutralisation intervient dans les débats parlementaires entourant C-2 pour légitimer ce que les autres théories de la peine n’arrivaient plus à légitimer. Notre objectif est aussi de montrer comment cette même théorie permet de se désister du justiciable, de ses droits fondamentaux, tout en n’abandonnant jamais l’idéal carcéral auquel est encore fortement accrochée notre « culture pénale moderne ».
En première partie, nous présenterons C-2 et ses principales dispositions et préciserons en quoi celles-ci contribuent au durcissement des peines au Canada. En deuxième partie, nous reviendrons à cette notion de « culture pénale moderne » par le biais de la théorie de la rationalité pénale moderne et les différentes théories de la peine qui la constituent comme un système de pensée « carcéralisant ». En troisième partie, nous aborderons brièvement quelques considérations méthodologiques qui nous permettront d’enchaîner avec la quatrième et dernière partie de ce texte, laquelle sera consacrée à l’analyse et à la problématisation de certains aspects discursifs qui nous ont paru plus particulièrement préoccupants à l’égard des politiques pénales fondées sur la théorie de la neutralisation.
Les objectifs visés par le projet de loi C-2
C-2 est un projet de loi omnibus qui regroupe plusieurs autres projets de loi morts au feuilleton durant la première session de la 39e législature. Les objectifs poursuivis sont donc vastes. Tel que libellées dans le Résumé législatif du projet de loi C-2, une fois adoptées, les modifications proposées :
[…] créeront deux nouvelles infractions visant les armes à feu et prévoiront le rehaussement des peines minimales d’emprisonnement pour les infractions graves mettant en jeu des armes à feu, renverseront le fardeau de la preuve du régime de remise en liberté sous caution pour les personnes accusées d’infractions graves mettant en jeu des armes à feu ou d’autres armes réglementées, rendront plus facile la détermination que quelqu’un est un délinquant dangereux, faciliteront la détection et l’enquête des cas de conduite avec capacités affaiblies par l’effet d’une drogue et relèveront les peines minimales prévues pour la conduite avec capacités affaiblies, et feront passer de 14 à 16 ans l’âge de consentement à une activité sexuelle. (Barnett, MacKay et Valiquet, 2007)
Ce qui nous intéresse plus particulièrement, ce sont les modifications proposées touchant directement ou indirectement les normes de sanction, les peines, les discours et les pratiques qui permettent leur légitimation et leur mise en œuvre. Nous expliquerons en deuxième partie du texte en quoi cette zone normative peut être considérée comme « névralgique » sur le plan de l’évolution du droit criminel moderne (Pires, 2002). Pour l’instant, nous nous contentons d’affirmer l’importance stratégique de cette zone normative. Les deux modifications fondamentales que C-2 propose à cet égard sont : 1) le « rehaussement des peines minimales d’emprisonnement pour les infractions graves mettant en jeu des armes à feu » ; et 2) l’augmentation des peines minimales pour la conduite avec facultés affaiblies.
Qu’il s’agisse de créer de nouvelles peines minimales ou d’augmenter la durée des peines existantes, C-2, comme bien d’autres projets de loi introduits sous le gouvernement Harper, propose de durcir le régime canadien des peines en favorisant le recours à l’incarcération et en limitant davantage la portée des sanctions substitutives comme le sursis ou la probation. Cependant, nous verrons concrètement comment C-2 se distingue des autres projets de loi conservateurs dans la manière de justifier cette répression. L’analyse de cette justification sera encadrée par la théorie de la rationalité pénale moderne à laquelle nous consacrons la deuxième partie de ce texte.
La théorie de la rationalité pénale moderne
Depuis plusieurs années, des chercheurs du Département de criminologie de l’Université d’Ottawa suivent les pas d’Alvaro Pires2 afin d’étudier, en matière de droit criminel, les effets associés à ce qu’il a appelé la « rationalité pénale moderne » (RPM). La théorie développée par Pires attribue à ce système de pensée des effets de stagnation et d’immobilisme qui, en Occident, nuisent, voire bloquent l’évolution des normes de sanction. À cet égard, au centre des préoccupations se trouvent, d’une part, la place importante que les discours identitaires du droit criminel moderne attribuent encore à la prison et, d’autre part, la manière dont ces mêmes discours marginalisent les sanctions substitutives (Garcia, 2013). Nous entendons par discours identitaires des ordres sémantiques à partir desquels un système social, en l’occurrence le système pénal, établit par et pour lui-même, dans l’institutionnalisation de discours réflexifs, tout ce qui du point de vue du système constitue la frontière qui le différencie d’autres systèmes présents dans son environnement. Par exemple, en matière pénale, on peut considérer comme des discours identitaires les sémantiques qui ont tendance à associer certaines sanctions non carcérales comme le dédommagement à des mesures trop « civilistes » pour être utilisées de manière autonome dans le pénal (Pires et Acosta 1994). De tels discours marquent la différence identitaire du système pénal à travers un encadrement strict des modes de résolution de conflits typiquement associés à d’autres institutions de contrôle social, en l’occurrence, pour l’exemple du dédommagement, au droit civil. Ces discours non seulement limitent l’usage des sanctions substitutives (Faugeron, 1994), mais entraînent en même temps une survalorisation des sanctions typiquement associées au pénal, en l’occurrence une survalorisation de la prison (Pires, 1998).
Il importe de ne pas confondre ici les niveaux d’observation. La théorie de la RPM ne prétend pas à la généralisation de la prison dans la pratique ; elle ne dit pas que la peine carcérale est la plus utilisée en droit criminel. Ce n’est pas à ce niveau d’observation que la prison peut être représentée comme la peine de référence. Pour la RPM, la prison demeure la peine de référence dans les autodescriptions identitaires du droit criminel moderne. Ceci dit, il ne faudrait pas non plus en déduire pour autant que ces discours n’ont aucun effet sur la pratique. Comme l’explique clairement la théorie des systèmes sociaux de Niklas Luhmann (2010), les autodescriptions que les systèmes sociaux instituent autopoïétiquement, par et pour eux-mêmes, influencent directement l’univers des possibles sur le plan pratique ou décisionnel. Pour reprendre l’exemple du dédommagement, bien que cette sanction soit permise en droit criminel canadien et qu’un juge puisse décider de l’appliquer, des lois et des règles jurisprudentielles élaborées sous l’influence de la RPM limitent considérablement la portée pratique de cette sanction alternative. Concrètement, suivant ces règles, on remarquera que le dédommagement ne peut être utilisé que lorsque les dommages sont faciles à calculer (Code criminel, par. 737.1[4]) et qu’il ne peut par ailleurs être utilisé comme sanction autonome ; il doit accompagner une autre peine (Code criminel, par. 737.1[1]).
Suivant la théorie de Pires, la RPM agirait ainsi sur les modes de pensée se rapportant aux sanctions et à l’identité du système pénal en préétablissant les « règles cognitives » à partir desquelles des questions comme le crime, la peine, la protection de la société ou le droit de punir doivent être pensées et traitées. Face au crime, les discours identitaires de la RPM nous enjoignent à présupposer la nécessité d’une peine afflictive qui se traduit généralement par des modes de privation de liberté plus ou moins stricts selon le cas – l’incarcération en milieu correctionnel représentant le mode le plus radical. En droit criminel canadien, la probation, l’emprisonnement à domicile (aussi appelé le sursis) et l’absolution conditionnelle constituent d’autres manières de priver quelqu’un de sa liberté. Par rapport au carcéral, ces sanctions peuvent se concevoir comme des sanctions substitutives (ou alternatives). D’autres sanctions possibles en droit criminel canadien, tels le dédommagement, l’amende ou les travaux communautaires, se caractérisent non pas par la privation de liberté, mais bien par l’obligation d’accomplir une prestation, de faire quelque chose, de verser une somme, de réaliser une tâche ou de compenser un tort subi. Au Canada comme ailleurs en Occident, s’il existe ainsi une certaine diversité de sanctions au sein du droit criminel, il existe en même temps, pour la rationalité pénale moderne, un seuil de gravité au-delà duquel il n’y aura d’autre alternative que l’incarcération. Il y aura en outre, pour cette même rationalité, un seuil de tolérance au-delà duquel les récidives ou le non-respect des conditions devront aussi entraîner la forme la plus radicale de privation de liberté. La théorie de Pires ne nie donc pas la présence d’alternatives à l’incarcération. Elle reconnaît cette diversité, mais elle problématise en même temps les limites qu’impose le système de pensée de la RPM sur la portée souvent fort réduite des sanctions substitutives.
Autre aspect important à considérer lorsqu’on se réfère aux travaux de Pires : sa théorie ne nie pas non plus la présence d’une certaine diversité dans les discours qui entourent les normes de sanctions pénales (Dubé, 2014 ; Garcia, 2013). Elle reconnaît à ce titre que le discours prônant par exemple la dissuasion est différent de celui privilégiant la dénonciation, et reconnaît également que ce dernier diffère aussi de ceux s’inspirant de la rétribution ou de la réhabilitation. Toutefois, au-delà de cette diversité discursive et de ces tergiversations rhétoriques, ce qui se stabilise dans les fondements du droit de punir n’est rien d’autre que l’idéal de la peine privative de liberté et du type d’affliction que cette peine permet de générer ; une affliction de l’esprit plutôt que du corps, pour reprendre la distinction de Foucault (1975), mais tout de même une affliction. Cette redondance s’observe empiriquement dès qu’il s’agit de penser politiquement ou juridiquement la conséquence pénale que doit engendrer le crime. Dans ces circonstances, toutes les théories de la peine auront tendance à favoriser l’affliction du condamné ou son exclusion sociale. Les raisons qu’elles évoquent varieront d’une théorie à l’autre. Pour la dissuasion, elles nous renverront à l’obligation d’intervenir dans les processus décisionnels menant au passage à l’acte afin d’y imposer l’effet dissuasif de la menace carcérale. Pour la réhabilitation, le carcéral continuera d’être valorisé, mais il le sera sur base du principe qu’il permet d’isoler l’individu du milieu de vie qui l’a corrompu et de mettre en œuvre, à l’écart, les programmes favorisant sa réhabilitation sociale. Pour la rétribution, la même peine représentera une forme d’affliction qui, lorsque proportionnelle au mal du crime, permettra de rétablir l’équilibre dans l’ordre de la Justice ou de la Moralité suprême. Enfin, pour la dénonciation, la souffrance infligée par cette même peine carcérale se justifiera en fonction de l’importance qu’une collectivité continue d’accorder aux valeurs froissées par le crime.
À l’instar des théories présentées ci-dessus, la théorie de la neutralisation fait aussi partie du complexe id...