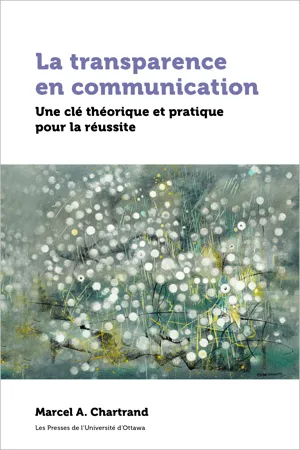1.1 La place de la communication dans l’entreprise
La fonction de communication relève du plus haut dirigeant d’une organisation et participe à la prise de décisions au même titre que les autres fonctions telles que les finances, les ressources humaines et le marketing. Le gestionnaire siège à titre de conseiller stratégique et d’expert dans le domaine des relations avec les divers publics de l’entreprise. Son équipe est formée de spécialistes de la planification, de la rédaction, du design, des relations avec les médias et du Web 2.0. Cette fonction sert de levier pour promouvoir les valeurs de l’entreprise en vue d’atteindre des objectifs directoriaux.
Ce que l’on observe aujourd’hui, Prost y apportait un éclairage en 1967, en affirmant que la valeur d’une organisation tient à l’ensemble de ses activités, c’est-à-dire à la valeur des rapports qui règlent celle-ci : rapports avec les employés, les actionnaires, les fournisseurs et tout autre groupe touché par ses activités. Depuis, cependant, la recherche a clairement démontré que « tout autre groupe », comme le consommateur ou le client, est devenu le principal auditoire visé par la communication d’entreprise.
Deux phénomènes marquants ont contribué au positionnement de cette fonction au cours des dernières décennies, soit l’accélération du rythme de production du savoir et la démocratisation de celui-ci, et surtout, l’essor des réseaux sociaux, nouvel outil de production et de diffusion d’informations qui ne cesse d’accélérer l’accessibilité aux données et de susciter l’engagement citoyen. Ces deux facteurs ont modifié fondamentalement les rapports de la personne avec elle-même ainsi qu’avec les gouvernements et les organismes.
Maintenant, la gestion de crise se vit au rythme du Web 2.0. Il n’y a plus de crises locales, elles sont mondiales. Les activistes occupent le Net et y sont très actifs. Les frontières entre la communication interne et externe de l’entreprise sont de plus en plus ténues. La transparence est devenue subordonnée à la démocratie. Dans l’espace numérique, on n’oublie rien, la mémoire est vive.
Ce constat n’est pas sans rappeler la transformation qui traverse la notion de sphère publique. Il est bon de se remémorer qu’à l’époque où Habermas précisait le concept de « sphère publique » comme le lieu même de formation et d’expression de l’opinion publique (Habermas, 2015, p. 15), les médias étaient mobilisés seulement lorsqu’on souhaitait donner une plus grande amplitude à son expression. Les médias n’étaient qu’un simple outil de la sphère publique. Aujourd’hui, l’outil est devenu la sphère publique en soi. Nous assistons à l’inversion du rapport entre les médias et la sphère publique. De nouveaux enjeux se profilent sur le plan de la gestion habile des phénomènes que provoque cette inversion. Cette mutation requiert de nouvelles structures mentales, une mobilisation de la créativité ainsi qu’un nouveau mode d’action. Elle interpelle l’intellectuel engagé, un rôle de plus en plus exercé par le relationniste.
Ce dernier se retrouve à gérer la complexité des événements au quotidien et à innover quant aux stratégies que doit adopter et maintenir l’entreprise. Les enjeux économiques, sociaux, culturels et politiques sont omniprésents et stimulent la créativité des employés vers des savoir-faire qui assurent productivité, rentabilité et constance dans la réputation de la marque, avec ou sans crise. La qualité de surveillance et d’écoute de l’environnement assure une gestion éthique des enjeux soulevés lorsqu’ils se présentent. C’est dans ce contexte, et soucieux de faire preuve de transparence envers le public tout en demeurant fidèle à son entreprise, que le relationniste se voit investi d’un rôle « d’intellectuel engagé ». C’est-à-dire qu’il a le pouvoir et le devoir de conseiller ses patrons sur les pratiques exemplaires de communication en assumant son rôle de médiateur et d’analyste minutieux, dans le plus grand intérêt du public et de l’organisation.
1.2 Les catégories de cas
Tous les cas retenus ont une portée internationale, nationale, régionale ou locale. Ils ont été choisis parce qu’ils représentent la tendance postmoderne qui promeut la reconnaissance des unicités, des groupes souvent marginalisés, des injustices économiques ou sociales, des abus de pouvoir, de la désinformation. Leur pertinence contemporaine ne peut être passée sous silence et fait partie du devoir de l’intellectuel engagé dans les fonctions quotidiennes reconnues au relationniste.
Ces cas font ressortir les différents domaines de la vie organisée en société. Ainsi, la politique, la démocratie, le droit, l’édition, le journalisme, les modes d’organisation, la gestion, la production, la richesse, la pauvreté, l’injustice et les inégalités sociales sont au rendez-vous. On peut les regrouper dans les catégories suivantes : enjeux contemporains et société, énergie, transport, environnement, santé et recherche, sport, mœurs et morale, politique et entreprise.
1.3 Le choix de la stratégie
Les sujets complexes énumérés précédemment mobilisent le savoir et le savoir-faire adaptés aux dimensions perceptibles et implicites de leurs retombées sociales. L’écrit, la dénonciation, l’aveu et la manifestation sont autant de formes légitimées pour conscientiser et promouvoir le changement nécessaire. Ce dernier peut toucher l’ensemble d’une population ou encore des segments de population, mais il peut aussi toucher la population mondiale tout comme il peut être contenu à l’intérieur d’une entreprise.
Tout problème porté dans la sphère publique force l’organisme concerné à agir rapidement et à faire un choix approprié. Le choix initial est habituellement garant de la durée et de l’espace qui y seront consacrés par les intervenants externes et les médias. Dans la plupart des cas, c’est un tiers public qui provoque la réaction de l’acteur principal. Ce dernier a peu de temps pour réagir. Il doit choisir l’option qui, normalement, atténuera le plus possible les conséquences sur ses publics.
La nature de la stratégie retenue vise toujours le meilleur moyen pour garder contact avec ses publics, qu’ils soient internes ou externes. Ceci dans une approche proactive pour éviter des malentendus, des frustrations, voire des dommages.
Voici la nature des réactions possibles :
■ Le déni. Dire que tout est faux. L’entreprise se place sur la défensive. Elle doit rétorquer avec des données précises pour éteindre le feu.
■ L’intimidation. L’insulte. La confrontation. L’entreprise s’en prend à ceux qui l’accusent pour tenter de les faire taire ou de nuire à leur crédibilité.
■ La menace. Cette stratégie conduit rapidement aux recours judiciaires, forçant ainsi la partie adverse à divulguer tous les faits ou à se rétracter.
■ L’insinuation. Sous le voile d’une probabilité, l’accusateur laisse entendre qu’une situation pourrait s’être produite, mettant ainsi la partie adverse dans une position de défense. On accuse par association.
■ L’accusation. Pour se défendre, la partie accusée blâme l’autre pour ses déboires.
■ La défense. Elle prend les grands moyens pour démontrer que les accusations sont fausses.
■ La revendication. Il peut s’agir de droits, d’usages, d’exceptions, de conditions exceptionnelles.
■ La vengeance. L’entreprise prend des moyens physiques ou psychologiques pour nuire à celui qui l’accuse.
■ La nuance. Tout n’est pas blanc ou noir. Il y a du gris. Alors, on invoque des circonstances plausibles qui auraient mené au litige.
■ L’attente. L’ignorance. L’entreprise ne fait rien, en espérant que le temps arrangera les choses, que les médias et le public oublieront vite. Elle se cache en attendant que la tempête passe.
■ La reconnaissance. La stratégie consiste à admettre son erreur, tout simplement. L’entreprise fait son mea culpa dans l’espoir d’atténuer les risques et de mettre fin à l’histoire rapidement afin de regagner la confiance de ses publics.
■ L’aveu. L’excuse. L’entreprise admet ses déboires, en accepte l’entière responsabilité et va plus loin en exprimant ses regrets et en annonçant des mesures de redressement.
Chacun de ces choix ou toute suite de choix aura des conséquences d’abord sur la réputation de l’entreprise, puis sur ses produits et services, et enfin, sur la confiance qu’elle a bâtie avec ses publics. Le temps qu’elle prendra et la façon dont elle réagira auront également des répercussions sur l’image de l’entreprise et sur ses dirigeants. Elle ne peut pas se permettre un faux pas. La direction devra évaluer soigneusement les conseils de son relationniste, qui sera responsable de la suite des choses.
1.4 Les concepts utiles dans la gestion de ces cas
La controverse interpelle des concepts et des principes issus des valeurs d’une société démocratique dans laquelle l’entreprise exerce son mandat. À cet égard, l’entreprise est assujettie à des principes de gouvernance, elle s’inscrit dans son environnement social, culturel et professionnel. Elle projette ainsi une image de respect et d’équité envers ses employés, en plus de démontrer sa capacité à être compétitive en ce qui a trait à ses produits et services.
Dans ses agissements, la direction doit tenir compte de concepts et de principes qui gouvernent tout organisme, tant sur la scène locale que planétaire.
1.4.1 Le contrat social (l’acceptabilité sociale)
Jean-Jacques Rousseau évoquait la notion de souveraineté populaire comme modèle de démocratie. Tout projet de société devrait, dans un monde idéal, obtenir l’appui des citoyens. Aussi, les élus et les dirigeants d’entreprise devraient tenir compte des préoccupations des citoyens en les consultant. Le citoyen se préoccupe des impacts sociaux d’un projet proposé dans son voisinage, dans sa ville, sa région, sa province et son pays. Ses préoccupations s’expriment parfois par une lettre à la rédaction du journal local, un sondage d’opinion, une pétition, une manifestation, un référendum, une vidéo publiée sur YouTube, une discussion sur un blogue ou par le lancement d’un mouvement de protestation sur Twitter. Souvent, l’accord des citoyens à un projet d’entreprise ou gouvernemental s’exprime tacitement. Si les gens ne s’opposent pas publiquement, on présumera que le projet relève du bon sens. Les élus et les chefs d’entreprise veulent à tout prix éviter la grogne pour ne pas nuire à leur popularité ou à leur chiffre d’affaires. On a vu des projets avortés en raison de l’effet de surprise produit dans l’opinion publique, par des citoyens qui manifestaient avec véhémence leur désaccord ; ils n’avaient pas été consultés.
Ce concept se résume en un « assentiment de la population à un projet ou à une décision résultant du jugement collectif que ce projet ou cette décision est supérieur aux alternatives connues, incluant le statu quo » (Gendron, 2015, p. 119).
Donc, cette notion de contrat social, ou d’acceptabilité sociale, renvoie à l’ethos, c’est-à-dire à cet ensemble moral qui commande le respect de la volonté du public sur tout projet et toute décision qui lui semblent contraire à ses valeurs, à ses préoccupations et à ses besoins. Les exemples sont nombreux : le projet énergétique du Suroît et celui des gaz de schiste, les accommodements dits « raisonnables », le registre des armes à feu, les dépenses excessives des gouvernements, le contrôle hydroélectrique du Nouveau-Brunswick par Hydro-Québec, le Plan Nord et les Innus de la Côte-Nord, le projet d’oléoduc entre l’Alberta et Kitimat en Colombie-Britannique, et la centralisation d’un marché canadien des valeurs mobilières.
1.4.2 Le contrat moral
Cet énoncé, au contraire de la dimension légale, fait écho à l’éthique, c’est-à-dire aux normes de comportement. Dans l’appareil gouvernemental, à tous les échelons, ce concept prend toute son importance. Les règles d’éthique et de communication entre le siège du gouvernement, les ministres et les fonctionnaires ne sont pas les mêmes. Un gouvernement centralisateur sur le plan des communications, comme celui de l’ancien premier ministre Harper, enfreint les limites qui assurent l’indépendance de la fonction publique. Celle-ci doit garder sa neutralité et ne pas glisser dans la propagande de l’idéologie politique du gouvernement au pouvoir.
La communication responsable est plutôt rattachée à la communication institutionnelle et doit toucher la conscience civile de l’individu : « La communication de marque doit la compléter en instaurant un véritable “contrat moral” avec le consommateur. L’entreprise se retrouve donc dans une situation délicate où sa communication et ses actions doivent être responsables tout en intégrant ses impératifs de compé...