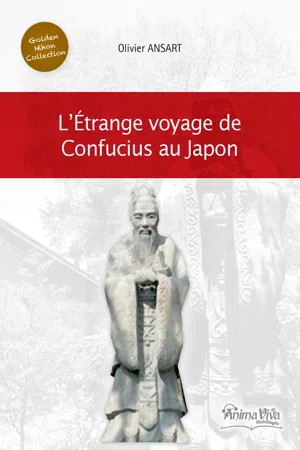
eBook - ePub
L'étrange voyage de Confucius au Japon
- 140 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
L'étrange voyage de Confucius au Japon
À propos de ce livre
Ce livre va à l'encontre des idées reçues. Il se propose de montrer que, si le Japon a adopté les valeurs et le vocabulaire du confucianisme, ceux-ci ont été impuissants à modifier en profondeur la société japonaise. Demeuré à l'écart du monde sinisé, le Japon n'a jamais écouté que ses propres traditions, quitte à les expliquer dans le vocabulaire prestigieux du confucianisme.Parution en français et en anglais; livre et e-book.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à L'étrange voyage de Confucius au Japon par Olivier Ansart, AnimaViva multilingüe AnimaViva multilingüe en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Sciences sociales et Sociologie. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
Les discours confucianistes au Japon : orthodoxie et innovation
Ces conditions a priori favorables à l’émergence de positions originales ont-elles tenu leurs promesses ? Avant de relever un certain nombre de différences théoriques entre les confucianismes chinois et japonais, deux remarques s’imposent. La première est qu’il ne s’agit en aucun cas de les opposer en bloc pour ainsi dire. Des tonalités particulières, des thèses originales peuvent être découvertes dans les discours des érudits confucianistes sur l’archipel, mais aucune d’elles ne prétend représenter le confucianisme japonais, parce que, dans tous les cas, bien d’autres thèses et tonalités différentes ou rivales existent.
La deuxième est que ce survol ne prétend pas à l’exhaustivité : les paragraphes qui suivent seront concentrés sur les différences effectivement chargées d’une influence, immédiate ou indirecte, sur les pratiques. Seront en conséquence laissées de côté des différences souvent repérées, parce qu’elles paraissent trop abstraites pour être vraiment significatives. Ainsi, de nombreux chercheurs ont remarqué que plusieurs notions de base du vocabulaire confucianiste ont pris des sens différents au Japon. Le concept de « voie », semble-t-il, a plus souvent désigné un système objectif qu’une illumination spirituelle ; le « ciel » a été conçu comme une instance extérieure plutôt que comme une dimension pénétrant toute chose, jusqu’au « cœur » des humains ; la « raison des choses » n’était pas forcément associée à la nature humaine ; la notion clé en Chine de « culture morale » (xiuyang, shûshin) faisait l’objet de moins d’attention, etc. Ces différences, nous nous contentons de les mentionner pour concentrer notre attention sur d’autres divergences, davantage liées aux pratiques.
L’amour des formes
Surtout quand ils sont tenus par des penseurs issus de la classe des guerriers, les discours japonais mettent souvent l’accent sur les formes ou les apparences des attitudes et des comportements. En voici deux exemples :
L’idée que la distribution des biens dans la société doit entièrement s’effectuer en fonction de la structure sociale préexistante est courante dans les sociétés de statuts : on considèrera qu’un homme doit porter tel vêtement, qu’il doit manger telle nourriture, absorber telle boisson, habiter tel genre de maison, disposer de tels meubles, se transporter de telle manière, avoir tel nombre de serviteurs, jouir de tels objets, non parce qu’il en a les moyens financiers acquis sur le marché, ni parce qu’il en a envie, mais simplement parce que ces objets expriment très exactement sa position dans la structure sociale.
Plusieurs auteurs japonais ont laissé sur ce sujet des exposés extraordinairement détaillés, fascinants parce qu’ils expriment l’angoisse des guerriers confrontés à une érosion progressive de leurs moyens d’existence et crispés de ce fait même sur les marques extérieures de leur supériorité.
Pour le plus illustre des penseurs politiques de l’époque, cette distribution des biens en fonction de la structure sociale est même le premier objet du système politique :
Fixer des degrés dans les vêtements, les maisons, les objets, dans les mariages, les funérailles, les échanges de correspondances et de cadeaux, la composition des escortes, tout ceci en fonction de la qualité des personnes, de leurs revenus et de l’importance des fonctions, cela s’appelle un système. [...] Si la consommation est réglée en fonction des conditions sociales, chacun connaît la sienne. (Ogyû Sorai.)
L’habit est sans conteste l’objet de consommation qui manifeste avec le plus de précision les distinctions sociales, jusque dans la vie quotidienne. Ogyû Sorai lui consacre de longues pages : les guerriers ne devraient pas porter de vêtements de chanvre, sans doute en souvenir du temps où ils étaient de condition paysanne ; le chanvre sera donc réservé aux conditions inférieures. « Comme en toute chose, il faut d’abord définir les grandes lignes, puis voir les petites choses. Les citadins et les paysans doivent porter du chanvre et du coton. Les vieillards et les femmes peuvent porter le pongé de soie. Mais dans les cotons, il ne faut pas porter ces étoffes qui ne provoquent que de la confusion comme le santomejima, le kanakin, ou le tômomen. » (PG, 341.) Pour pallier la malheureuse absence de distinctions adéquates dans le vêtement, l’auteur s’engage dans des discussions quelque peu inattendues dans un traité de politique, mais symptomatiques de son approche.
S’il est moins disert sur les modalités de répartition des autres biens de consommation, il n’en souligne pas moins que des dispositions analogues devraient être prises pour toutes les catégories de biens et de marchandises. Ce qu’il faut éviter à tout prix c’est une situation, que l’émergente économie de marché tend à encourager, où « pour peu qu’ils aient de l’argent, les bourgeois puissent avoir les mêmes habits, les mêmes nourritures, les mêmes demeures, les mêmes objets que les grands feudataires. » (PG, 328.) Lorsque, dans une situation de consommation libre, uniquement dépendante du pouvoir d’achat, l’ordre des distinctions sociales se défait, le monde tombe dans l’anarchie.
Dans la société dont rêve cet auteur, l’économie, entendue comme la distribution et la répartition des biens dans la population, est fonction de la structure sociale, non des moyens, ou des efforts, des mérites ou du succès.
Une autre expression de ce souci des formes se rencontre dans certaines approches de la régulation des comportements. De nombreux auteurs, dans l’esprit du néoconfucianisme, prônaient une sorte d’ascèse de tous les moments pour purger l’esprit (l’intériorité) de toute mauvaise pensée. Surveiller les comportements extérieurs ne suffit pas ; il convient aussi de contrôler les pensées intimes et les rêves secrets. Des désirs non encore formulés se trouvent parfois à la source de grands crimes (Yamasaki Anzai). Ces penseurs imposèrent une discipline de la surveillance dans l’intimité (shindoku), même pour qui se trouve à l’abri des regards. D’autres mirent en évidence la « vertu cachée » ou « vertu de l’ombre » (intoku), qui ne craint jamais l’exposition de ses plus intimes secrets, puisqu’elle cherche le bien, fuit le mal et les désirs, même lorsqu’elle est assurée du secret (Kaibara Ekken).
Cependant, une position diamétralement opposée, de fait beaucoup plus originale, ne considérait que les gestes et comportements publics et ménageait aux sentiments du for intérieur la liberté d’un espace privé.
Pour la voie des sages, même si de mauvaises pensées apparaissent dans le cœur, pour autant que les règles et les rites soient respectés, que ces mauvaises pensées ne grandissent point et qu’aucun mal ne soit fait, on reste un homme de bien. De mauvaises pensées naissent dans le cœur, mais aucun délit n’est accompli. Celui qui, du fait de mauvaises pensées, enfreint les rites et les règles et commet quelque mauvaise action, celui-là est un homme de peu. Voir une belle femme et apprécier son charme dans son cœur, c’est là un sentiment tout humain. Mais se laisser aller à cette émotion, enfreindre les rites et les règles, et folâtrer oublieux de tout avec la femme d’un autre, voilà le fait d’un homme de peu. Respecter les rites et les règles et contrôler ses sentiments, ne pas s’amuser avec une femme qui ne serait pas sa femme, voilà le fait d’un homme de bien. Le bien et le mal viennent de ce que l’on a ou non pris des libertés avec cette femme. Il n’y a pas à censurer le fait que l’émotion soit apparue. (Dazai Shundai.)
L’auteur de ces lignes est issu de la classe des guerriers. Il n’est pas nécessaire de recourir à la prétendue explication d’une « influence » des penseurs légistes, que Dazai Shundai a effectivement lus : cet accent mis sur les formes est un thème constant dans la société guerrière, obsédée par les apparences, les fictions, et toujours capable de fermer les yeux sur la réalité pour peu que les formes soient respectées. Cette anecdote est instructive : à un chef de village qui se plaignait que certains de ses administrés faisaient mine d’être vertueux dans l’espoir d’obtenir une récompense, un guerrier rétorqua : « mais c’est très bien, c’est tout ce qu’il faut : prétendre. »
Filialité ou loyauté
Si frappant soit-il, l’accent mis sur les formes, que ce soit pour distinguer les statuts ou pour identifier l’objet des jugements moraux (les états d’âme ou la conduite), ne relève pourtant que de ce que l’on peut appeler les tonalités particulières des discours confucianistes au Japon. Il ne constitue pas une théorie originale.
La division en statuts et la présence d’un ordre militaire eut cependant aussi un impact plus important, cette fois sur les conceptions de l’obéissance. Celles-ci prirent au Japon des orientations parfois si différentes que les spécialistes, oubliant la grande variété des positions énoncées sur ce problème, se sont souvent accordés pour dire que c’est en ce point que résidait la différence majeure entre les discours confucianistes tenus dans les deux pays.
Pour les Entretiens, la piété filiale (ch. : xiao, j. : kô) est l’obéissance fondamentale. Elle prévaut sur les loyautés (ch. : zhong, j. : chû) qu’on pourrait appeler « politiques », qui sont dues au seigneur, au prince, au roi ou à l’empereur. Les dirigeants de l’Empire du Milieu, sans doute, n’apprécièrent pas tous cette attitude. Et les auteurs légistes, pour leur part, mirent l’obéissance aux lois au-dessus de toute autre forme de soumission. Il n’empêche : pour le courant confucianiste en Chine, la piété filiale était l’obéissance fondamentale, celle sur laquelle reposait l’ordre social.
Cela ne signifie pas que les relations entre les deux types d’obéissance étaient nécessairement conçues en termes de conflit. Les auteurs chinois pouvaient fort bien imaginer des cas de tensions entre l’obéissance due au père et celle due à l’empereur. Cependant, comme Confucius, la plupart pensaient que l’obéissance au père, étant au fondement du respect de l’ordre, assurait au souverain des sujets dociles.
Dans les représentations de l’ordre politique existait donc une forte continuité, depuis la famille du plus humble de ses sujets jusqu’à l’empereur. La même logique fondée sur une vertu individuelle traversait tout l’ordre politique. De fait, les ministres, quelle que fût leur importance, devaient se retirer des affaires pour observer le deuil après le décès d’un parent. L’objet ultime de l’obéissance politique, l’empereur lui-même, censé gouverner seulement par l’exemple de sa vertu, devait donner l’exemple de la parfaite loyauté filiale. « Qui s’est perfectionné lui-même peut mettre en ordre sa famille, qui peut mettre en ordre sa famille peut mettre en ordre le pays, qui peut mettre en ordre le pays peut mettre en ordre le monde », lit-on dans la Grande Étude, classique du confucianisme.
Au Japon, les guerriers, qui dominaient la structure politique, ne cachaient pas, et ne pouvaient d’ailleurs cacher, qu’ils avaient accédé au pouvoir et qu’ils le conservaient par la seule force des armes, non du fait de leurs vertus et de leur piété filiale. Il leur fallait donc poser le problème de l’obéissance en des termes différents. Hors quelques situations particulières, rencontrées à l’intérieur des clans guerriers, lorsque les vassaux étaient liés à leur maître par les liens du sang, la scission entre le domaine naturel par excellence de la famille et la puissance politique autoritairement accaparée par les guerriers était telle que l’obéissance due aux parents (kô) et celle due au seigneur (chû) n’étaient pas mutuellement assimilables. Un choix entre kô, la piété filiale, ou chû, la loyauté au maître du domaine était donc concevable, voire même parfois inévitable.
D’une certaine façon, ce conflit entre la piété filiale et la loyauté due à une instance politique était inscrit dans l’ordre politique japonais. Bien sûr, les conflits entre le père et le seigneur qui auraient forcé le guerrier à choisir, étaient rares. En termes confucianistes cependant, le service militaire, qui impliquait le danger de la guerre, était une marque de non-filialité : il exposait les fils à la mort, et donc à l’impossibilité de veiller sur leurs parents dans leur vieillesse et de leur rendre les rites après la mort. Les classiques confucianistes allaient jusqu’à déconseiller les voyages aux fils dont les parents vivaient encore. Là se révèle la profonde incompatibilité entre le mode de vie de la classe dominante japonaise et la vertu de base du confucianisme : qui s’expose délibérément aux dangers ne saurait être un bon fils.
S’appuyant sur ce fait, beaucoup d’observateurs ont considéré que la grande différence entre les confucianismes chinois et japonais résidait dans cette opposition entre deux conceptions de l’obéissance : l’une, due au maître, aurait été prioritaire sur l’archipel ; l’autre, due au père, l’aurait été sur le continent.
En fait, ce conflit potentiel fut au Japon source de positions très diverses ; la conscience de la tension et la nécessité de la traiter avaient ouvert une boîte de Pandore. Les situations individuelles, les conflits d’intérêt, les tensions avec d’autres impératifs et normes étaient trop complexes pour que ne s’exprimât pas une grande variété de points de vue, plus caractéristique encore que l’accent sur la loyauté au seigneur. Certains reprenaient des vues déjà émises en Chine ; d’autres innovaient : ils accordaient à la loyauté politique une indiscutable prééminence, ou, à l’inverse, rejetaient l’idée même d’obéissance. On va le voir brièvement.
Les valeurs rivales : honneur et bien public
L’idéal confucianiste hissant la piété filiale au rang d’obéissance fondamentale avait en fait ses soutiens. Muro Kyûsô, figure très importante, proche du gouvernement militaire, affirmait qu’un homme ne devrait jamais trahir ses parents même s’ils ont agi contre les ordres ou les lois de leur seigneur. Mais il est vrai que de nombreux auteurs, au contraire, proclamaient que la loyauté du guerrier, et, plus largement, de tout Japonais, était avant tout due à une autorité politique entendue de manière large, c’est-à-dire « extra-familiale » : celle du seigneur (daimyô) ou du gouvernement (bakufu) et de son chef, le généralissime (shôgun).
Mais cette dernière attitude est loin d’être monolithique ; en fait, elle éclate aussitôt en une multitude de positions. S’opposent d’abord différentes explications et interprétations originales de la relation entre les deux formes d’obéissance, politique ou familiale, et de la priorité donnée à la première. Certains affirment qu’elle résulte de la volonté des parents, ou de ce que la piété filiale bien comprise exige ; la loyauté au maître politique devient en conséquence obéissance aux parents : voilà élégamment écartée toute possibilité de conflit avec le discours du confucianisme. D’autres prétendent que la loyauté due à l’autorité politique est au fond la seule vertu, qu’elle suffit pour les remplacer toutes, puisque le subordonné s’en remet totalement à son maître. Yamazaki Anzai, pour sa part, déclare qu’il ne saurait exister de mauvais maître ou de mauvais père. Visiblement, il suppose qu’il n’existe qu’une manière d’être juste et bon ; il exclut donc toute possibilité de conflit entre la soumission au père et celle au maître politique.
L’objet de la loyauté politique fait ensuite l’objet d’interprétations différentes : d’un côté, une loyauté encore très personnelle au seigneur (daimyô) dont le guerrier, voire le roturier, dépend directement ; de l’autre une loyauté plus strictement politique due au shôgun, et plus tard, dans un discours qui mélange des notions empruntées au shintô et au confucianisme, à l’empereur.
L’écart entre les deux objets, seigneur féodal et gouvernement militaire du bakufu, subsista jusqu’au bout, mais la différence de nature qui les séparait s’estompa de façon considérable au cours de la période des Tokugawa, au fur et à mesure que l’autorité des daimyô sur leurs guerriers et leurs sujets devenait plus anonyme et bureaucratique.
Le plus célèbre parmi les multiples « récits de loyauté » illustre parfaitement le conflit : quarante-sept « vassaux loyaux » entrèrent dans la légende pour avoir vengé leur seigneur en assassinant l’homme qui se trouvait à l’origine de sa perte ; ils furent condamnés à mort par le shôgun pour avoir enfreint ses ordres (il avait lui-même ordonné à leur seigneur de se suicider car, pour des raisons qui restent obscures, il avait attaqué un autre daimyô). Un long débat parmi les érudits confucianistes s’engagea afin de déterminer s’ils avaient eu tort ou raison, et à ...
Table des matières
- Sommaire
- Golden Nihon Collection
- Introduction
- Confucianisme ou confucianismes ?
- La pensée morale dans les Entretiens
- Le confucianisme après Confucius
- Le confucianisme et l’organisation sociale
- Introduction et diffusion du confucianisme au Japon
- Les discours confucianistes au Japon : orthodoxie et innovation
- Usages et rôles des confucianismes
- Pour conclure : Confucius aujourd’hui
- Publications d’anima Viva multilingüe
- Page de copyright