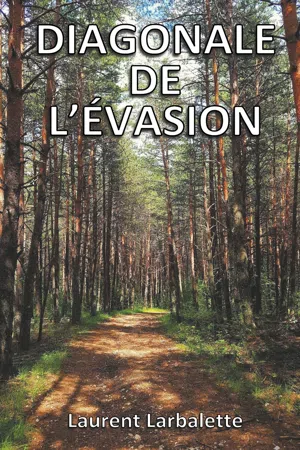![]()
Mardi 27 juin 2017, là où tout a commencé.
Une signature en bas d’une page et dans trois mois, j’aurai cessé mon activité professionnelle. Je passerai d'un statut de cadre en entreprise stressé, asphyxié, au bout de sa vie, à une situation d'homme oisif mais enfin libre.
Libre, pour autant qu'on puisse l'être dans notre société moderne qui organise collectivement nos vies, structure nos journées et cadence notre quotidien réglé comme du papier à musique. Libre, pour autant que je puisse accepter cette soudaine rupture dans mes habitudes, dans mes relations, dans les responsabilités qui étaient les miennes, avant.
Oh, ce n’était pas une fin de carrière rêvée ! Après plus de trente-sept années de service dans la même société, je sortais par une petite porte que l’on m’avait ouverte certainement avec privilège, quelques mois avant ce qu’on appelle « la retraite », celle qui sonne habituellement comme une récompense méritée de fin de vie professionnelle, ou que l’on peut voir aussi comme une mise à l’abri, à l’écart de la bataille qui va continuer sans vous. D’ailleurs peut-on vraiment idéaliser une fin de carrière ? Pourquoi alors aurait-on inventé tous ces stratagèmes faits de stages de futurs retraités où l’on vous explique ce qu’il faut faire de vos jours pour ne pas déprimer, quand votre entreprise ne pourra plus, à votre place, gérer votre vie ? Moi, j’allais sortir par une petite ouverture que d’autres auraient bien aimé emprunter. Je n’étais pas à plaindre, mais je n’avais pas de quoi en tirer la moindre gloire.
Je savais ce qui m’attendait. Eviter le vide, le néant. J'avais encore du temps pour la réflexion, pour trouver un projet qui me permettrait de vivre sans douleur cette brutale transition.
Etonnamment, il ne m'avait fallu qu'un séjour dans les montagnes d’Ardèche, dès les premiers jours de juillet, à parcourir les sentiers pentus et caillouteux sous les châtaigniers, m'imprégnant à chaque sortie de la poésie nostalgique de Jean Ferrat, pour retrouver une santé physique et morale qui me faisait défaut, et pour comprendre définitivement que la marche en montagne était le meilleur des remèdes pour le corps, le cœur et l'esprit.
Une semaine de soins intensifs, à expulser par tous les pores de ma peau les toxines mentales qui m'étouffaient peu à peu. J’avais besoin d’évasion.
Il m'avait fallu cette semaine aux bienfaits immédiats et une étincelle, un catalyseur, quelques jours plus tard, sur le chemin retrouvé du travail, dans ma voiture. Ce jour-là, l'invité du 6/9 de France Inter était Sylvain Tesson. Il venait présenter les chroniques hebdomadaires qu'il allait proposer aux auditeurs durant l'été. Un été avec Homère ne retint pas mon attention. Par contre, la question d'une auditrice au sujet de son livre « Sur les chemins noirs »1 et bien plus encore, la réponse de l’auteur, m’avaient interpellé. Je buvais les paroles de Sylvain Tesson comme de l’eau de source claire. Si l’homme écrivait aussi bien qu’il parlait, ce devait être jouvence que de le lire. Jamais, je n’avais entendu quelqu’un parler ainsi de l’itinérance.
Je trouvais sans difficulté son ouvrage le soir même et le dévorais en quelques jours. Et comme un élève trouve un maître qui le guide, j’avais trouvé mon projet pour ouvrir la porte de cette nouvelle vie que je voulais plus belle.
Partant du principe purement matériel, que si Sylvain Tesson avait pu traverser la France du Col de Mente à la pointe du Cotentin dans l'état physique où il se trouvait à sa sortie de cinq mois d'hôpital, moi, qui n'étais ni cassé, ni réparé de toutes parts, et qui ne souffrais pas d'épilepsie, je devais bien pouvoir me lancer dans une aventure bien plus modeste que la sienne, mais toutefois hors du commun. Moi aussi, je pouvais vivre une belle histoire qui m’aiderait à me construire un autre avenir.
Ma décision était prise en quelques jours. Je partirai de Menton, tout près de la frontière italienne et je rentrerai à pied chez moi, à Montmorillon.
Je ne savais pas encore quelle distance j'aurai à parcourir, ni combien de temps il me faudrait pour le faire, ni quels chemins j'allais emprunter, mais j'étais convaincu de la faisabilité de mon projet. Mon projet comme une cible de laquelle je ne pourrai pas me détacher sans l’avoir atteinte en son centre. Comme Tesson, je me rendrai à mon point de départ en train. Comme lui, j'emprunterai les sentiers plutôt que les routes, et je m'efforcerai de cheminer au cœur de ces contrées caractérisées par leur appartenance à l'hyper-ruralité où les espaces naturels sont préservés et où la densité de la population est dans les plus basses de France. J'éviterai les routes, surtout les plus larges, et les villes autant que possible et je serai en autonomie totale, n’emportant sur mon dos que ce qui me sera nécessaire pour faire le trajet jour après jour.
Cependant, mon goût pour le risque étant moins marqué que Tesson et mon expérience de la longue randonnée étant absolument nulle, je m’étais fixé comme critères incontournables de dormir sous un toit et dans un lit chaque soir, et de prendre une douche après chaque journée de marche. Ces points, qui passeraient pour être de grand confort aux yeux de certains, me semblaient être un minimum pour pouvoir bien récupérer chaque nuit, me sentir bien dans ma peau et surtout éviter les aléas climatiques et les galères qui pouvaient en découler. Les nuits en plein air sous la pluie, non merci ! Je pouvais même avancer mon âge comme argument, à moins que ce ne fut qu’une excuse.
Contrairement à Tesson, je décidais de ne pas me priver de l’aide de la technologie pour autant qu’elle ne se substituait pas aux efforts que j’allais devoir fournir. J’avais appris depuis longtemps à planifier mes randonnées en utilisant les capacités des smartphones pourvus d’un GPS. Je savais que cet outil pouvait remplacer avantageusement bon nombre de cartes topographiques de l’IGN. Un rapide calcul me permettait d’ailleurs de mesurer le prix, le volume et le poids que représentait une cinquantaine de cartes au 1/25000ème, sachant qu’il m’en faudrait une nouvelle de cinquante grammes chaque jour en moyenne. J’aurai autre chose à emporter que 2,5 kilogrammes de papier coloré.
C’est sur une tablette numérique que je m’attaquais à cette première phase de mon projet inédit : trouver mon chemin idéal et le faire s’arrêter chaque fin de journée dans un lieu accueillant où je pourrais dormir à coup sûr, et si possible me nourrir.
Entendez par là que j’aurai pris le soin de réserver une chambre où je serai attendu à la bonne date. La sécurité apportée par la réservation du gite avait une contrepartie. Ou plutôt une contrainte : celle de devoir faire à pied le chemin jusqu’à lui à la bonne date, celle de la réservation. Mais n’était-ce pas là l’objet premier de mon entreprise : marcher d’un point à un autre ?
Si je m'accordais, parfois contraint, de suivre des chemins noirs tels que Tesson les décrit, ces traits noirs fins comme des cheveux, parfois même en pointillés, dessinés sur les cartes IGN, je rejetais l’idée du hasard entre deux étapes. Je voulais limiter le risque de devoir rebrousser chemin, bloqué par une rivière, un maquis impénétrable ou une barrière rocheuse infranchissable. Je voulais éviter les détours conséquents, sachant par expérience que bon nombre de ces vieux chemins ruraux, de moins en moins entretenus par les agriculteurs qui n’en ont plus l’utilité, ont cessé d’exister ou ne sont plus praticables. Ainsi, je décidais de me concentrer sur les traits rouges, ou roses selon l’échelle des cartes, qu’on nomme des sentiers de randonnée et qui, en général, font l’objet d’un entretien régulier et d’un balisage plus ou moins matérialisé sur le terrain. Certains portent des numéros ou des noms. Ce sont les GR, les chemins de Grande Randonnée, les GRP ou PR, chemins de pays. Ceux-là vous garantissent, en théorie, un cheminement à la praticabilité assurée. Lorsque ces lignes de couleur sont tracées en pointillés, le sentier est répertorié mais son accessibilité est moins certaine et le balisage parfois inexistant. Je m’en contentais. Avec un GPS, on peut s’égarer, mais on ne peut pas se perdre.
En partant de Menton, les pieds dans la Méditerranée, je dessinais mon chemin, point par point, sur les cartes au 1/25000ème, m’appuyant parfois sur les photos provenant de l’imagerie satellite pour vérifier la présence réelle d’un chemin, lorsqu’il n’était pas masqué par les arbres le bordant, ou d’un sentier dessiné, dans la montagne, par le piétinement des randonneurs.
Je décidais, surtout en zones montagneuses où le dénivelé ajoute de la difficulté à la marche, de limiter mes étapes à vingt-cinq kilomètres. Il me fallait donc trouver un hébergement sans trop m'écarter des sentiers balisés, tous les vingt à vingt-cinq kilomètres. Je pouvais pousser jusqu’à trente, voire trente-cinq.
Durant tout l'été 2017, j'allais ainsi dessiner ce chemin mètre après mètre et rechercher sur les plateformes de réservations accessibles par internet, dans les hameaux, les villages, les villes, la disponibilité présumée de chambres d'hôtes, d'hôtels, de campings ou de gîtes d'étape.
Il y avait là un paradoxe. Je voulais à la fois évoluer dans la nature la plus sauvage, la plus préservée, celle qu’on trouve au cœur de cette ruralité profonde qui se caractérise par l’absence notoire d’habitants, et, à la fois, trouver sur mon chemin sans faire trop d’écarts, ceux qui m’accueilleraient, contre rémunération bien évidemment. Fuir la civilisation, mais pas trop ! Voilà le dilemme.
Ma première résolution était de quitter la côte au plus vite. La montagne était mon alliée. A vingt kilomètres de la mer, l’arrière-pays niçois s’éparpille en petits villages typiques nichés dans les vallées ou sur des éperons rocheux. Sautant d’un GR à l’autre, le 52, le 510, le 4, le GRP de la Grande Traversée des Préalpes, le GR 6, je décidais de passer par Sisteron pour suivre la vallée du Jabron jusqu’au Mont Ventoux, au pays de Giono. En retrouvant le GR 4, je traverserai au plus vite la vallée du Rhône qui m’apparaissait être la partie la moins palpitante de mon voyage. Je prendrai ensuite une bonne bouffée d’Ardèche avant de cheminer sur les causses de Lozère et les plateaux du Cantal dans les pas de Tesson et de ceux d’Axel Kahn. A Bort-les-Orgues, il ne me restera plus que la haute Corrèze et la Haute-Vienne à traverser.
J’ai mis trois mois pour finaliser ma diagonale. Je comptais mes étapes. Elles étaient cinquante. J’analysais la longueur et le dénivelé de chacune, modifiais quelques-unes qui me semblaient trop dures, en supprimais une ici, divisais une autre là-bas. Je choisis la date de mon départ : ce sera le 12 juin au matin à Menton. Puis j’ai laissé reposer mon projet tout l’hiver. Mieux qu’un sommeil, une gestation. Le temps de me convaincre de l’impérieuse nécessité de le réaliser. Mais en avais-je douté vraiment ? D’y trouver une cause, s’il en fallait une. D’y donner une raison d’être et de me préparer mentalement dans un premier temps.
« Les ruptures, écrivait Nietzsche, sont difficiles, parce qu’il fait souffrir, le lien qui se détache. Mais à sa place, bientôt, il nous vient une aile. » écrit Frédéric Gros dans Marcher, une philosophie2, dont je ne saurais que trop recommander la lecture à tous ceux qui veulent comprendre pourquoi tant de marcheurs trouvent la plénitude sur les sentiers. Toute rupture est pour partie souffrance, avant qu’elle ne dévoile une ouverture vers un horizon nouveau.
Si rupture subie il y a, il faut bien vite réagir et s’obliger à se créer des ruptures encore plus marquées, plus intenses, mais voulues et totalement maitrisées. En quelque sorte, soigner le mal par le mal. Puisqu’on m’impose un changement dans ma vie, je dois aller chercher au plus profond de moi les ressources pour réaliser quelque chose d’encore plus exigeant que ce qui m’est imposé. Ainsi, je garde la main. Je reste maître de la situation.
Le sport était une solution envisageable. Il ne requiert rien d’autre que son corps et sa tête. Il est accessible pour peu qu’on s’en donne les moyens. Mais le sport est pernicieux. Il crée les conditions d’une dépendance pour le néo-sportif, une nouvelle addiction dont il ne sortira un jour qu’à l’occasion d’une nouvelle rupture. Un cercle vicieux.
Ainsi, j’aurais pu courir. Enfin, plus que je ne le fais déjà. Courir nécessite de se faire violence. Mais courir après quoi ? Le chrono, la distance, la compétition ? Ou seulement courir pour soi, pour être bien dans son corps et dans sa tête, sans autre objectif que garder la forme, mais jusqu’à quand ? Il n’existe pas de coureur qui ne compare pas son chrono avec celui d’un autre ou qui ne mesure pas sa progression entre deux sorties.
Avoir un objectif réalisable est essentiel.
Il me fallait un projet qui me soit accessible et il m’apparaissait que la course à pied ne pouvait pas être celui-ci.
Marcher alors ? Et voyager, aussi ? Partir quoi !
Qui n’a pas un jour, depuis sa plus tendre enfance, rêvé de partir ? De s’évader de son monde. De quitter tout sur le champ et d’aller à l’aventure, découvrir d’autres lieux, d’autres cieux, d’autres dieux, que ceux qui, imperturbablement quadrillent nos petites vies bien carrées, faites d’éternelles répétitions.
Oui, mais partir cinquante jours ! N’était-ce pas hasardeux pour quelqu’un qui n’avait jamais cumulé plus de cinq jours consécutifs de petites randonnées plus ou moins pentues dans nos belles montagnes de France avec cinq kilos sur les épaules ? Bah ! Cinquante jours ne sont, ni plus, ni moins, que dix fois cinq jours. Lorsque le rythme est pris, tout doit se jouer dans le mental, me disais-je, pour me convaincre… Et puis, encore une fois, si d’autres l’avaient fait, pourquoi pas moi.
Oui, mais partir seul, c’est risqué ! Partir à deux alors, ne serait-ce que pour se porter mutuellement assistance ? Voilà qui rassurerait tous mes proches. Encore fallait-il trouver l’âme sœur qui pouvait être disponible et prête à sacrifier cinquante jours pour une aventure qu’elle n’avait ni décidée, ni construite. J’eus beau chercher - pas trop cependant - je n’ai trouvé personne. Et finalement, s’il ne m’arrivait rien sur les chemins du Poitou, pourquoi voulez-vous qu’il m’arrivât quelque chose ailleurs en France ?
C’est décidé. Vraiment. Je partirai seul de Menton le 12 juin et je marcherai cinquante jours pour revenir à Montmorillon.
Rentrer symboliquement chez moi. Partir du point le plus éloigné sur la circonférence fictive du cercle de son désir d’évasion et rejoindre son centre, point unique, clairement identifié.
![]()
Diman...