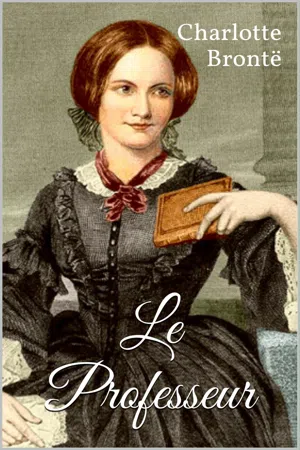
- 292 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
Le Professeur
À propos de ce livre
« Le Professeur » (titre original: « The Professor »), est le premier roman de l'écrivain anglais Charlotte Brontë. Écrit, à l'origine, avant « Jane Eyre » et refusé par plusieurs maisons d'édition, il est finalement publié à titre posthume en 1857. En France, il paraît pour la première fois en 1858.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informations
Chapitre XXV
Deux mois après, Frances avait fini de porter le deuil de sa tante. Le matin du premier janvier, je me rendis en fiacre avec M. Yandenhuten à la rue Notre-Dame-aux-Neiges, et, laissant mon compagnon dans la voiture, je montai vivement l’escalier. Frances m’attendait, vêtue d’une façon peu en rapport avec le froid sec d’une matinée d’hiver. Je l’avais toujours vue jusqu’à présent habillée de noir ou d’une étoffe de couleur sombre, et je la trouvais auprès de la fenêtre, portant une robe blanche d’un tissu diaphane. Rien n’était plus simple que sa toilette, et cependant ces plis nombreux et transparents qui flottaient autour d’elle, ce voile qui lui descendait jusqu’aux pieds, et que retenait dans ses cheveux une petite guirlande de fleurs blanches, avaient une élégance à la fois gracieuse et imposante. Chose singulière à dire, elle avait pleuré, et, lorsque je lui demandai si elle était prête, elle étouffa un sanglot en me répondant : « Oui, monsieur. » Je pris un châle qui se trouvait sur la table, je le plaçai sur ses épaules, et non-seulement ses larmes recommencèrent, mais encore elle trembla comme la feuille, en écoutant mes paroles. Je lui dis que j’étais désolé de sa tristesse, je la suppliai de m’en faire connaître le motif ; elle ne me répondit que ces mots : « Je ne peux pas m’en empêcher. » Puis, mettant sa main dans la mienne par un mouvement précipité, elle sortit de la chambre avec moi, et descendit l’escalier d’un pas rapide et mal assuré, comme une personne qui est pressée d’en finir avec une affaire redoutable. Je la fis monter dans la voiture, où M. Vandenhuten la reçut avec bonté ; nous arrivâmes à la chapelle protestante, d’où nous sortîmes mariés au bout de quelques instants.
Protégés contre les regards indiscrets par notre isolement et notre obscurité, il devenait inutile de nous absenter de Bruxelles, et nous allâmes tout de suite prendre possession d’une maisonnette que j’avais louée dans le faubourg le plus voisin du quartier où se trouvaient nos occupations.
Trois ou quatre heures après la cérémonie du mariage, Frances, vêtue d’une jolie robe lilas, plus chaude que la mousseline nuptiale, ayant devant elle un piquant tablier de soie noire, et au cou un joli ruban de la couleur de sa robe, était agenouillée sur le tapis d’un petit salon convenablement meublé, et rangeait sur les planches d’une étagère les livres que je prenais sur la table, et que je lui donnais un à un. Le temps avait changé tout à coup, il faisait froid et sombre au dehors ; le ciel couvert de nuages paraissait plein de tempêtes ; les piétons enfonçaient jusqu’à la cheville dans la neige qui tombait à gros flocons, et dont le pavé des rues était déjà couvert. À l’intérieur, tout brillait autour de nous ; la flamme de notre foyer pétillait joyeusement. Notre nouvelle habitation était d’une excessive fraîcheur ; meublée déjà depuis quelques jours, il ne restait plus à mettre à leur place que les livres et quelques menus objets de cristal ou de porcelaine. Frances y fut occupée jusqu’au soir ; je lui appris alors à faire une tasse de thé à la manière anglaise, et quand elle eut surmonté l’effroi que lui causait la vue de cette masse énorme de matériaux que je mettais dans la théière, elle me servit un véritable repas anglais auquel ne manquaient, je vous assure, ni bougie, ni bon feu, ni confort d’aucune sorte. Notre semaine de congé à l’occasion du nouvel an fut bientôt écoulée, et nous reprîmes notre travail avec plus d’ardeur que jamais, sachant que nous étions de simples ouvriers destinés à gagner notre vie par des efforts soutenus et un labeur continuel. Nous partions le matin à huit heures, et nous restions dehors jusqu’à cinq ; mais quel repos délicieux remplaçait chaque soir les fatigues de la journée ! Lorsque je regarde en arrière, je vois toujours nos soirées d’alors, m’apparaissant comme autant de rubis qui resplendissent an front ténébreux du passé.
Nous étions mariés depuis dix-huit mois ; un matin (c’était un jour de fête et nous avions congé), Frances, avec la soudaineté qui lui était particulière quand, après avoir pensé longtemps à une chose, elle voulait soumettre à mon jugement la conclusion à laquelle elle était arrivée, me dit tout à coup : « Je ne travaille pas assez.
Comment cela ? » demandai-je en levant les yeux avec surprise.
Au moment où elle m’avait adressé la parole, je tournais méthodiquement ma cuiller dans mon café, jouissant par avance d’une promenade que nous nous proposions de faire jusqu’à une certaine ferme où nous devions dîner. « Que veux-tu dire ? » ajoutai-je. À l’ardeur qui animait sa figure, je vis tout de suite qu’il s’agissait d’un projet important.
« Je ne suis pas contente de moi, répondit-elle ; vous gagnez huit mille francs dans votre année, et moi, j’en suis toujours à mes misérables douze cents francs. Je peux faire mieux que cela, et je veux y parvenir.
— Tu travailles autant que possible, Frances, tu ne peux pas faire davantage.
— Oui, monsieur ; mais je suis dans une mauvaise voie : il s’agit d’en sortir.
— Tu as un projet arrêté, ma Frances : va mettre ton chapeau, nous parlerons de cela en nous promenant. »
Elle alla se préparer, docile comme un enfant bien élevé ; car elle offrait un curieux mélange de douceur et de fermeté ; je pensais à elle, et je me demandais quel plan elle avait pu former, lorsqu’elle rentra prête à partir :
« Il fait si beau, dit-elle, que j’ai donné à Minnie (notre bonne) la permission de sortir. Aurez-vous la bonté de fermer la porte et d’en prendre la clef ?
— Embrasse-moi, Frances, » lui répondis-je.
La réponse n’était pas, je l’avoue, très en rapport avec la demande qui m’était faite ; mais cette chère Frances avait quelque chose de si séduisant avec sa fraîche toilette d’été, son petit chapeau de paille, et sa parole si naturelle et si suave, que mon cœur s’épancha en la voyant et qu’un baiser me devint indispensable.
« Voilà, monsieur ; êtes-vous content ?
— Pourquoi dire toujours monsieur ? appelle-moi William.
— Je ne peux pas prononcer votre W. D’ailleurs, monsieur est le nom que je vous ai donné tout d’abord, et c’est pour cela que je le préfère. »
La bonne étant sortie avec un bonnet blanc et un châle de toute couleur, nous partîmes à notre tour, abandonnant la maison à la solitude et au silence que troublait seul le tintement de la pendule. Nous fûmes bientôt dans les champs, au milieu des prairies et des sentiers, loin des routes poudreuses où retentissait le bruit des voitures. Tout à coup, au détour d’un chemin, nous nous trouvâmes dans un endroit si frais et si vert qu’on aurait pu se croire au fond de l’une des provinces les plus pastorales de l’Angleterre. Un banc naturel d’herbe moussue, abrité du soleil par un aubépin, nous offrait un siège trop agréable pour qu’on pût le refuser ; nous allâmes nous y asseoir, et, après avoir regardé les fleurs sauvages qui croissaient à nos pieds, je rappelai à Frances le projet dont elle devait m’entretenir.
Son plan n’avait rien que de très-simple. Il s’agissait de monter le degré qui se trouvait naturellement devant nous : elle avait l’intention d’élever un pensionnat. Nous avions déjà quelques avances, et nous pouvions commencer sur une modeste échelle. Nos relations étaient fort étendues, et pouvaient nous seconder avantageusement dans l’entreprise que nous projetions : car, bien que notre cercle de visites fût toujours très-restreint, nous étions connus comme professeurs dans un grand nombre de familles.
« Pourquoi ne réussirions-nous pas ! ajouta Frances, quand elle eut développé ses plans : si nous avons quelque succès, une bonne santé et du courage, nous pouvons réaliser une petite fortune ; et cela, peut-être, avant que nous soyons trop vieux pour en jouir. Alors nous nous reposerons ; et qui nous empêchera d’aller vivre en Angleterre ? » C’était toujours son rêve.
Je n’avais aucune objection à lui faire. Je savais qu’elle n’était pas de ces gens qui peuvent rester dans une inaction même relative : il lui fallait des devoirs à remplir, et des devoirs importants, quelque chose à faire d’absorbant et de profitable ; de puissantes facultés s’agitaient dans son cerveau, et réclamaient à la fois un aliment et un libre exercice. Je n’étais pas homme à les affamer ou à les retenir ; j’éprouvais au contraire une profonde jouissance à leur offrir un appui et à débarrasser la voie de tout obstacle, afin qu’elles pussent avoir une action plus étendue.
« Ton plan est bon, dis-je à Frances ; il faut l’exécuter ; non-seulement tu as mon approbation, mais encore, toutes les fois que tu auras besoin de monassistance, ne crains pas de la demander, tu es bien sûre de l’obtenir. »
Ses yeux me remercièrent avec effusion, deux larmes y brillèrent et disparurent aussitôt ; elle prit ma main qu’elle serra dans les siennes, et ajouta seulement : « Tu es bon, je te remercie. »
La journée se passa d’une manière délicieuse, et nous ne rentrâmes que bien tard, par un beau clair de lune. Dix années ont agité sur ma tête leurs ailes poudreuses et vibrantes ; dix années de tracas et d’efforts incessants, pendant lesquelles nous nous sommes lancés, ma femme et moi, en pleine carrière, avec cette activité dévorante que donne le tourbillon des affaires dans toutes les capitales d’Europe ; dix années de dureté envers nous-mêmes, et qui pourtant ne nous ont vus ni murmurer ni faiblir : car nous marchions l’un auprès de l’autre, en nous donnant la main, soutenus par l’espoir, secondés par la santé, encouragés par le succès, et triomphant de toutes les difficultés par l’accord de nos actions et de nos pensées. Notre maison ne tarda pas à devenir l’un des premiers pensionnats de Bruxelles. À mesure que nous élevions le prix du trimestre et que nous augmentions la force des études, nos élèves devenaient de plus en plus choisies, et finirent par se composer des enfants des premières familles de Belgique. Nous avions également d’excellentes relations avec l’Angleterre, grâce à M. Hunsden, qui, ayant profité d’un voyage à Bruxelles pour me reprocher mon bonheur dans les termes les plus durs, ne manqua pas à son retour de nous envoyer trois de ses parentes pour être polies, disait-il, par les soins de mistress Crimsworth.
Quant à cette dernière, ce n’était plus la même personne, bien qu’au fond elle ne fût réellement pas changée ; toutefois, elle différait tant d’elle-même, encertaines circonstances, qu’il me semblait presque avoir deux femmes. Elle conservait toujours, et dans toute leur fraîcheur, les qualités que je lui avais connues à l’époque de mon mariage ; mais d’autres facultés, en se développant, avaient jeté de puissants rameaux qui changeaient le caractère extérieur de la plante : la résolution, la fermeté, l’activité, couvraient de leur grave feuillage le sentiment poétique et la ferveur de la jeunesse, fleurs précieuses qui existaient toujours, fraîches et couvertes de rosée sous l’ombrage d’une végétation plus robuste. Peut-être étais-je le seul au monde qui connût leur existence ; mais elles conservaient pour moi leur parfum exquis et leur beauté à la fois chaste et radieuse.
Pendant le jour, ma maison était dirigée par mistress Crimsworth, une femme élégante et noble, au front large et pensif, à l’air sérieux et digne, que j’avais l’habitude de quitter immédiatement après le déjeuner. Elle descendait à la classe et j’allais à mes leçons ; je revenais dans le courant de la journée passer une heure chez moi ; je retrouvais Mme la directrice au milieu de ses élèves, silencieuse et attentive, surveillant tout ce qui se passait autour d’elle et se faisant obéir d’un regard ou d’un geste. Elle était alors toute vigilance et toute sollicitude. Faisait-elle un cours, sa figure s’animait ; son langage, toujours simple sans trivialité, clair sans sécheresse, intéressait vivement son auditoire, et, s’élevant parfois jusqu’à l’éloquence, entraînait les plus intelligentes de ses élèves, qui en conservaient une impression profonde. Elle faisait peu de caresses aux enfants qui lui étaient confiées ; néanmoins quelques-unes l’aimaient sincèrement, et toutes sans exception la contemplaient avec respect. Ses manières envers les élèves étaient généralement sérieuses, bienveillantes lorsqu’elle était satisfaite de leurs efforts, et toujours d’une distinction parfaite et d’une politesse scrupuleuse. Dans tous les cas où il lui fallait punir, elle aimait à user d’indulgence ; mais arrivait-il que l’élève abusât de sa bonté, un coup d’œil sévère lui apprenait immédiatement l’étendue de sa méprise, et l’avertissement que recevait la coupable avait, en général, le pouvoir de prévenir une nouvelle faute.
Quelquefois un rayon de tendresse venait briller dans son regard ; ses manières devenaient plus douces, sa voix plus affectueuse, lorsque, par exemple, une élève était malade ou regrettait la maison paternelle ; lorsqu’il s’agissait d’une orpheline ou d’une pauvre petite qu’une garde-robe insuffisante et le manque d’argent de poche rendaient pour ses compagnes un objet d’éloignement et de mépris. Elle les prenait alors sous sa protection et les couvrait de son aile ; pauvres déshéritées dont elle faisait l’objet de sa préférence ! C’était auprès de leur lit qu’elle passait chaque soir, pour s’assurer qu’elles y avaient bien chaud ; c’étaient elles qu’en hiver elle faisait placer auprès du poêle et que, chacune à son tour, elle appelait au salon pour leur donner un fruit ou un gâteau, pour les faire asseoir au coin du feu, les faire jouir des douceurs du foyer domestique, de la liberté qu’elles auraient eue chez elles, des bonnes paroles, des encouragements et des consolations que leur mère leur eût donnés ; elle voulait aussi que parfois les pauvres petites reçussent, avant de se coucher, un baiser maternel.
Quant à Mlles Julia et Georgiana, filles d’un baronnet anglais, à Mlle Mathilde, héritière d’un comte belge, ou à n’importe quelle fille de maison patricienne, la directrice était attentive à leurs progrès, soigneuse de leur bien-être ; mais il ne lui vint jamais à l’esprit de leur donner une marque de préférence. Elle en aimait une qui était pourtant de noble race, lady Catherine, jeune baronne irlandaise ; mais c’était à cause de son cœur enthousiaste et de son ardeur à l’étude, de sa générosité et de son intelligence ; sa fortune et son titre n’entraient pour rien dans l’affection que mistress Crimsworth ressentait pour lady Catherine.
Je passais donc toutes mes journées dehors, à l’exception d’une heure que ma femme réclamait pour son établissement, et dont pour rien au monde elle ne m’aurait fait grâce. Il fallait, disait-elle, que je me tinsse au courant de ce qui se faisait dans la maison, du caractère de ses élèves et du progrès des études, afin que je pusse m’intéresser aux choses qui l’occupaient sans cesse, et lui donner mon avis dans les cas difficiles. Elle aimait à s’asseoir auprès de moi lorsque je donnais mes leçons de littérature anglaise, et, les mains croisées sur ses genoux, à se montrer la plus attentive de tout mon auditoire. Il était rare qu’elle m’adressât la parole dans la classe, et elle ne le faisait jamais sans un air de déférence marquée ; c’était son plaisir et sa joie de me donner partout la première place et de faire voir que j’étais le maître en toute chose.
À six heures, mes travaux du jour étaient finis ; je revenais bien vite, à la maison, car pour moi c’était le ciel. Quand j’arrivais alors dans notre petit salon particulier, ce n’était plus Mme la directrice qui venait à ma réncontre ; mais Frances Henri, ma petite raccommodeuse de dentelle, qui, par magie, se retrouvait dans mes bras. Qu’elle aurait été désappointée, si son maître n’eût pas été fidèle au rendez-vous et n’eût pas répondu par un baiser au bonsoir qu’elle me disait d’une voix si douce !
Elle me parlait français et je la grondais bien fort ; j’essayais de la punir ; mais il fallait que le châtiment ne fût pas très-judicieux, car, loin de réprimer la faute, il semblait, au contraire, la pousser à la récidive. Nos soirées nous appartenaient complètement ; nous en avions besoin pour retremper nos forces et rafraîchir notre esprit. Nous les passions quelquefois à causer ; et, maintenant que ma jeune Suissesse aimait trop son professeur d’anglais pour le craindre, il lui suffisait de penser tout haut et d’épancher son cœur pour que la conversation fût aussi animée qu’intarissable. Heureux alors comme deux oiseaux sous la feuillée, elle me montrait les trésors de verve joyeuse et d’originalité que renfermait sa nature. Parfois, laissant jaillir la malice que recouvrait l’enthousiasme, elle raillait, la méchante, et me reprochait ce qu’elle appelait mes bizarreries anglaises, du ton incisif et piquant d’un démon qui badine en ses heures de gaieté. Toutefois ces accès de lutinerie étaient rares ; et si, entraîné moi-même à cette guerre de paroles où elle maniait si bien la finesse et l’ironie de la langue française, je me retournais vivement pour prendre corps à corps l’ennemi qui m’attaquait, vaine entreprise ! je n’avais pas saisi le bras du lutin qu’il avait disparu ; l’éclair provocateur avait fait place à un regard plein de tendresse qui rayonnait doucement sous des paupières demi-closes ; j’avais cru m’emparer d’une fée maligne, et je trouvais dans mes bras une petite femme soumise et suppliante. Je lui ordonnais alors d’aller prendre un livre anglais et de me faire la lecture au moins pendant une heure : c’était presque toujours du Wordsworth que je lui imposais pour la punir, ce qui la calmait immédiatement. Elle éprouvait quelques difficultés à comprendre ce langage sobre et profond qui la forçait à réfléchir ; il lui fallait alors me questionner, solliciter mon secours et m’avouer de nouveau pour son seigneur et maître. Son instinct s’emparait plus vite et se pénétrait mieux du sens des auteurs plus ardents. Elle aimait Walter Scott ; Byron la passionnait ; Wordsworth l’étonnait ; elle hésitait à se former une opinion sur lui.
Mais qu’elle fût en train de causer ou de me faire la lecture, de ...
Table des matières
- Chapitre premier
- Chapitre II
- Chapitre III
- Chapitre IV
- Chapitre V
- Chapitre VI
- Chapitre VII
- Chapitre VIII
- Chapitre IX
- Chapitre X
- Chapitre XI
- Chapitre XII
- Chapitre XIII
- Chapitre XIV
- Chapitre XV
- Chapitre XVI
- Chapitre XVII
- Chapitre XVIII
- Chapitre XIX
- Chapitre XX
- Chapitre XXI
- Chapitre XXII
- Chapitre XXIII
- Chapitre XXIV
- Chapitre XXV
- Page de copyright
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrir comment résilier votre abonnement
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Apprendre à télécharger des livres hors ligne
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 990 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! En savoir plus sur notre mission
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. En savoir plus sur la fonctionnalité Écouter
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS et Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application
Oui, vous pouvez accéder à Le Professeur par Charlotte Brontë en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Littérature et Fiction historique. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.