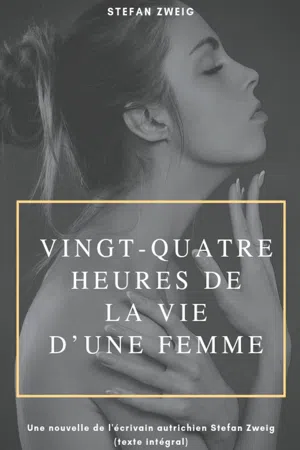![]()
Vingt-quatre heures de la vie d’une femme
Dans la petite pension de la Riviera où je me trouvais alors (dix ans avant la guerre[1]), avait éclaté à notre table une violente discussion qui brusquement menaça de tourner en altercation furieuse et fut même accompagnée de paroles haineuses et injurieuses. La plupart des gens n’ont qu’une imagination émoussée. Ce qui ne les touche pas directement, en leur enfonçant comme un coin aigu en plein cerveau, n’arrive guère à les émouvoir ; mais si devant leurs yeux, à portée immédiate de leur sensibilité, se produit quelque chose, même de peu d’importance, aussitôt bouillonne en eux une passion démesurée. Alors ils compensent, dans une certaine mesure, leur indifférence coutumière par une véhémence déplacée et exagérée.
Ainsi en fut-il cette fois-là dans notre société de commensaux tout à fait bourgeois, qui d’habitude se livraient paisiblement à de small talks[2] et à de petites plaisanteries sans profondeur, et qui le plus souvent, aussitôt après le repas, se dispersaient : le couple conjugal des Allemands pour excursionner et faire de la photo, le Danois rondelet pour pratiquer l’art monotone de la pêche, la dame anglaise distinguée pour retourner à ses livres, les époux italiens pour faire des escapades à Monte-Carlo, et moi pour paresser sur une chaise du jardin ou pour travailler. Mais cette fois-ci, nous restâmes tous accrochés les uns aux autres dans cette discussion acharnée ; et si l’un de nous se levait brusquement, ce n’était pas comme d’habitude pour prendre poliment congé, mais dans un accès de brûlante irritation qui, comme je l’ai déjà indiqué, revêtait des formes presque furieuses.
Il est vrai que l’événement qui avait excité à tel point notre petite société était assez singulier. La pension dans laquelle nous habitions tous les sept, se présentait bien de l’extérieur sous l’aspect d’une villa séparée (ah ! comme était merveilleuse la vue qu’on avait des fenêtres sur le littoral festonné de rochers), mais en réalité, ce n’était qu’une dépendance, moins chère, du grand Palace Hôtel et directement reliée avec lui par le jardin, de sorte que nous, les pensionnaires d’à côté, nous vivions malgré tout en relations continuelles avec les clients du Palace. Or, la veille, cet hôtel avait eu à enregistrer un parfait scandale.
En effet, au train de midi, exactement de midi vingt (je dois indiquer l’heure avec précision parce que c’est important, aussi bien pour cet épisode que pour le sujet de notre conversation si animée), un jeune Français était arrivé et avait loué une chambre donnant sur la mer : cela seul annonçait déjà une certaine aisance pécuniaire. Il se faisait agréablement remarquer, non seulement par son élégance discrète, mais surtout par sa beauté très grande et tout à fait sympathique : au milieu d’un visage étroit de jeune fille, une moustache blonde et soyeuse caressait ses lèvres, d’une chaude sensualité ; audessus de son front très blanc bouclaient des cheveux bruns et ondulés ; chaque regard de ses yeux doux était une caresse ; tout dans sa personne était tendre, flatteur, aimable, sans cependant rien d’artificiel ni de maniéré. De loin, à vrai dire, il rappelait d’abord un peu ces figures de cire de couleur rose et à la pose recherchée qui, une élégante canne à la main, dans les vitrines des grands magasins de mode, incarnent l’idéal de la beauté masculine. Mais dès qu’on le regardait de plus près, toute impression de fatuité disparaissait, car ici (fait si rare !) l’amabilité était chose naturelle et faisait corps avec l’individu. Quand il passait, il saluait tout le monde d’une façon à la fois modeste et cordiale, et c’était un vrai plaisir de voir comment à chaque occasion sa grâce toujours prête se manifestait en toute liberté.
Si une dame se rendait au vestiaire, il s’empressait d’aller lui chercher son manteau ; il avait pour chaque enfant un regard amical ou un mot de plaisanterie ; il était à la fois sociable et discret ; bref, il paraissait un de ces êtres privilégiés, à qui le sentiment d’être agréable aux autres par un visage souriant et un charme juvénile donne une grâce nouvelle. Sa présence était comme un bienfait pour les hôtes du Palace, la plupart âgés et de santé précaire ; et grâce à une démarche triomphante de jeunesse, à une allure vive et alerte, à cette fraîcheur qu’un naturel charmant donne si superbement à certains hommes, il avait conquis sans résistance la sympathie de tous. Deux heures après son arrivée, il jouait déjà au tennis avec les deux filles du gros et cossu industriel lyonnais, Annette, âgée de douze ans, et Blanche qui en avait treize ; et leur mère, la fine, délicate et très réservée Mme Henriette, regardait en souriant doucement, avec quelle coquetterie inconsciente les deux fillettes toutes novices flirtaient avec le jeune étranger. Le soir, il nous regarda pendant une heure jouer aux échecs, en nous racontant entre-temps quelques gentilles anecdotes, sans nous déranger du tout ; il se promena à plusieurs reprises, assez longtemps, sur la terrasse avec Mme Henriette, dont le mari comme toujours jouait aux dominos avec un ami d’affaires ; très tard encore, je le trouvai en conversation suspecte d’intimité avec la secrétaire de l’hôtel, dans l’ombre du bureau.
Le lendemain matin, il accompagna à la pêche mon partenaire danois, montrant en cette matière des connaissances étonnantes ; ensuite, il s’entretint longuement de politique avec le fabricant de Lyon, ce en quoi également il se révéla un causeur agréable, car on entendait le large rire du gros homme couvrir le bruit de la mer. Après le déjeuner (il est absolument nécessaire pour l’intelligence de la situation que je rapporte avec exactitude toutes ces phases de son emploi du temps), il passa encore une heure avec Mme Henriette, à prendre le café tous deux seuls dans le jardin ; il rejoua au tennis avec ses filles et conversa dans le hall avec les époux allemands. À six heures, en allant poster une lettre, je le trouvai à la gare. Il vint au-devant de moi avec empressement et me raconta qu’il était obligé de s’excuser, car on l’avait subitement rappelé, mais qu’il reviendrait dans deux jours.
Effectivement, le soir, il ne se trouvait pas dans la salle à manger, mais c’était simplement sa personne qui manquait, car à toutes les tables on parlait uniquement de lui et l’on vantait son caractère agréable et gai.
Pendant la nuit, il pouvait être onze heures, j’étais assis dans ma chambre en train de finir la lecture d’un livre, lorsque j’entendis tout à coup par la fenêtre ouverte, des cris et des appels inquiets dans le jardin, qui témoignaient d’une agitation certaine dans l’hôtel d’à côté. Plutôt par inquiétude que par curiosité, je descendis aussitôt, et en cinquante pas je m’y rendis, pour trouver les clients et le personnel dans un état de grand trouble et d’émotion. Mme Henriette, dont le mari, avec sa ponctualité coutumière, jouait aux dominos avec son ami de Namur, n’était pas rentrée de la promenade qu’elle faisait tous les soirs sur le front de mer, et l’on craignait un accident. Comme un taureau, cet homme corpulent, d’habitude si pesant, se précipitait continuellement vers le littoral, et quand sa voix altérée par l’émotion criait dans la nuit : « Henriette ! Henriette ! », ce son avait quelque chose d’aussi terrifiant et de primitif que le cri d’une bête gigantesque, frappée à mort. Les serveurs et les boys se démenaient, montant et descendant les escaliers ; on réveilla tous les clients et l’on téléphona à la gendarmerie. Mais au milieu de ce tumulte, le gros homme, son gilet déboutonné, titubait et marchait pesamment en sanglotant et en criant sans cesse dans la nuit, d’une manière tout à fait insensée, un seul nom : « Henriette ! Henriette ! » Sur ces entrefaites, les enfants s’étaient réveillées là-haut et en chemises de nuit elles appelaient leur mère par la fenêtre ; alors le père courut à elles pour les tranquilliser.
Puis se passa quelque chose de si effrayant qu’il est à peine possible de le raconter, parce que la nature violemment tendue, dans les moments de crise exceptionnelle, donne souvent à l’attitude de l’homme une expression tellement tragique que ni l’image, ni la parole ne peuvent la reproduire avec cette puissance de la foudre qui est en elle. Soudain, le lourd et gros bonhomme descendit les marches de l’escalier en les faisant grincer, et avec un visage tout changé, plein de lassitude et pourtant féroce ; il tenait une lettre à la main : « Rappelez tout le monde ! » dit-il d’une voix tout juste intelligible au chef du personnel. « Rappelez tout le monde ; c’est inutile, ma femme m’a abandonné. »
Il y avait de la tenue dans cet homme frappé à mort, une tenue faite de tension surhumaine devant tous ces gens qui l’entouraient, qui se pressaient curieusement autour de lui pour le regarder et qui, brusquement, s’écartèrent pleins de confusion, de honte et d’effroi. Il lui resta juste assez de force pour passer devant nous en chancelant, sans regarder personne, et pour éteindre la lumière dans le salon de lecture ; puis on entendit son corps lourd et massif s’écrouler d’un seul coup dans un fauteuil, et l’on perçut un sanglot sauvage et animal, comme seul peut en avoir un homme qui n’a encore jamais pleuré. Cette douleur élémentaire agit sur chacun de nous, même le moins sensible, avec une violence stupéfiante. Aucun des garçons de l’hôtel, aucun des clients venus là par curiosité n’osait risquer un sourire, ou même un mot de commisération. Muets, l’un après l’autre, comme ayant honte de cette foudroyante explosion du sentiment, nous regagnâmes doucement nos chambres, et tout seul dans la pièce obscure où il était, ce morceau d’humanité écrasée palpitait et sanglotait, archi-seul avec lui-même dans la maison où lentement s’éteignaient les lumières, où il n’y avait plus que des murmures, des chuchotements, des bruits faibles et mourants.
On comprendra qu’un événement si foudroyant arrivé sous nos yeux était de nature à émouvoir puissamment des gens accoutumés à l’ennui et à des passetemps insouciants. Mais la discussion qui ensuite éclata à notre table avec tant de véhémence et qui faillit même dégénérer en voies de fait, bien qu’ayant pour point de départ cet incident surprenant, était en elle-même plutôt une question de principes qui s’affrontent et une opposition coléreuse de conceptions différentes de la vie. En effet, par suite de l’indiscrétion d’une femme de chambre qui avait lu cette lettre (le mari effondré sur lui-même, dans sa colère impuissante, l’avait jetée toute chiffonnée n’importe où sur le parquet), on eut vite appris que Mme Henriette n’était pas partie seule, mais d’accord avec le jeune Français (pour qui la sympathie de la plupart commença dès lors à diminuer rapidement). Après tout, au premier coup d’œil, on aurait parfaitement compris que cette petite madame Bovary échangeât son époux rondelet et provincial pour un joli jeune homme distingué. Mais ce qui étonnait toute la maison, c’était que ni le fabricant, ni ses filles, ni même Mme Henriette n’avaient jamais vu auparavant ce Lovelace[3] ; et que, par conséquent, une conversation nocturne de deux heures sur la terrasse et une heure de café pris en commun dans le jardin puissent avoir suffi pour amener une femme irréprochable, d’environ trente-trois ans, à abandonner du jour au lendemain son mari et ses deux enfants, pour suivre à l’aventure un jeune élégant qui lui était totalement étranger.
Notre table était unanime à ne voir dans ce fait, incontestable en apparence, qu’une tromperie perfide et une manœuvre astucieuse du couple amoureux : il était évident que Mme Henriette entretenait depuis très longtemps des rapports secrets avec le jeune homme et que ce charmeur de rats[4] n’était venu ici que pour fixer les derniers détails de la fuite, car – ainsi raisonnait-on –, il était absolument impossible qu’une honnête femme, après simplement deux heures de connaissance, filât ainsi au premier coup de pipeau. Voici que je m’amusai à être d’un autre avis ; et je soutins énergiquement la possibilité, et même la probabilité d’un événement de ce genre, de la part d’une femme qu’une union faite de longues années de déceptions et d’ennui avait intérieurement préparée à devenir la proie de tout homme audacieux. Par suite de mon opposition inattendue, la discussion devint vite générale, et ce qui surtout la rendit passionnée, ce fut que les deux couples d’époux, aussi bien l’allemand que l’italien, refusèrent avec un mépris véritablement offensant d’admettre l’existence du coup de foudre[5], où ils ne voyaient qu’une folie et une fade imagination romanesque.
Bref, il est ici sans intérêt de remâcher dans tous ses détails le cours orageux de cette dispute entre la soupe et le pudding ; seuls des professionnels de la table d’hôte[6] sont spirituels, et les arguments auxquels on recourt dans la chaleur d’une discussion que le hasard soulève entre convives sont le plus souvent sans originalité, parce que, pour ainsi dire, ramassés hâtivement avec la main gauche. Il serait également difficile d’expliquer pourquoi notre discussion prit si vite des formes blessantes ; je crois que l’irritation vint de ce que, malgré eux, les deux maris prétendirent que leurs propres femmes échappaient à la possibilité de tels risques et de telles chutes. Malheureusement, ils ne trouvèrent rien de meilleur à m’objecter que seul pouvait parler ainsi quelqu’un qui juge l’âme féminine d’après les conquêtes fortuites et trop faciles d’un célibataire. Cela commença à m’irriter, et lorsque ensuite la dame allemande assaisonna cette leçon d’une moutarde sentencieuse, en disant qu’il y avait d’une part, des femmes dignes de ce nom, et d’autre part, des « natures de gourgandine », et que, selon elle, Mme Henriette devait être de celles-ci, je perdis tout à fait patience ; à mon tour je devins agressif. Je déclarai que cette négation du fait incontestable qu’une femme, à maintes heures de sa vie, peut être livrée à des puissances mystérieuses plus fortes que sa volonté et que son intelligence, dissimulait seulement la peur de notre propre instinct, la peur du démonisme de notre nature et que beaucoup de personnes semblaient prendre plaisir à se croire plus fortes, plus morales et plus pures que les gens « faciles à séduire ».
Pour ma part, je trouvais plus honnête qu’une femme suivît librement et passionnément son instinct, au lieu, comme c’est généralement le cas, de tromper son mari en fermant les yeux quand elle est dans ses bras. Ainsi m’exprimai-je à peu près ; et dans la conversation devenue crépitante, plus les autres attaquaient la pauvre Mme Henriette, plus je la défendais avec chaleur (à vrai dire, bien au-delà de ma conviction intime !). Cette ardeur parut une provocation aux deux couples d’époux ; et, quatuor peu harmonieux, ils me tombèrent dessus en bloc avec tant d’acharnement que le vieux Danois, qui était assis, l’air jovial et le chronomètre à la main comme l’arbitre dans un match de football, était obligé de temps en temps de frapper sur la table du revers osseux de ses doigts, en guise d’avertissement, disant : « Gentlemen, please ».
Mais cela ne faisait d’effet que pour un moment. Par trois fois déjà, l’un des deux messieurs s’était dressé violemment, le visage cramoisi, et sa femme avait eu beaucoup de peine à l’apaiser – bref, une douzaine de minutes encore, et notre discussion aurait fini par des coups, si soudain Mrs C… n’avait pas par des paroles lénitives calmé, comme avec de l’huile balsamique, les vagues écumantes de la conversation.
Mrs C… , la vieille dame anglaise aux...