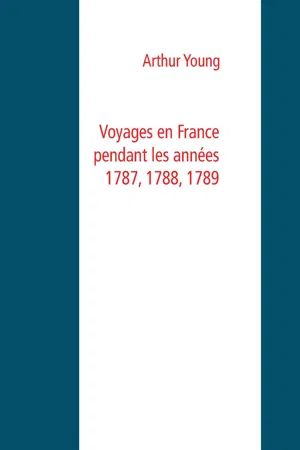![]()
ANNÉE 1789
Mes deux précédents voyages m'avaient fait traverser la moitié ouest de la France dans toutes les directions, et les renseignements reçus en les accomplissant m'avaient donné autant de connaissance des méthodes générales de culture, du sol, de son aménagement, de ses productions, qu'on pouvait en avoir sans pénétrer dans chaque localité, sans vivre longtemps dans différents endroits, manière d'examiner qui, pour un royaume comme la France, demanderait plusieurs générations, et non plusieurs années. Il me restait à visiter l'Est. Le grand espace formé par le triangle dont Paris, Strasbourg et Moulins sont les sommets, et la région montagneuse au sud-est de cette dernière ville, me présentaient sur la carte un vide qu'il fallait combler avant d'avoir de ce royaume une idée telle que je me l'étais proposée. Je me déterminai à ce troisième voyage afin d'accomplir mon dessein ; plus j'y réfléchissais, plus il me paraissait important ; moins aussi il me semblait avoir de chance d'être exécuté par ceux que leur position mettait mieux à même que moi d'achever l'entreprise. La réunion des états généraux de France qui s'approchait me pressait aussi de ne pas perdre de temps ; car selon toutes les probabilités humaines, cette assemblée doit marquer l'ère d'une nouvelle constitution qui produira de nouveaux effets, suivis, selon que j'en juge, d'une nouvelle agriculture ; et tout homme avide d'une science politique réelle aurait à regretter de ne pas connaître le pays où se montrait sur son déclin ce soleil royal dont nous avions presque vu l'aurore. Les événements d'un siècle et demi, en comptant le règne éclatant de Louis XIV, rendront à jamais intéressantes pour l'humanité les origines de la puissance française, surtout afin de connaître sa situation avant l'établissement d'un gouvernement meilleur ; car il n'y aura pas peu d'intérêt à comparer les effets du nouveau système et ceux de l'ancien.
Le 2 juin. - Londres. Le soir, représentation de la Generosita d'Alessandro de Tarchi ; il signor Marchesi y déploya sa puissance et chanta un duo qui, pour quelques moments, me fit oublier tous les moutons et les porcs de Bradfield. Je fus cependant plus charmé ensuite en soupant chez mon ami le docteur Burney, où je rencontrai miss Burney. Qu'il est rare de voir à la fois deux personnes auxquelles un grand renom n'enlève rien de leur amabilité privée : combien en voyons-nous, de gens célèbres, avec qui nous n'aurions jamais le désir de vivre. Parlez-moi seulement de ceux qui, à de grands talents, joignent des qualités qui nous fassent souhaiter de rester avec eux portes closes.
Le 3. - Je n'entends bruire à mon oreille que les récits de la fête donnée hier par l'ambassadeur d'Espagne. La plus belle fête du temps présent est celle que dix millions d'hommes se donnent à eux-mêmes.
La fête de la raison et le trop-plein de l'âme, le vif sentiment de cœurs que la reconnaissance fait battre pour le danger commun auquel on a échappé et l'espérance avide de la continuation d'un bonheur commun. Rencontré le comte de Berchtold chez M. Songa ; c'est un homme plein de bon sens et de vues profondes. Pourquoi l'empereur ne le rappelle-t-il pas pour en faire son premier ministre ? Le monde ne sera jamais bien gouverné tant que les rois ne connaîtront pas leurs sujets.
Le 4. - Arrivé à Douvres par la diligence avec deux négociants de Stockholm, l'un Suédois, l'autre Allemand, qui vont jusqu'à Paris. J'ai plus de chance de tirer quelque utilité de leur conversation que de la cohue d'une diligence anglaise. - 72 milles.
Le 5. - Passage à Calais. Quatorze heures de réflexion dans un véhicule qui ne laisse à personne la faculté de réfléchir. - 21 milles.
Le 6. - Nous avions dans la voiture un Français et sa femme ; une institutrice française venant d'Irlande, pleine d'une affectation et d'une extravagance qu'elle n'avait pas prises sûrement parmi les siens, et un jeune homme tout novice, son compatriote, qu'elle tâchait d'éblouir par ses grands airs et ses grâces. Le mari et la femme mirent en évidence un paquet de cartes, afin, disaient-ils, de bannir l'ennui du voyage ; mais ils s'arrangèrent aussi de façon à soulager de cinq louis notre jeune compagnon. C'est la première fois que j'ai été dans une diligence française, ce sera la dernière : elles sont détestables. Couché à Abbeville. - 78 milles.
Tous ces gens, à l'exception du Suédois, se croient très enjoués parce qu'ils sont très bruyants ; ils m'ont étourdi de leurs chansons ; j'ai eu les oreilles tellement rebattues d'airs français, que j'aurais presque préféré faire la route les yeux bandés sur un âne. Je perds patience en semblable compagnie. Voilà ce que les Français appellent de la gaieté, et non pas une véritable émotion du cœur ; ils ne disent mot ou ils chantent ; pour de la conversation, ils n'en ont aucune. Le ciel m'afflige d'une jument aveugle, plutôt que d'une autre diligence ! Après avoir passé la nuit aussi bien que le jour sur le chemin, nous arrivâmes à Paris à neuf heures du matin. - 102 milles.
Le 8. - Visite à mon ami Lazowski, pour savoir où était le logement que je lui avais écrit de me louer ; mais ma bonne duchesse d'Estissac ne lui a pas permis de faire cette commission. Je trouvai dans son hôtel un appartement tout préparé pour moi. - Paris est à présent dans une telle fermentation, à propos des états généraux tenus à Versailles, que la conversation est absorbée par eux. On ne parle pas d'autre chose. Tout est considéré, et à juste titre, comme important, dans une telle phase de la destinée de vingt-cinq millions d'hommes. Il y a maintenant une discussion sérieuse, pour savoir si les représentants s'appelleront communes ou tiers état ; eux-mêmes se donnent constamment ce premier titre, que la cour et la noblesse rejettent avec une sorte de crainte, comme s'il recouvrait un sens dangereux à approfondir. Mais ce sujet est de peu d'importance en regard d'un autre qui a retenu, pendant quelque temps, les états dans l'inaction, le mode de vérification des pouvoirs, séparément ou en commun. La noblesse et le clergé sont pour le premier, mais les communes s'y refusent avec fermeté : la raison qui fait qu'on s'attache aussi obstinément à une chose en apparence assez légère est qu'elle peut, par la suite, décider la manière de tenir séance, en chambres séparées ou en une seule assemblée. Ceux qu'échauffe l'intérêt du peuple déclarent qu'il sera impossible de réformer quelques-uns des plus grands abus de l'État, si la noblesse, siégeant à part, peut mettre à néant les vœux du peuple, et que donner un tel veto au clergé serait plus absurde encore. Si, au contraire, par la vérification des pouvoirs en commun, les trois ordres se trouvent réunis, le parti populaire pense qu'il ne restera pas de puissance capable de les séparer.
La noblesse et le clergé prévoient le même résultat et ne veulent pas en conséquence s'y prêter. Dans ce dilemme, il est curieux d'examiner les sentiments du jour. Ce n'est pas mon affaire d'écrire des mémoires sur ce qui se passe, mais mon attention se porte à saisir, autant que je le peux, l'opinion qui prévaut dans le moment.
Pendant mon séjour à Paris, je verrai toute sorte de monde, depuis les politiques du café, jusqu'aux meneurs des états, et l'objet principal de notes rapides, comme celles que je jette sur le papier, sera de reproduire les impressions sur l'heure : plus tard, en les comparant avec les événements qui auront lieu, j'en retirerai tout au moins une distraction. Le fait le plus saillant du jour, c'est qu'aucune idée de communauté de périls et d'intérêts ne semble unir ceux qui, divisés, se trouvent incapables de résister au danger commun, naissant de la conscience qu'aura le peuple de sa force en face de leur faiblesse. Le roi, la cour, la noblesse, le clergé, l'armée et le parlement sont à peu près dans la même situation. Tous voient, avec une égale frayeur, les idées de liberté qui circulent aujourd'hui. Seul, le roi, pour des raisons très simples à qui connaît son caractère, se tourmente peu, même des circonstances qui touchent le plus intimement son pouvoir. Chez les autres, ce sentiment du danger est commun, et ils s'uniraient s'il se trouvait un homme de talent qui le leur rendît facile, afin de se passer tout à fait des états. - Les communes elles-mêmes considèrent cette union hostile comme plus que probable. On peut en avoir la preuve dans cette idée, qui va gagnant chaque jour du terrain, que si les deux autres ordres continuaient à confondre leurs intérêts dans une chambre, ce serait une nécessité pour le tiers de se poser hardiment comme la représentation du royaume tout entier, puis d'appeler la noblesse et le clergé à venir prendre place dans son sein, et s'ils s'y refusaient, d'expédier sans eux les affaires.
Toutes les conversations d'aujourd'hui roulent sur ce sujet, mais les opinions sont plus divisées que je ne m'y serais attendu. Il y en a qui haïssent le clergé si cordialement, que, plutôt que de le voir former une chambre à part, ils hasarderaient un système nouveau, si dangereux qu'il fût.
Le 9. - Les boutiques où se débitent les brochures font des affaires incroyables. Je suis allé au Palais-Royal pour voir les nouvelles publications et m'en procurer un catalogue complet. Chaque heure en produit une. Il en a paru treize aujourd'hui, seize hier, et quatre-vingt- douze la semaine dernière. Nous nous imaginons quelquefois que les magasins de Debrett ou de Stockdale à Londres sont encombrés, mais ce sont des déserts à côté de celui de Dessin et quelques autres ici, où l'on a peine à se faufiler de la porte jusqu'au comptoir. Il en coûtait, il y a deux ans, de 27 à 30 liv. par feuille pour l'impression ; c'est maintenant de 60 à 80 liv. Le besoin de lire des brochures politiques s'est tellement étendu, dit-on, dans la province, que toutes les presses de France sont également occupées. Les 19/20es de ces productions sont en faveur de la liberté ; elles sont ordinairement très violentes contre les ordres privilégiés ; j'en ai retenu aujourd'hui beaucoup de cette espèce qui ont de la réputation ; mais lorsque je me suis enquis d'autres d'opinion contraire, j'ai trouvé, à mon grand étonnement, qu'il n'y en avait que deux ou trois d'assez de mérite pour être connues. N'est-il pas étonnant que, tandis que la presse répand à foison des principes excessivement niveleurs et même séditieux qui renverseraient la monarchie si on les appliquait, rien ne paraisse en réponse, et que la cour ne prenne aucune mesure contre la licence extrême de ces publications.
Il est aisé de concevoir l'esprit que l'on éveille de la sorte chez le peuple. Mais les cafés du Palais-Royal présentent des scènes encore plus singulières et plus étonnantes : non seulement l'intérieur est comble, mais une foule patiente se presse aux portes et aux fenêtres, écoutant à gorge déployée certains orateurs qui, montés sur une table ou sur une chaise, haranguent chacun son petit auditoire. On ne se figure pas aisément l'avidité avec laquelle ils sont écoutés et le tonnerre d'applaudissements qu'ils reçoivent pour toute expression plus hardie ou plus violente que d'ordinaire contre le gouvernement.
Je n'en reviens pas que les ministres souffrent de tels nids, de telles pépinières de sédition et de révolte, répandant à toute heure chez le peuple des principes qu'il leur faudra bientôt combattre avec vigueur, et dont il semble que ce soit une sorte de folie de permettre actuellement la propagation.
Le 10. - Tout conspire à rendre l'époque présente critique pour ce pays : la disette est terrible ; à chaque instant, il arrive des provinces des nouvelles d'émeutes et de troubles, on appelle la force armée pour maintenir l'ordre sur les marchés. Les prix dont on parle sont les mêmes que j'ai trouvés à Abbeville et à Amiens, cinq sous (deux deniers et demi) la livre de pain blanc ; celle de pain bis, dont se nourrissent les pauvres, de trois sous et demi à quatre sous. Ce taux est au delà de leurs moyens et occasionne une grande misère. À Meudon, la police, c'est-à-dire l'intendant, a ordonné que personne n'achetât de froment sans prendre à la fois une égale quantité d'orge. Quelle ridicule et stupide réglementation que celle qui met obstacle à l'approvisionnement du marché, afin qu'il soit mieux approvisionné ; qui montre au peuple les appréhensions du gouvernement, créant par là des frayeurs et faisant hausser les prix que l'on voudrait voir baisser.
J'ai causé de ceci avec quelques personnes instruites, qui m'ont assuré que le prix est, comme d'ordinaire, trop élevé par rapport à la demande, et qu'il n'y aurait pas eu de disette réelle si M. Necker avait laissé tranquille le commerce des grains ; mais que ses édits restrictifs, purs commentaires de son livre sur cette matière, ont plus contribué à élever le cours que tout le reste. Il me paraît clair que les violents amis des communes ne sont pas mécontents de cette cherté, qui seconde grandement leurs vues et leur rend un appel aux passions du peuple plus facile que si le marché était bas. Il y a trois jours, le clergé a imaginé une proposition très insidieuse : c'était d'envoyer aux communes une députation pour leur soumettre l'idée d'un comité des trois ordres, qui s'occupât de la misère du peuple et délibérât sur les moyens d'amener une baisse. Ceci eût conduit à la délibération par ordre et non par tête, et devait, conséquemment, être rejeté ; les communes se montrèrent aussi habiles : dans leur réponse, elles prièrent et supplièrent le clergé de venir les joindre dans la salle commune des états pour délibérer. On ne le sut pas plus tôt à Paris, que le clergé en devint doublement un objet de haine, et que les politiques du café de Foy se demandèrent si les communes n'avaient pas le droit d'appliquer, par un décret, les biens de cet ordre au soulagement de la détresse du peuple.
Le 11. - J'ai beaucoup vu de monde aujourd'hui et ne puis m'empêcher de remarquer qu'il n'y a pas d'idées arrêtées sur les meilleurs moyens de faire une nouvelle constitution. Hier, l'abbé Sieyès a fait une motion dans les communes pour déclarer formellement aux ordres privilégiés que, s'ils ne veulent pas se réunir à eux, ils procéderont sans leur assistance à l'expédition des affaires nationales ; les communes y ont adhéré avec un amendement insignifiant.
On parle beaucoup des conséquences de cette mesure, et aussi sur ce qui pourrait arriver du refus des deux autres ordres de délibérer en commun, de leur protestation contre ce qui se ferait sans eux, et de leur appel au roi pour obtenir la dissolution des états et leur reconstitution sous une forme plus favorable à l'arrangement des difficultés présentes. Dans ces discussions excessivement intéressantes, on s'appuie, d'un côté, sur un prétendu droit naturel idéal et chimérique ; de l'autre, on se garde de présenter aucun projet de garanties, rien qui assure le peuple d'être à l'avenir mieux traité qu'il ne l'a été jusqu'ici ; ce serait cependant absolument nécessaire. Mais la noblesse défend les principes des grands seigneurs avec lesquels je m'entretiens ; absurdement entichée de ses vieux privilèges, quelque lourds qu'ils soient pour le peuple, elle ne veut pas entendre parler de céder, à l'esprit de liberté, rien au delà de l'égalité des taxes foncières, qu'elle tient pour tout ce que l'on peut raisonnablement demander. Le parti populaire, d'autre part, semble faire dépendre toute liberté de l'absorption des classes privilégiées par les communes au moins pour faire la constitution. Quand je représente que, si l'on admet une fois l'union des ordres, aucun pouvoir ne sera capable d'arriver à la séparation ensuite, et qu'en pareil cas la constitution ne sera guère bonne si elle n'est mauvaise tout à fait, on me répond toujours que le premier point, pour le peuple, est d'avoir le pouvoir de faire le bien, et que ce n'est pas un argument valable que de dire qu'il en peut mal user. Parmi ces gens règne l'idée commune que tout ce qui tend à constituer un ordre à part, comme notre Chambre des lords, n'est pas en harmonie avec la liberté.
Ce qui me paraît parfaitement extravagant et sans fondement aucun.
Le 12. - À la réunion de la Société royale d'agriculture, à l'Hôtel- de-ville, en qualité d'associé, je pris part au vote et reçus un jeton. C'est une petite médaille donnée aux membres présents à la séance, pour leur rappeler l'objet de leur institution ; il en est de même à toutes les académies royales, etc., ce qui fait au bout de l'année une dépense excessive et ridicule ; car que faudrait-il attendre d'hommes qui ne s'y rendraient que pour recevoir leur jeton ? Quel qu'en fût le motif, il y avait beaucoup de monde ; près de trente membres étaient présents, entre lesquels Parmentier, vice-président, Cadet de Vaux, Fourcroy, Tillet, Desmarets, Broussonnet, secrétaire, et Creté de Palieul, dont j'ai visité la ferme il y a deux ans, le seul agriculteur pratique de la Société. Le secrétaire lit les titres des mémoires présentés, et en fait un compte rendu sommaire ; mais on n'en donne lecture que s'ils offrent un intérêt particulier. Les membres communiquent ensuite leurs mémoires ou leurs rapports ; et quand il y a une discussion, c'est sans ordre, tous parlent à la fois comme dans une conversation animée. L'abbé Raynal a offert un prix de 1200 liv. (52 l. st. 10 s.) pour récompenser quelque service important, et on me demanda pourquoi on devrait l'accorder. « Employez-les, dis-je, à encourager l'introduction des turneps. » Mais tous me le représentèrent comme impossible ; ils ont essayé tant de fois, le gouvernement l'a fait de son côté sans résultat ; cela leur paraît une chose dont il faut désespérer. Je ne dis pas que l'on n'avait fait jusqu'ici que des sottises et que le vrai moyen de réussir était de tout défaire pour recommencer.
Je n'assiste jamais à aucune Société d'agriculture, soit en France, soit en Angleterre, sans me demander, à part moi, si même bien dirigées elles font plus de bien que de mal ; c'est-à-dire si les avantages que l'agriculture nationale en retire ne sont pas plus que balancés par le préjudice qu'elles causent en détournant l'attention publique d'objets importants, ou en revêtant ces objets importants de formes frivoles, qui les font dédaigner. La seule société réellement utile serait celle qui, dans l'exploitation d'une grande ferme, offrirait un parfait exemple à l'usage de ceux qui y voudraient recourir, qui se composerait, par conséquent, d'hommes pratiques ; reste maintenant la question de savoir si tant de bons cuisiniers ne gâteraient pas la sauce.
Les idées du public sur les grandes affaires de Versailles changent chaque jour, chaque heure. On paraît croire à présent que les communes ont été trop loin dans leur dernier vote, et que l'union de la noblesse, du clergé, de l'armée, du parlement et du roi les écrasera. On parle de cette union comme se préparant ; on dit que le comte d'Artois, la reine et le parti qui prend son nom s'arrangent à cet effet, pour le moment où les démarches des communes demanderont d'agir avec vigueur et ensemble. L'abolition du parlement passe chez les meneurs populaires pour une mesure essentiellement nécessaire ; parce que, tant qu'ils existent, ce sont des tribunaux auxquels la cour peut recourir, si elle avait l'intention de menacer l'existence des états généraux ; de leur côté, ces grands corps ont pris l'alarme et voient avec un profond regret que leur refus d'enregistrer les ordonnances royales a créé dans la nation une puissance non seulement hostile, mais encore dangereuse pour eux-mêmes.
On sait aujourd'hui partout que, si le roi se débarrassait des états et gouvernait sur des principes tels quels, tous ses édits seraient reçus par tous les parlements. Dans ce dilemme et l'appréhension de ce jour, on se tourne beaucoup vers le duc d'Orléans, comme chef, mais avec une défiance générale très visible : on déplore sa conduite, on regrette de ne pouvoir compter sur lui dans des circonstances difficiles ; on le sait sans fermeté, redoutant fort d'être éloigné des plaisirs de Paris ; on se rappelle les bassesses auxquelles il descendit il y a longtemps afin d'être rappelé d'exil. On est cependant tellement au dépourvu, qu'on s'arrange de lui ; le bruit qui s'est répandu qu'il était déterminé d'aller, à la tête d'une fraction de la noblesse, se joindre aux communes pour vérifier ensemble les pouvoirs, a causé beaucoup de satisfaction. On tombe d'accord que s'il avait quelque peu de fermeté, avec son énorme revenu de 7 millions (306, 204 l. st.) et les 4 175 000 l. en plus qui lui feront retour à la mort de son beau-père le duc de Penthièvre, il pourrait tout, en se mettant à la tête de la cause populaire.
Le 13. - Visité le matin la Bibliothèque royale de Paris, que je n'avais pas encore vue. C'est un vaste local, magnifiquement rempli, comme tout le monde sait. Tout est combiné pour la commodité des lecteurs : il y en avait 60 ou 70. Au centre des salles, des cages de verre renferment des modèles d'instruments de différents arts que l'on garde pour la postérité ; ils sont à l'échelle exacte des proportions ; on y voit entre autres ceux qui servent au potier, au fondeur, au briquetier, au chimiste, etc., etc., et un très grand relief de jardin anglais, pauvrement conçu, qui a été ajouté dernièrement.
Dans tout cela, pas une charrue, pas un iota d'agricu...