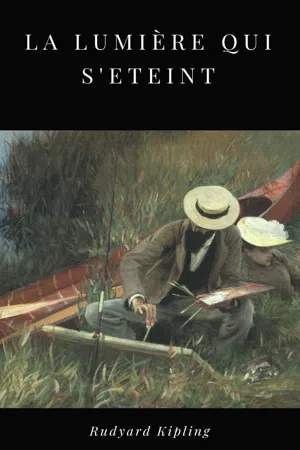![]()
II 1
Alors on baissa les lances, alors les trompettes sonnèrent,
Et nous partîmes pour Kandahar, chevauchant deux par deux,
Chevauchant, chevauchant, chevauchant deux par deux,
Tralala, tralalaire
Jusqu’à Kandahar, chevauchant deux par deux.
Chanson de la chambrée.
– Je ne souhaite pas de mal au public anglais ; mais je voudrais voir quelques milliers de nos lecteurs dispersés parmi ces rochers ! Ils ne seraient plus aussi pressés de recevoir leur journal du matin. Vous représentez-vous nos bons bourgeois : Ami de la Justice, Lecteur assidu, Paterfamilias, et leurs congénères, grillant sur ce sable en feu ?
– … Avec un voile bleu sur la figure et des vêtements en loques !… Quelqu’un a-t-il une aiguille ?… Moi, j’ai un morceau de toile d’emballage.
– Je vous offre une aiguille à matelas contre six pouces carrés de votre toile ; j’ai les deux genoux aux fenêtres de ma culotte.
– Six pouces ! pourquoi pas six arpents, tandis que vous y êtes !… Passez-moi tout de même votre aiguille ; je vais voir ce que je puis rogner pour vous sur la lisière. J’ai à peine de quoi protéger mon précieux corps contre les intempéries. Qu’est-ce que vous griffonnez donc sur votre éternel album, Dick ?
– Un croquis de notre « correspondant spécial » raccommodant sa garde-robe, répliqua Dick.
Le fait est que son camarade, après s’être dépouillé d’un pantalon de cheval, usé jusqu’à la corde, faisait de curieuses tentatives pour adapter un morceau de toile grossière au moins sur la plus large déchirure et gémissait, avec des gestes de désespoir, en constatant la gravité du dommage.
– De la toile d’emballage, s’il vous plaît ! Encore de la toile !… jamais je n’en aurai assez ! Hé ! là-bas, pilote ! Voulez-vous me céder toutes les voiles de votre canonnière ?
Une tête couronnée d’un fez émergea un instant, par une écoutille de l’arrière du bateau ; elle se fendit en deux parties égales dans un large sourire et disparut de nouveau. L’homme au pantalon déchiré, vêtu de sa seule jaquette et d’une chemise de flanelle grise, continua son raccommodage fantaisiste, tandis que Dick pouffait de rire sur son dessin.
Une vingtaine de canonnières entouraient un banc de sable où fourmillaient des soldats anglais appartenant à différents corps de troupe. Les uns se baignaient ; les autres lavaient leurs vêtements. Un amas de treuils, de caisses de vivres, de sacs de sucre, de farine et de munitions navales, signalait le point où l’un des bâtiments venait d’être forcé de débarquer à la hâte tout son chargement. Un charpentier de la flotte, à court de céruse jurait énergiquement, en s’efforçant de rapprocher les deux bords, brûlés par le soleil, d’une déchirure béante dans la coque.
– D’abord, c’est ce sacré gouvernail qui casse ! disait-il en invectivant l’univers entier. Puis, c’est le mât ! Enfin, quand ce diable de bateau ne sait plus quoi inventer, ne le voilà-t-il pas qui s’ouvre, comme un lotus chinois !
– Exactement comme mon pantalon, frère inconnu !… dit le tailleur improvisé, sans lever les yeux de son ouvrage. Ah ! Dick, je me demande quand je reverrai un vrai magasin…
Il n’y eut pas d’autre réponse à ce cri du cœur, que l’incessant murmure irrité du Nil. Ses flots se ruaient le long d’une muraille de basalte en pente et allaient se briser en écumant sur un barrage de rochers, à un demi-mille environ en aval du banc de sable. On aurait dit que la masse jaune du fleuve cherchait à repousser les hommes blancs vers leur pays lointain. Une indescriptible odeur de boue s’élevait dans l’air, au-dessus des berges découvertes par la baisse des eaux, et c’était en même temps le présage d’un dur labeur pour les équipages des canonnières, dans leur navigation vers le sud, à travers les bas-fonds. Le désert venait presque jusqu’à la rive, où campait, parmi les petits monticules gris, rouges ou noirs, un corps de cavaliers avec leurs dromadaires de selle. La consigne était que personne ne s’éloignât des bateaux. À la vérité, on n’avait pas eu d’alerte ni de combat depuis quelques semaines ; mais le Nil aussi était un ennemi contre lequel il fallait lutter ; les rapides succédaient aux rapides, les rochers aux rochers, les groupes d’îles aux groupes d’îles, si bien que les hommes finissaient par perdre tout sentiment de la distance, de la direction, presque du temps. Ils allaient quelque part : ils ne savaient pas où. Ils allaient faire quelque chose : ils ne savaient plus quoi. Devant eux, s’étendait la route mouvante du fleuve, à l’autre extrémité de laquelle se trouvait un certain Gordon1 qui défendait sa vie dans une ville appelée Khartoum. Il y avait des colonnes de troupes anglaises dans ce désert-ci, et puis dans d’autres déserts encore. Il y en avait sur le fleuve, au-dessus et au-dessous d’eux. Il y en avait qui attendaient là-bas, au nord, le moment d’embarquer. Il y en avait qui se préparaient à leur tour, vers Assiout et Assouan, pour le départ. Des rumeurs étranges, des bruits vagues, des nouvelles vraies ou fausses couraient, volaient, circulaient de toutes parts, à la surface de cette terre désolée qui s’étend de Souakim à la sixième cataracte, et les soldats supposaient généralement qu’il se trouvait quelque part un chef suprême, dirigeant l’ensemble des mouvements…
Le rôle de cette colonne navale était de garder les canonnières à flot, de protéger les moissons riveraines contre le piétinement des hommes halant les bateaux, de dormir et de manger quand on pouvait et de se jeter en toute occasion sans hésiter dans les mâchoires dévorantes du Nil.
Les correspondants de journaux suaient et trimaient avec les soldats, dans une ignorance à peu près aussi complète de ce qui se passait. Mais il fallait bien amuser, intéresser, exciter l’Angleterre, à l’heure de son déjeuner, chaque matin, et, que Gordon fût mort ou vif, que l’armée de secours fût décimée par les combats, par le sable ou par l’eau, il fallait bien que les journaux eussent leur compte. La campagne du Soudan, fort pittoresque, se prêtait en somme à des descriptions vives et animées. De temps en temps, un « correspondant spécial » s’arrangeait pour se faire tuer, ce qui ne laissait pas d’avoir de sérieux avantages pour la feuille qui l’employait, et le plus souvent la tactique des combats africains, avec leurs luttes corps à corps et leurs incidents héroïques, donnait lieu à de miraculeux sauvetages, dignes d’être télégraphiés à dix-huit pence le mot. Aussi des reporters en grand nombre accompagnaient-ils les divers détachements. Quelques-uns d’entre eux étaient demeurés auprès des vétérans qui emboîtèrent le pas à la cavalerie, lors de l’occupation du Caire, en 1882, sous le règne éphémère d’Arabi Pacha2 ; ceux-là furent témoins des premiers engagements malheureux, autour de Souakim. Ils vécurent ces horribles alertes où l’on massacrait les sentinelles, chaque nuit ; où toutes les broussailles se hérissaient de lances, à l’improviste. D’autres avaient suivi les nouveaux venus, les recrues amenées dans l’affaire au bout d’un fil télégraphique, pour remplacer leurs aînés tués ou blessés.
Parmi les plus anciens, parmi ceux qui avaient dès longtemps éprouvé les mécomptes du service postal et mesuré la valeur des rosses égyptiennes achetées au Caire ou à Alexandrie, parmi ceux qui savaient amadouer un télégraphiste récalcitrant ou apaiser la vanité froissée d’un nouvel officier d’état-major, à cheval sur des règlements surannés, le premier de tous était l’homme que nous avons vu tout à l’heure en chemise de flanelle : le brun Torpenhow lui-même.
Il représentait le Syndicat central de la Presse, dans la campagne actuelle, comme il l’avait représenté dans les guerres précédentes. Le Syndicat ne tenait pas à des comptes rendus scrupuleusement exacts des opérations militaires : comme il s’adressait à la masse du public, tout ce qu’il demandait, c’était de la couleur locale et une grande abondance de détails, car il y a plus de joie en Angleterre pour un soldat, qui, au mépris de la discipline, sort des rangs afin de secourir un camarade, que pour vingt généraux chauves de fatigue à surveiller les détails des services techniques et de l’intendance.
Torpenhow avait, un jour, aperçu à Souakim un jeune homme assis au bord d’une redoute abandonnée, grande comme un carton à chapeaux. Ce jeune homme dessinait tranquillement un groupe de cadavres étendus sur la plaine de sable.
– Pour le compte de qui ?… lui demanda-t-il brièvement.
Les journalistes s’abordent comme des commis-voyageurs sur la grande route.
– Pour mon compte… à moi ! répondit le jeune homme sans lever les yeux. Avez-vous du tabac ?
Torpenhow attendit qu’il eût terminé son esquisse ; puis, après l’avoir examinée :
– Que faites-vous, par ici ?
– Rien. Cela chauffait, je suis venu. Je suis censé travailler dans les chantiers, à la peinture des bâtiments ; peut-être aussi suis-je préposé à la garde d’une machine hydraulique ! Je ne sais plus au juste.
– Vous avez assez d’aplomb pour faire mieux, répliqua Torpenhow en dévisageant sa nouvelle connaissance. Dessinez-vous toujours aussi bien que cela ?
Dick montra ses croquis, l’un après l’autre, en annonçant les scènes retracées :
– Émeute sur un bateau à porcs chinois – Contremaître poignardé par un comprador3 – Muletier somali fouetté – Obus éclatant sur le camp de Berbera – Soldats morts, effet de lune, près de Souakim…
– Hum ! fit Torpenhow, je ne peux pas dire que j’aime beaucoup toutes ces esquisses à la Verestchaguine4 ; mais, des goûts et des couleurs !… Avez-vous quelque chose à faire pour le moment ?…
– Non, je m’amuse ici…
Torpenhow embrassa d’un coup d’œil le spectacle désolé d’alentour.
– Ma parole, vous avez une drôle de manière de vous amuser ! Avez-vous de l’argent ?
– Assez pour vivre. Dites donc : est-ce que vous voudriez m’engager pour la campagne, par hasard ?
– Pas moi ; mais peut-être mon Syndicat. Vous avez du talent, et je suppose que vous ne seriez pas exigeant pour le prix ?…
– Non, pas encore : j’attends une bonne occasion.
Torpenhow jeta de nouveau sur les dessins un coup d’œil approbateur.
– Oui, dit-il, vous aurez raison de saisir l’occasion dès qu’elle se présentera.
Il rentra rapidement à cheval, par la porte des « Deux vaisseaux de guerre », traversa la ville au galop et expédia la dépêche que voici :
Trouvé dessinateur sur place. Habile et bon marché. Faut-il conclure ? Il ferait illustrations.
Le jeune homme, assis sur l’épaulement de la redoute, continuait à balancer ses jambes, en murmurant :
– Je savais bien que la chance finirait par venir un jour ou l’autre ! Mais, par Jupiter, il faudra qu’on me paie le temps perdu, si je sors d’ici vivant !
Dans la soirée, Torpenhow annonça à son nouvel ami que le Syndicat central de la Presse consentait à le prendre à l’essai en le défrayant de toutes ses dépenses durant trois mois.
– Et, à propos, comment vous appelez-vous ?
– Dick Heldar. Me laisse-t-on ma liberté de travail ?
– On vous prend à l’essai. À vous de justifier le choix. Je vous conseille de ne pas me quitter. Je vais dans l’intérieur du pays avec une colonne, et je ferai tout ce que je pourrai pour vous. Confiez-moi quelques-uns de vos croquis d’après nature ; je veux les leur envoyer.
Tout bas, Torpenhow se disait :
– C’est la meilleure affaire qu’ait jamais faite le Syndicat, et Dieu sait, cependant, s’il m’a eu moi-même à bon compte !
Et c’est ainsi que Dick fut incorporé dans la brillante et honorable confrérie des journalistes, avec le droit inaliénable de travailler autant que possible et de gagner ce qu’il plaît à la Providence ou à leur directeur de leur accorder. À ce privilège enviable, le temps ajoute, si le nouveau venu est un peu doué, une facilité d’élocution irrésistible quand il s’agit de conquérir un repas ou un lit, le coup d’œil d’un maquignon, le savoir-faire d’un cuisinier, la constitution d’un bœuf et l’estomac d’une autruche, avec une rare faculté d’assimilation. Malheureusement, beaucoup d’entre ces élus meurent avant d’avoir atteint la perfection suprême, et, les maîtres de l’art ne se laissant voir le plus souvent qu’en habit, lorsqu’ils sont de retour en Angleterre, leur gloire est lettre morte pour la multitude.
Dick suivait Torpenhow de tous les côtés où l’entraînait la fantaisie du reporter, et, à deux, ils trouvèrent moyen d’accomplir des exploits qui les satisfirent à peu près. Leur rude vie contribua beaucoup à les rapprocher l’un de l’autre, car ils mangeaient à la même gamelle, partageaient la même gourde, et, solidarité sans pareille, leurs courriers partaient ensemble. Ce fut Dick qui imagina de griser un télégraphiste, dans une hutte voisine de la seconde cataracte, et de profiter du temps où sa victime gisait voluptueusement sur le sol pour s’emparer d’informations secrètes, acquises à grand-peine par le trop confiant correspondant d’un syndicat rival. Il fit une copie du manuscrit et la remit à Torpenhow, qui, sous le prétexte que tous les moyens sont bons, à la guerre comme en amour, tira un pittoresque et excellent article des notes copieuses de son confrère. Ce fut Torpenhow, en revanche, qui eut l’idée… Mais le récit des hauts faits qu’ils accomplirent en commun ou séparément remplirait plusieurs volumes !… Ils se laissèrent enfermer dans un carré, où ils faillirent être massacrés par des soldats frappés de panique ; ils combattirent, juchés sur des dromadaires de somme, dans la fraîcheur de l’aube ; ils furent secoués sans se plaindre par d’infatigables petits chevaux égyptiens sous un soleil aveuglant, et cahotés sur les bas-fonds du Nil, une nuit où leur canonnière s’était malencontreusement jetée contre un récif caché, qui lui ouvrit le ventre.
Au moment où nous les retrouvons, ils étaient assis sur le banc de sable où les transports débarquaient par escouades le reste de la colon...