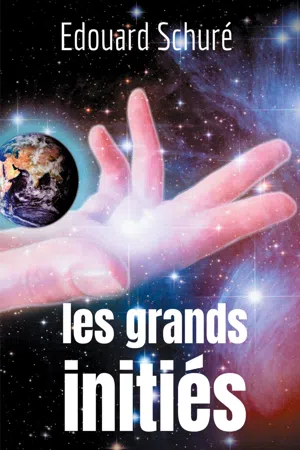![]()
LIVRE VI – PYTHAGORE
(LES MYSTÈRES DE DELPHES)
Connais-toi toi-même — et tu connaîtras l’Univers et les Dieux.
INSCRIPTION DU TEMPLE DE DELPHES
Le Sommeil, le Rêve et l’Extase sont les trois portes ouver.tes sur l’au-delà,d’où nous vient la science de et l’art et la divination.
L’Évolution est la loi de la Vie.
Le Nombre est la loi de l’Univers.
L’Unité est la loi de Dieu.
I. La Grèce au sixième siècle
L’âme d’Orphée avait traversé comme un divin météore le ciel orageux de la Grèce naissante. Lui disparu, les ténèbres l’envahirent de nouveau. Après une série de révolutions, les tyrans de la Thrace brûlèrent ses livres, renversèrent ses temples, chassèrent ses disciples. Les rois grecs et beaucoup de villes, plus jalouses de leur licence effrénée que de la justice qui découle des pures doctrines, les imitèrent. On voulut effacer son souvenir, détruire ses derniers vestiges, et l’on fit si bien que quelques siècles après sa mort une partie de la Grèce doutait de son existence. En vain, les initiés conservèrent-ils sa tradition pendant plus de mille ans ; en vain Pythagore et Platon en parlaient-ils comme d’un homme divin ; les sophistes et les rétheurs ne voyaient plus en lui qu’une légende sur l’origine de la musique. De nos jours encore, les savants nient carrément l’existence d’Orphée. Ils s’appuient principalement sur ce fait que ni Homère, ni Hésiode n’ont prononcé son nom. Mais le silence de ces poètes s’explique amplement par l’interdit que les gouvernements locaux avaient jeté sur le grand initiateur. Les disciples d’Orphée ne manquaient aucune occasion de rappeler tous les pouvoirs à l’autorité suprême du temple de Delphes et ne cessaient de répéter qu’il fallait soumettre les différends survenus entre les divers États de la Grèce au conseil des Amphictyons. Cela gênait les démagogues autant que les tyrans. Homère, qui reçut probablement son initiation au sanctuaire de Tyr, et dont la mythologie est la traduction poétique de la théologie de Sankoniaton, Homère l’Ionien put fort bien ignorer le Dorien Orphée, dont on tenait la tradition d’autant plus secrète qu’elle était plus persécutée. Quant à Hésiode, né près du Parnasse, il dut connaître son nom et sa doctrine par le sanctuaire de Delphes ; mais ses initiateurs lui imposèrent le silence, et pour cause.
Cependant Orphée vivait dans son œuvre ; il vivait dans ses disciples et dans ceux-là même qui le niaient. Cette œuvre, quelle est-elle ? Cette âme de vie, où faut-il la chercher ? Est-ce dans l’oligarchie militaire et féroce de Sparte, où la science est méprisée, l’ignorance érigée en système, la brutalité exigée comme un complément du courage ? Est-ce dans ces implacables guerres de Messénie, où l’on vit les Spartiates poursuivre un peuple voisin jusqu’à l’extermination, et ces Romains de la Grèce préluder à la roche tarpéienne et aux lauriers sanglants du Capitole, en précipitant dans un gouffre l’héroïque Aristomène, défenseur de sa patrie ? Est-ce plutôt dans la démocratie turbulente d’Athènes, toujours prête à verser dans la tyrannie ? Est-ce dans la garde prétorienne de Pisistrate ou dans le poignard d’Harmodius et d’Aristogiton, caché sous une branche de myrte ? Est-ce dans les villes nombreuses de l’Hellade, de la Grande-Grèce et de l’Asie Mineure, dont Athènes et Sparte offrent les deux types opposés ? Est-ce dans toutes ces démocraties et ces tyrannies envieuses, jalouses et toujours prêtes à s’entre-déchirer ? — Non ; l’âme de la Grèce n’est pas là. Elle est dans ses temples, dans ses Mystères et dans leurs initiés. Elle est au sanctuaire de Jupiter à Olympie, de Junon à Argos, de Cérès à Éleusis ; elle règne sur Athènes avec Minerve, elle rayonne à Delphes avec Apollon, qui domine et pénètre tous les temples de sa lumière. Voilà le centre de la vie hellénique, le cerveau et le cœur de la Grèce. C’est là que vont s’instruire les poètes qui traduisent à la foule les vérités sublimes en vivantes images, les sages qui les propagent en dialectique subtile. L’esprit d’Orphée circule partout où palpite la Grèce immortelle. Nous le retrouvons dans les luttes de poésie et de gymnastique, dans les jeux de Delphes et d’Olympie, institutions heureuses qu’imaginèrent les successeurs du maître pour rapprocher et fondre les douze tribus grecques. Nous la touchons du doigt dans le tribunal des Amphictyons, dans cette assemblée des grands initiés, cour suprême et arbitrale, qui se réunissait à Delphes, grand pouvoir de justice et de concorde, en qui seule la Grèce retrouva son unité aux heures d’héroïsme et d’abnégation80.
Cependant cette Grèce d’Orphée ayant pour intellect une pure doctrine gardée dans les temples, pour âme une religion plastique et pour corps une haute cour de justice centralisée à Delphes, cette Grèce commençait à péricliter dès le septième siècle. Les ordres de Delphes n’étaient plus respectés ; on violait les territoires sacrés. C’est que la race des grands inspirés avait disparu. Le niveau intellectuel et moral des temples avait baissé. Les prêtres se vendaient aux pouvoirs politiques ; les Mystères eux-mêmes commencèrent dès lors à se corrompre. L’aspect général de la Grèce avait changé. À l’ancienne royauté sacerdotale et agricole succédaient, ici la tyrannie pure et simple, là l’aristocratie militaire, là encore la démocratie anarchique. Les temples étaient devenus impuissants à prévenir la dissolution menaçante. Ils avaient besoin d’un aide nouveau. Une vulgarisation des doctrines ésotériques était devenue nécessaire. Pour que la pensée d’Orphée pût vivre et s’épanouir dans tout son éclat, il fallait que la science des temples passât dans les ordres laïques. Elle se glissa donc sous divers déguisements dans la tête des législateurs civils, dans les écoles des poètes, sous les portiques des philosophes. Ceux-ci sentirent, dans leur enseignement, la même nécessité qu’Orphée avait reconnue pour la religion, celle de deux doctrines : l’une publique, l’autre secrète, qui exposaient la même vérité, dans une mesure et sous des formes différentes, appropriées au développement de leurs élèves. Cette évolution donna à la Grèce ses trois grands siècles de création artistique et de splendeur intellectuelle. Elle permit à la pensée orphique, qui est à la fois l’impulsion première et la synthèse idéale de la Grèce, de concentrer toute sa lumière et de l’irradier sur le monde entier, avant que son édifice politique, miné par les dissensions intestines, ne s’ébranlât sous les coups de la Macédoine, pour s’écrouler enfin sous la main de fer de Rome.
L’évolution dont nous parlons eut bien des ouvriers. Elle suscita des physiciens comme Thalès, des législateurs comme Solon, des poètes comme Pindare, des héros comme Epaminondas ; mais elle eut un chef reconnu, un initié de premier ordre, une intelligence souveraine, créatrice et ordonnatrice. Pythagore est le maître de la Grèce laïque comme Orphée est le maître de la Grèce sacerdotale. Il traduit, il continue la pensée religieuse de son prédécesseur et l’applique aux temps nouveaux. Mais sa traduction est une création. Car il coordonne les inspirations orphiques en un système complet ; il en fournit la preuve scientifique dans son enseignement et la preuve morale dans son institut d’éducation, dans l’ordre pythagoricien qui lui survit.
Quoiqu’il apparaisse au plein jour de l’histoire, Pythagore est resté un personnage quasi légendaire. La raison principale en est la persécution acharnée dont il fut victime en Sicile et qui coûta la vie à tant de Pythagoriciens. Les uns périrent écrasés sous les débris de leur école incendiée, les autres moururent de faim dans un temple. Le souvenir et la doctrine du maître ne se perpétuèrent que par les survivants qui purent fuir en Grèce. Platon, à grand-peine et à grand prix, se procura par Archytas un manuscrit du maître, qui d’ailleurs n’écrivit jamais sa doctrine ésotérique qu’en signes secrets et sous forme symbolique. Son action véritable, comme celle de tous les réformateurs, s’exerçait par l’enseignement oral. Mais l’essence du système consiste dans les Vers dorés de Lysis, dans le commentaire d’Hiéroclès, dans les fragments de Philolaos et d’Archytas, ainsi que dans le Timée de Platon qui contient la cosmogonie de Pythagore. Enfin les écrivains de l’antiquité sont pleins du philosophe de Crotone. Ils ne tarissent pas d’anecdotes qui peignent sa sagesse, sa beauté et son pouvoir merveilleux sur les hommes. Les néoplatoniciens d’Alexandrie, les Gnostiques et jusqu’aux premiers Pères de l’Église le citent comme une autorité. Précieux témoignages, où vibre toujours l’onde puissante d’enthousiasme que la grande personnalité de Pythagore sut communiquer à la Grèce et dont les derniers remous sont encore sensibles huit siècles après sa mort.
Vue d’en haut, ouverte avec les clefs de l’ésotérisme comparé, sa doctrine présente un magnifique ensemble, un tout solidaire dont les parties sont reliées par une conception fondamentale. Nous y trouvons une reproduction raisonnée de la doctrine ésotérique de l’Inde et de l’Égypte, à laquelle il donna la clarté et la simplicité hellénique en y joignant un sentiment plus énergique, une idée plus nette de la liberté humaine.
À la même époque et sur divers points du globe, de grands réformateurs vulgarisaient des doctrines analogues. Lao-Tseu sortait en Chine de l’ésotérisme de Fo-Hi ; le dernier Bouddha, Cakyamouni, prêchait sur les bords du Gange ; en Italie, le sacerdoce étrusque envoyait à Rome un initié muni des livres sibyllins, le roi Numa, qui tenta de réfréner par de sages institutions l’ambition menaçante du Sénat romain. Et ce n’est point par hasard que ces réformateurs apparaissent en même temps chez des peuples si divers. Leurs missions différentes concourent à un but commun. Elles prouvent qu’à certaines époques un même courant spirituel traverse mystérieusement toute l’humanité. D’où vient-il ? De ce monde divin qui est hors de notre vue, mais dont les génies et les prophètes sont les envoyés et les témoins.
Pythagore traversa tout le monde antique avant de dire son mot à la Grèce. Il vit l’Afrique et l’Asie, Memphis et Babylone, leur politique et leur initiation. Sa vie orageuse ressemble à un vaisseau lancé en pleine tempête ; voiles déployées, il poursuit son but sans dévier de sa route, image du calme et de la force au milieu des éléments déchaînés. Sa doctrine donne la sensation d’une nuit fraîche succédant aux feux aigus d’une journée sanglante. Elle fait penser à la beauté du firmament qui déroule peu à peu ses archipels scintillants et ses harmonies éthérées sur la tête du voyant.
Essayons de dégager l’une et l’autre des obscurités de la légende comme des préjugés de l’école.
II. Les années de voyage
Samos était au commencement du sixième siècle avant notre ère une des îles les plus florissantes de l’Ionise. La rade de son port s’ouvrait en face des montagnes violettes de la molle Asie Mineure, d’où venaient tous les luxes et toutes les séductions. Dans une large baie, la ville s’étalait sur la rive verdoyante et s’étageait en amphithéâtre sur la montagne, au pied d’un promontoire couronné par le temple de Neptune. Les colonnades d’un palais magnifique la dominaient. Là, régnait le tyran Polycrate. Après avoir privé Samos de ses libertés, il lui avait donné le lustre des arts et d’une splendeur asiatique. Des hétaïres de Lesbos, appelées par lui, s’étaient établies dans un palais voisin du sien et conviaient les jeunes gens de la ville à des fêtes, où elles leur enseignaient les voluptés les plus raffinées, assaisonnées de musique, de danses et de festins. Anacréon, appelé par Polycrate à Samos, y fut amené sur une trirème aux voiles de pourpre, aux mâts dorés et le poète, une coupe d’argent ciselé à la main, fit entendre devant cette haute cour du plaisir ses odes caressantes et parfumées comme une pluie de roses. La chance de Polycrate était devenue proverbiale dans toute la Grèce. Il avait pour ami le pharaon Amasis qui l’avertit plusieurs fois de se défier d’un bonheur aussi continu et surtout de ne pas s’en vanter. Polycrate répondit à l’avis du monarque égyptien en jetant son anneau à la mer. « Je fais ce sacrifice aux Dieux », dit-il. Le lendemain, un pêcheur rapporta au tyran l’anneau précieux qu’il avait trouvé dans le ventre d’un poisson. Quand le pharaon apprit cela, il déclara qu’il rompait son amitié avec Polycrate, parce qu’un bonheur aussi insolent lui attirerait la vengeance des Dieux. — Quoi qu’il en soit de l’anecdote, la fin de Polycrate fut tragique. Un de ses satrapes l’attira dans une province voisine, le fit expirer dans les tourments et ordonna d’attacher son corps à une croix sur le mont Mycale. Ainsi les Samiens purent voir dans un sanglant coucher de soleil le cadavre de leur tyran crucifié sur un promontoire, en face de l’île où il avait régné dans la gloire et les plaisirs.
Mais revenons au début du règne de Polycrate. Par une nuit claire, un jeune homme était assis dans une forêt d’agnus-castus aux feuilles luisantes, non loin du temple de Junon, dont la pleine lune baignait la façade dorienne et faisait ressortir la mystique majesté. Depuis longtemps un rouleau de papyrus contenant un chant d’Homère avait glissé à ses pieds. Sa méditation commencée au crépuscule durait encore et se prolongeait dans le silence de la nuit. Depuis longtemps le soleil s’était couché ; mais son disque flamboyant flottait encore devant le regard du jeune songeur dans une présence irréelle. Car sa pensée errait loin du monde visible.
Pythagore était le fils d’un riche marchand de bagues de Samos et d’une femme nommée Parthénis. La Pythie de Delphes, consultée dans un voyage par les jeunes mariés, leur avait promis : « Un fils qui serait utile à tous les hommes, dans tous les temps », et l’oracle avait envoyé les époux à Sidon, en Phénicie, afin que le fils prédestiné fût conçu, moulé et mis au jour loin des influences troublantes de sa patrie. Avant sa naissance même, l’enfant merveilleux avait été voué avec ferveur par ses parents à la lumière d’Apollon, dans la lune de l’Amour. L’enfant naquit ; lorsqu’il fut âgé d’un an, sa mère, sur un conseil donné d’avance par les prêtres de Delphes, le porta au temple d’Adonaï dans une vallée du Liban. Là, le grand prêtre l’avait béni. Puis, la famille s’en revint à Samos. L’enfant de Parthénis était très beau, doux, modéré, plein de justice. La seule passion intellectuelle brillait dans ses yeux et donnait à ses actes une énergie secrète. Loin de le contrarier, ses parents avaient encouragé son penchant précoce à l’étude de la sagesse. Il avait pu librement conférer avec les prêtres de Samos et avec les savants qui commençaient à fonder en Ionie des écoles où ils enseignaient les principes de la physique. À dix-huit ans, il avait suivi les leçons d’Hermodamas de Samos ; à vingt, celles de Phérécyde à Syros ; il avait même conféré avec Thalès et Anaximandre à Milet. Ces maîtres lui avaient ouvert de nouveaux horizons, mais aucun ne l’avait satisfait. Entre leurs enseignements contradictoires, il cherchait intérieurement le lien, la synthèse, l’unité du grand Tout. Maintenant le fils de Parthénis en était arrivé à une de ces crises, où l’esprit surexcité par la contradiction des choses, concentre toutes ses facultés dans un effort suprême pour entrevoir le but, pour trouver le chemin qui mène au soleil de la vérité, au centre de la vie.
Dans cette nuit chaude et splendide, le fils de Parthénis regardait tour à tour la terre, le temple et le ciel étoilé. — Elle était là, sous lui, autour de lui, Déméter, la terre-mère, la Nature qu’il voulait pénétrer. Il respirait ses émanations puissantes, il sentait l’invincible attraction qui l’enchaînait sur son sein, lui l’atome pensant, comme une partie inséparable d’elle-même. Ces sages qu’il avait consultés lui avaient dit : « C’est d’elle que tout sort. Rien ne vient de rien. L’âme vient de l’eau ou du feu, ou des deux. Subtile émanation des éléments, elle ne s’en échappe que pour y rentrer. Résigne-toi à sa loi fatale. Ton seul mérite sera de la connaître et de t’y soumettre. »
Puis il regardait le firmament et les lettres de feu que forment les constellations dans la profondeur insondable de l’espace. Ces lettres devaient avoir un sens. Car, si l’infiniment petit, le mouvement des atomes a sa raison d’être, comment l’infiniment grand, la dispersion des astres, dont le groupement représente le corps de l’univers, ne l’aurait-il pas ? Ah oui chacun de ces mondes a sa loi propre, et tous ensemble se meuvent par un Nombre et dans une harmonie suprême. Mais qui déchiffrera jamais l’alphabet des étoiles ? Les prêtres de Junon lui avaient dit : « C’est le ciel des Dieux qui fut avant la terre. Ton âme en vient. Prie-les afin qu’elle y remonte. »
Cette méditation fut interrompue par un chant voluptueux, qui sortait d’un jardin, sur les bords de l’Imbrasus. Les voies lascives des Lesbiennes se mariaient langoureusement aux sons de la cithare ; des jeunes gens y répondirent par des airs bachiques. À ces voix se mêlèrent soudain d’autres cris perçants et lugubres partis du port. C’étaient des rebelles que Polycrate faisait charger dans une barque pour les vendre comme esclaves en Asie. On les frappait de lanières armées de clous, pour les entasser sous les pontons des rameurs. Leurs hurlements et leurs blasphèmes se perdirent dans la nuit ; puis, tout rentra dans le silence.
Le jeune homme eut un frisson douloureux, mais il le réprima pour se ramasser en lui-même. Le problème était devant lui plus poignant, plus aigu. La Terre disait : Fatalité ! Le Ciel disait : Providence ! et l’Humanité qui flotte entre les deux répondait : Folie ! Douleur ! Esclavage ! Mais au fond de lui-même le futur adepte entendait une voix invincible qui répondait aux chaînes de la terre et aux flamboiements du ciel par ce cri : Liberté ! Qui donc avait raison des sages, des prêtres, des fous, des malheureux ou de lui-même ? Ah ! c’est que toutes ces voix disaient vrai, chacune triomphait dans sa sphère, mais aucune ne lui livrait sa raison d’être. Les trois mondes existaient immuables comme le sein de Déméter, comme la lumière des astres et comme le cœur humain : mais celui-là seul qui saurait trouver leur...