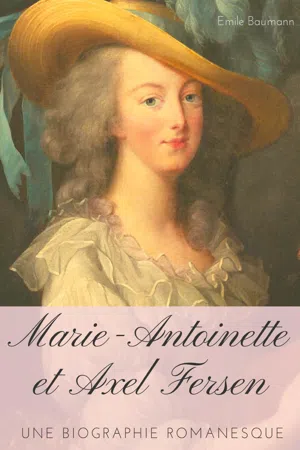![]()
II
L’INVINCIBLE ÉMOI
AXEL avait quitté Paris le 12 mai ; il arrive à Calais, passe la mer, et, en débarquant à Douvres, il a l’impression d’un autre monde : « différence totale de mœurs, de nourriture, de façon de penser, de façon de vivre, jusqu’à la construction des maisons, enfin tout. » Au sortir des éblouissements de Versailles, Londres, la cour d’Angleterre, lui paraissent enfumés, sordides, l’ennuient et le dégoûtent. Il entre dans une salle de bal où les femmes sont assises le long d’une galerie, à droite et à gauche, en grande cérémonie, sérieuses et tristes, ne se parlant même pas. On se croirait « dans une église ».
Un autre soir, consigne-t-il dédaigneusement, « il y eut bal à la cour dans une vilaine petite salle éclairée avec des lustres de bois doré ; il n’y avait assez de place pour danser un menuet, et il y avait aussi peu de danseurs qui savaient le danser passablement bien ; ce triste plaisir dura jusqu’à 11 heures et je fus enchanté de pouvoir m’en aller. »
Rien de ridicule comme une fête champêtre où tous ces Anglais « mal tournés » sont habillés en « berger tendre. »
Il se défendait, malgré tout, de ses préventions et voulait reconnaître aux Anglais des qualités ; mais, lorsqu’à l’automne, il respira de nouveau l’air de France, il se retrouva plus à l’aise, comme chez lui, et, traversant Dunkerque, devant les fortifications démolies, il s’indigna :
« Je formai des vœux ardents pour la guerre afin que la France puisse rétablir ces fortifications qui font la terreur des Anglais et l’admiration des connaisseurs. »
Il ne retourne point à Versailles ; par la Belgique et la Hollande il gagne la Prusse, va faire sa cour au Roi, à Postdam. En cette ville, il rencontre une jeune anglaise, Mlle Leyel, dont le père était un des gros trafiquants de la Compagnie des Indes Orientales ; la famille Fersen pensait pour Axel à un mariage.
Il rentre en Suède, à Lövstad, dans le château de ses pères, un château qui domine « un lac vert » 7enfermé entre des bois. La vie familiale, quoique sa mère fût charmante, lui sembla d’une monotonie insipide :
« Je passe mes journées, confiait-il à sa sœur Sophie, tète-à-tête avec mon père et ma mère qui jouent tous les soirs une partie de piquet ; et, pendant ce temps, je monte dans ma chambre où je joue de la flûte et fais une lecture... Pour nos plaisirs, vous les connaissez et vous savez qu’ils ne sont pas fort vifs ; ajoutez à cela qu’une pluie continuelle nous interdit même la promenade. Il n’y a plus de déjeuners, chacun déjeune dans sa chambre, nous ne nous voyons qu’au dîner... »
Quelques fêtes à la cour compensaient mal une vie désœuvrée et mélancolique. Il avait comme divertissement de jouer, dans une comédie française, le marché de Saint-Germain, un rôle de montreur d’animaux rares ; ou bien il participait à un tournoi d’un archaïsme germanique :
« Nous serons tout habillés de fer ; j’ai une armure qui pèse 40 skälpund (livres), que je dois porter trois jours depuis deux heures après-midi jusqu’à ce que je me couche ; nous devons souper avec nos armures, plaignez un peu mon dos et mes épaules. »
Au bout de quatre ans il obtient de repartir. Cette fois Bolemany ne l’accompagne plus ; il n’emmène que son vieux domestique, Joseph, et son chien. L’objet direct du voyage était de revoir à Londres Mlle Leyel. Le feld-maréchal désirait puissamment cette opulente union. Axel courtisa trois mois la jeune fille qu’il trouvait « aimable et douce, bien de figure, remplie de talents. » Mais il ne parvenait pas à l’aimer ; les millions du trafiquant des Indes ne le fascinaient point non plus ; il demandait la main de sa fille pour obéir au vœu paternel. Elle le devina sans doute et lui signifia qu’elle ne consentirait pas à s’éloigner de ses parents. Il en fut mortifié parce que son mariage était annoncé partout en Suède. Aussi conclut-il qu’il ne pourrait rentrer aussitôt dans son pays. L’affront de cet insuccès lui servit de prétexte pour chercher fortune ailleurs. Il aimait la Suède, surtout quand il en était loin. Vers quelle carrière se pousserait-il ? Le métier des armes ou la diplomatie ?
En attendant une décision, il revient à Paris. Le 22 août 1778, il se loge à l’hôtel d’York, rue du Vieux-Colombier. Tout près, dans la même rue, s’ouvre la maison d’un ami, du Comte Ramel, secrétaire à l’ambassade de Suède. La table de la Comtesse Ramel est des plus fines, et Fersen entreprend aussitôt la conquête de sa femme de chambre, Julie, plus facile, on s’en doute, à persuader que Mlle Leyel.
Il fréquente les lieux élégants, le palais Royal entre tous, « petite ville luxueuse 8» où se concentre l’agitation de la grande. Dans les cafés, tapage des dominos et cris des agioteurs ; fumées des rôtisseries ; vacarme des discussions dans les clubs ; va et vient de la foule à travers les boutiques d’orfèvres, dans « un labyrinthe de rubans, de gazes, de pompons, de fleurs, de robes, de masques, de boîtes de rouge » ; rires des filles circulant en compagnie de fats au teint pâle, au maintien impertinent qui s’annoncent « par le bruit des breloques de leurs deux montres 9 », tout ce tumulte amusait Fersen comme le défilé d’une folle mascarade.
Le 24 août — ce devait être vers cinq heures, au moment où s’y promenaient dans la belle saison les femmes du monde — il flânait sous les galeries avec un Suédois, le Comte Curt de Stedingk. Vint à passer un autre Suédois, le Comte Creutz, accompagnant une dame d’honneur de la Reine, la princesse de Chimay, née Fitz-James. Creutz, ministre de Suède à Paris, dès le premier voyage d’Axel, l’avait distingué, admirant la sagesse de sa conduite et l’élévation de son caractère. Il présente Axel à la princesse, et celle-ci — du moins nous le supposons — offre au nouvel arrivant de l’introduire à Versailles dès le lendemain.
Le 25 août en effet, jour de la Saint-Louis, il est reçu par la famille royale, et la Reine, en l’apercevant, jette d’un ton heureux cette exclamation :
— Ah ! c’est une ancienne connaissance ! Le mot n’était-il qu’une gentillesse, comme elle savait en dire aux gens qui l’approchaient ? Car elle possédait, bien que myope, une mémoire surprenante des physionomies, et, pour chaque personne, semblait disposer d’une attention particulière. Ou se ressouvint-elle de la rencontre à l’Opéra, du plaisir d’avoir intrigué un homme qui, dès l’abord, l’avait frappée ?
Cette parole, assurément, allait au-delà de ce qu’elle croyait émettre. Quatre ans et demi, dans une vie telle que la sienne, projettent si loin de menus faits dénués de toute valeur apparente ! Elle était alors presque une enfant, la Dauphine que le vieux Louis XV prenait sur ses genoux. Aujourd’hui, la Reine espère mettre au monde un Dauphin. Le 14 août dernier, elle pouvait annoncer à sa mère : « Mon enfant a donné le premier mouvement le vendredi 31 juillet à dix heures et demie du soir... Il remue fréquemment ; ce qui me cause une grande joie. »
Et, depuis le 30 janvier 1774, tant de choses se sont déroulées ! Quand on suit dans toute sa longueur la chaîne des grands et petits évènements dont se compose l’histoire de Marie-Antoinette, les termes : une ancienne connaissance se colorent d’étranges clartés. Tout ce qui est le passé tend à s’établir sur un plan unique, comme une masse de nuages à l’horizon d’une plaine. Mais, pour son âme jeune, vibrante aux moindres chocs, la série accumulée des impressions crée des profondeurs d’espace d’où Fersen a émergé comme une figure d’autrefois.
Or, voici qu’elle l’a revu plus beau qu’à dix-neuf ans : l’ovale de son visage paraît avoir acquis une plus ferme plénitude, l’éclat d’une jeunesse assurée de sa force. La tension méditative des yeux s’allège d’un sourire que les plis des lèvres nuancent finement. Il a toujours son air de réserve et de dignité. Marie-Antoinette reconnaît en sa voix ce qui manque au ton des français, des inflexions musicales semblables au parler qu’elle-même reprend dans ses moments d’abandon.
Axel, de son côté, trouve, ainsi qu’il s’y attendait, la Reine beaucoup plus imposante que la Dauphine. Sa bouche est plus volontaire, son nez, plus cambré. Son regard s’est armé d’une hauteur paisible, mais sans perdre ce qu’il avait d’affable et de changeant. Toutes les formes de son corps se sont épanouies, presque trop. Elle garde son cou de nymphe, mais sa gorge s’est amplifiée. Sa grossesse visible alanguit d’une douceur la vivacité de ses mouvements. Mais, sur son teint si diaphane qu’« il ne prenait point d’ombre 10» s’est posé, en dépit du rouge, le masque de la femme enceinte ; sa mine enjouée porte la trace encore légère d’inquiétudes, de souffrances, des froissements imprimés par les haines et par d’ignobles insultes.
Fersen a entendu les propos qui fermentent contre les amitiés capricieuses de la Reine, contre son luxe, contre les imprudentes largesses obtenues pour ses favorites et leurs alentours. Il n’ignore pas les nuits consumées au pharaon, les dettes scandaleuses, les friponneries imputées aux duchesses et aux tripotiers qu’elle admet à son jeu, les escapades aux bals de l’Opéra où, mêlée à des filles et à des polissons, Marie-Antoinette aventure incognito la royauté.
Et comment ne lui aurait-on rien dit des couplets, des lardons, des lettres anonymes, des libelles immondes jetés par paquets dans l’Œil-de-bœuf, circulant à Paris, expédiés jusqu’au fond des provinces, de la conspiration permanente qui s’évertue à déshonorer la Reine et à la tuer dans le cœur de ses peuples ?
Mais ces rumeurs néfastes ne troublent point Fersen. La Reine est jeune ; il estime qu’elle fait bien de se divertir ; ses inconséquences lui plaisent, comme elles enchantent toute la jeunesse dont elle suit le tourbillon. Même à la veille de 89, il s’abstiendra de juger quelle part elle a eue dans la préparation de la catastrophe. Pour l’instant elle le traite avec une faveur marquée ; il n’en demande pas davantage.
« La Reine, qui est la plus jolie et la plus aimable princesse que je connaisse, écrit-il à son père le 8 septembre, a eu la bonté de s’informer souvent de moi ; elle a demandé à Creutz pourquoi je ne venais pas à son jeu les dimanches et, ayant appris que j’étais venu un jour qu’il n’y en avait pas, elle m’en a fait une espèce d’excuse. »
Axel n’eut jamais la passion du jeu ; quand il vint à celui de la Reine, ce fut en spectateur détaché du gain ; et, s’il confia quelques louis aux dames assises autour de la table ronde, il ne sortit pas de là beaucoup plus pauvre ni plus riche.
Eprouve-t-il pour Marie-Antoinette un commencement de passion ? Il sent le privilège d’être admis dans « sa société ». Il ne semble rien espérer de plus. Mais l’accueil de la Reine n’a pu qu’affermir son intention d’entrer au service du Roi. Il veut voir de près une armée. Il accompagne son ami Stedingk en Normandie, au camp dressé comme une menace contre la côte anglaise, où commande le Maréchal de Broglie. Il part avec un « joli uniforme » qui a fait l’admiration de la Comtesse de Boufflers. Dans son voyage, tout le ravit. Au camp, beaucoup de personnes se souviennent de son père, le complimentent d’être son fils. Le Maréchal comble d’amitiés les deux Suédois, leur donne un logement, leur prête ses chevaux. Les troupes de la brigade Allemand-Bavière où il servira sont, à l’entendre, les meilleures « tant par la beauté des hommes que par la précision et l’attention dans l’exercice. »
Les femmes et les filles des officiers viennent au quartier-général ; on danse, on invite Fersen et son ami. « Tout le monde nous faisait des politesses, on nous regardait comme français. »
Une seule ombre : sa visite à la Trappe du Perche. Il était curieux, lui, luthérien, de voir un couvent de moines catholiques ; et, la Trappe étant proche, il y courut avec une sorte d’impatience. C’était un jour de pluie ; la tristesse hirsute du monastère pesa sur son âme. « Je fus saisi d’une espèce d’horreur en y arrivant » : un portier sale et mal vêtu ; une église noire, sombre et antique ; au chœur, un chant lugubre. L’idée que « ces pauvres gens » étaient là pour toute leur vie le jeta dans une désolation indicible. Il parla cependant à quelques trappistes : « ils ont l’air bien nourris, contents ; ils se disent très heureux. » Mais il ne put dominer son aversion ; il se pressa de repartir, d’oublier ce cloître sinistre.
Les violences d’antipathie sont rares chez Fersen ; son impression, à la Trappe, n’est pas explicable par le seul préjugé luth...