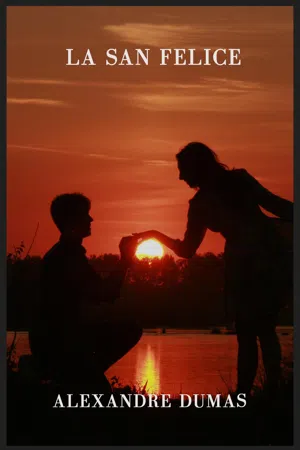![]()
XXIII
Fra Michele
Le lendemain, qui était un dimanche, Michele Pozza s’habilla, selon son habitude, pour aller entendre la messe, devoir auquel il n’avait pas manqué une seule fois depuis qu’il s’était refait laïque. À l’église, il rencontra son père et sa mère, les salua pieusement, les reconduisit chez eux la messe dite, leur demanda leur agrément, qu’il obtint, pour épouser la fille de don Antonio, si par hasard celui-ci la lui accordait ; puis, afin de n’avoir rien à se reprocher, il se présenta chez don Antonio dans l’intention de demander Francesca en mariage.
Don Antonio était avec sa fille et son futur gendre, et, à l’entrée de Michele Pezza, son étonnement fut grand. Le compère Giansimone n’avait point osé lui raconter ce qui s’était passé entre lui et son apprenti ; il lui avait, comme toujours, dit de prendre patience et qu’il verrait à le satisfaire dans le courant de la semaine suivante.
À la vue de fra Michele, la conversation s’interrompit si brusquement, qu’il fut facile au nouvel arrivant de deviner qu’il était question d’affaires de famille dont on ne comptait aucunement lui faire part.
Pezza salua avec beaucoup de politesse les trois personnes qu’il trouvait réunies, et demanda à don Antonio la faveur de lui adresser quelques paroles en particulier.
Cette faveur lui fut accordée en rechignant ; le descendant des conquérants espagnols se demandait s’il ne courait point quelque danger à demeurer en tête-à-tête avec son jeune voisin, dont il était loin cependant de soupçonner le caractère résolu.
Il fit signe à Francesca et à Peppino de se retirer.
Peppino offrit son bras à Francesca et sortit avec elle en riant au nez de fra Michele.
Pezza ne souffla point le mot, ne fit pas un signe de mécontentement, pas un geste de menace, quoiqu’il lui semblât être mordu par plus de vipères que don Rodrigue dans son tonneau.
– Monsieur, dit-il à don Antonio, aussitôt que la porte se fut refermée sur le couple heureux qui probablement à cette heure raillait impitoyablement le pauvre amoureux, inutile de vous dire, n’est-ce pas, que j’aime votre fille Francesca ?
– Si c’est inutile, répliqua en goguenardant don Antonio, alors, pourquoi le dis-tu ?
– Inutile pour vous, monsieur, mais non pour moi qui viens vous la demander en mariage.
Don Antonio éclata de rire.
– Je ne vois rien à rire là-dedans, monsieur, dit Michele Pezza sans s’emporter le moins du monde ; et, vous parlant sérieusement, j’ai le droit d’être écouté sérieusement.
– En effet, quoi de plus sérieux ? dit le charron en continuant de railler. M. Michele Pezza fait à don Antonio l’honneur de lui demander sa fille en mariage !
– Je ne crois pas, monsieur, vous faire particulièrement honneur, à vous, répliqua Pezza conservant le même sang-froid ; je crois l’honneur réciproque, et vous allez me refuser ma demande, je le sais bien.
– Pourquoi t’exposes-tu à un refus, alors ?
– Pour mettre ma conscience en repos.
– La conscience de Michele Pezza ! fit don Antonio en éclatant de rire.
– Et pourquoi, répliqua le jeune homme avec le même sang-froid, pourquoi Michele Pezza n’aurait-il pas une conscience comme don Antonio ? Comme don Antonio, il a deux bras pour travailler, deux jambes pour marcher, deux yeux pour voir, une langue pour parler, un cœur pour aimer et haïr. Pourquoi n’aurait-il pas, comme don Antonio, une conscience pour lui dire : « Ceci est bien, ceci est mal » ?
Ce sang-froid auquel il ne s’attendait point de la part d’un si jeune homme dérouta entièrement le charron ; cependant, s’attachant au vrai sens des paroles de Michele Pezza :
– Mettre ta conscience en repos, ajouta-t-il ; ce qui veut dire que, si je te refuse ma fille, il arrivera quelque malheur.
– Probablement, répondit Michele Pezza avec le laconisme d’un Spartiate.
– Et quel malheur arrivera-t-il ? demanda le charron.
– Dieu seul et la sorcière Nanno le savent ! dit Pezza ; mais il arrivera un malheur, attendu que, moi vivant, Francesca ne sera jamais la femme d’un autre.
– Tiens, va-t’en ! tu es fou.
– Je ne suis pas fou, mais je m’en vais.
– C’est bien heureux ! murmura don Antonio.
Michele Pezza fit quelques pas vers la porte ; mais, à mi-chemin, il s’arrêta.
– Vous me voyez partir si tranquillement, dit-il, parce que vous comptez qu’un jour ou l’autre, sur votre demande, votre compère Giansimone me mettra à la porte de chez lui, comme vous venez de me mettre à la porte de chez vous.
– Hein ? fit don Antonio étonné.
– Détrompez-vous ! nous nous sommes expliqués et je resterai chez lui tant qu’il me fera plaisir d’y rester.
– Ah ! le malheureux ! s’écria don Antonio, il m’avait cependant promis...
– Ce qu’il ne pouvait pas tenir... Vous avez le droit de me mettre à la porte de chez vous, et je ne vous en veux pas de m’y mettre, parce que je suis un étranger ; mais il n’en avait pas le droit, lui, parce que je suis son apprenti.
– Eh bien, après ? dit don Antonio se redressant. Que tu restes ou ne restes pas chez le compère, peu importe ! nous sommes chacun chez nous ; seulement, je te préviens, à mon tour, après les menaces que tu viens de me faire, que, si désormais je te trouve chez moi, ou te vois, de jour ou de nuit, rôder dans mon bien, comme je connais par toi-même tes mauvaises intentions, je te tue comme une bête enragée.
– C’est votre droit, mais je ne m’y exposerai pas ; maintenant, réfléchissez.
– Oh ! c’est tout réfléchi.
– Vous me refusez la main de Francesca ?
– Plutôt deux fois qu’une.
– Même dans le cas où Peppino y renoncerait ?
– Même dans le cas où Peppino y renoncerait.
– Même dans le cas où Francesca consentirait à me prendre pour mari ?
– Même dans le cas où Francesca consentirait à te prendre pour mari.
– Et vous me renvoyez sans avoir la charité de me laisser le moindre espoir ?
– Je te renvoie en te disant : Non, non, non.
– Songez, don Antonio, que Dieu punit, non pas les désespérés, mais ceux qui les ont poussés au désespoir.
– Ce sont les gens d’Église qui prétendent cela.
– Ce sont les gens d’honneur qui l’affirment. Adieu, don Antonio ; que Dieu vous fasse paix !
Et Michele Pezza sortit.
À la porte du charron, il rencontra deux ou trois jeunes gens d’Itri auxquels il sourit comme d’habitude.
Puis il rentra chez Giansimone.
Il était impossible, en voyant son visage si calme, de penser, de soupçonner même qu’il fut un de ces désespérés dont il parlait un instant auparavant.
Il monta à sa chambre et s’y enferma ; seulement, cette fois, il ne s’approcha point de la fenêtre ; il s’assit sur son lit, appuya ses deux mains sur ses genoux, laissa tomber sa tête sur sa poitrine, et de grosses larmes silencieuses coulèrent de ses yeux le long de ses joues.
Il était depuis deux heures dans cette immobilité, muet et pleurant, lorsqu’on frappa à sa porte.
Il releva la tête, s’essuya vivement les yeux et écouta.
On frappa une seconde fois.
– Qui frappe ? demanda-t-il.
– Moi, Giovanni.
C’était la voix et le nom d’un de ses camarades ; Pezza n’avait point d’amis.
Il s’essuya les yeux une seconde fois et alla ouvrir la porte.
– Que me veux-tu, Giovanni ? demanda-t-il.
– Je voulais te demander si tu ne serais pas disposé à faire, sur la promenade de la ville, une partie de boules avec les amis ? Je sais bien que ce n’est pas ton habitude ; mais j’ai pensé qu’aujourd’hui...
– Et pourquoi jouerais-je plutôt aujourd’hui aux boules que les autres jours ?
– Parce que, aujourd’hui, ayant du chagrin, tu as plus besoin de distraction que les autres jours.
– J’ai du chagrin aujourd’hui, moi ?
– Je le présume ; on a toujours du chagrin quand on est véritablement amoureux et qu’on vous refuse la femme que l’on aime.
– Tu sais donc que je suis amoureux ?
– Oh ! quant à cela, toute la ville le sait.
– Et tu sais que l’on m’a refusé celle que j’aimais ?
– Certainement, et de bonne source, c’est Peppino qui nous l’a dit.
– Et comment vous a-t-il dit cela ?
– Il a dit : « Fra Michele est venu demander Francesca en mariage à don Antonio, et il a emporté une veste. »
– Il n’a rien ajouté ?
– Si fait ; il a ajouté que, si la veste ne te suffisait pas, il se chargerait de te donner la culotte, ce qui te ferait le vêtement complet.
– Ce sont ses paroles ?
– Je n’y change pas une syllabe.
– Tu as raison, dit Michele Pezza après un moment de silence, pendant lequel il s’était assuré que son couteau était bien dans sa poche, j’ai besoin de distraction ; allons jouer aux boules.
Et il sortit avec Giovanni.
Les deux compagnons descendirent d’un pas rapide mais calme, qui au reste était plutôt réglé par Giovanni que par Michele, la grande rue conduisant à Fondi ; puis ils appuyèrent à gauche, c’est-à-dire du côté de la mer, vers ...