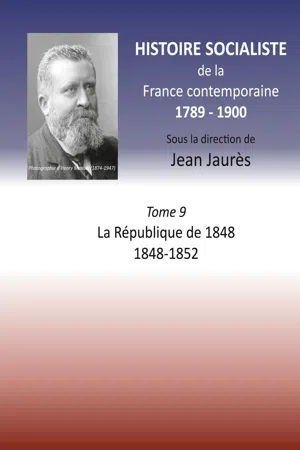![]()
Tome IX
La République de 1848
1848-1852
par Georges RENARD
![]()
Lettre préface par A. Millerand1
Paris, 1er Novembre 1905.
Mon cher Renard,
En demandant à votre amitié de me décharger du poids d’obligations que de nouveaux devoirs ne me permettaient plus de remplir, je savais quel cadeau je faisais aux lecteurs de l’Histoire socialiste. L’œuvre a dépassé mes prévisions.
Vous avez élevé à la gloire de nos devanciers un monument qui durera. Historien, vous ne vous êtes laissé entraîner par aucun parti-pris. Les événements et les hommes ont été jugés par vous sans haine et sans crainte, avec l’exclusif souci de la vérité.
Non que vous ayez abordé l’étude de cette époque émouvante en observateur indifférent. L’eussiez-vous tenté, l’épreuve eût été au-dessus des forces d’un homme qui, soit dit à votre honneur, n’a jamais isolé l’écrivain du citoyen.
Les idées directrices qui ont de tout temps guidé votre action, inspiré vos écrits comme votre enseignement, n’ont pas cessé de vous animer lorsque vous écriviez ces pages. Je ne crois pas me tromper en avançant que, de votre voyage dans ce passé si proche, vous êtes revenu plus attaché, s’il était possible, à notre idéal, mieux persuadé de l’excellence de notre méthode.
Quelle leçon pour l’homme d’État que l’histoire de cette période si brève et si pleine qui s’ouvre par une révolution pour se clore par un coup d’État ! Quelle démonstration saisissante que le temps est un facteur nécessaire de toute évolution !
Un peuple brusquement investi du pouvoir souverain, à l’exercice duquel il ne lui a pas été permis de se préparer, est pour le césarisme une victime fatale et aveugle. Il ouvrira les yeux au fond de l’abîme, trop tard.
Les masses populaires ne seront pas les seules à s’abuser. Enivrés par la rapidité et l’éclat de la victoire, leurs guides ne seront que trop portés à méconnaître les difficultés de leur tâche pour s’abandonner à une confiance qui touche à la naïveté et pour se bercer de décevantes illusions.
Les « journées » dont les dates jalonnent l’histoire de la seconde République racontent leurs erreurs et de quelle cruelle rançon elles furent payées.
Mais ce serait considérer sous un angle bien étroit les acteurs de ces scènes tragiques et le drame lui-même qu’y voir seulement des erreurs de conduite et de jugement, moins imputables à des défaillances individuelles ou collectives qu’à la soudaineté des événements.
D’autres enseignements, et plus hauts, se dégagent de ce passionnant spectacle.
La proclamation de la République avait éveillé d’immenses espoirs. Une ivresse généreuse s’empara des cerveaux et des cœurs. On eut l’impression que commençait une ère nouvelle.
En quelques mois tous les problèmes politiques et sociaux furent posés, dont la plupart attendent encore leur solution. Avec quel enthousiasme, quel désintéressement, quelle abnégation les Républicains de 1848 luttèrent pour la réalisation de leurs rêves, il faut l’apprendre et en garder pieusement la mémoire.
Aucun souvenir n’est plus propre à relever et à réconforter les courages dans les difficultés et les hasards des luttes quotidiennes ; aucun ne fait plus d’honneur à la démocratie française.
Elle vous sera reconnaissante, mon cher ami, d’avoir en éclairant son passé, jeté sur sa route des lueurs nouvelles.
Affectueusement vôtre.
A. Millerand.
1 Cette partie de l’Histoire socialiste, qui devait primitivement être écrite par le citoyen Millerand, a été confiée par ce dernier, en raison de ses multiples occupations, au citoyen Georges Renard, que ses études toutes particulières sur l’époque de 1848 désignaient spécialement pour ce travail.
![]()
LA DEUXIÈME RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
(1848-1851)
Par Georges RENARD
Il serait intéressant de suivre jour à jour et, en quelque sorte, pas à pas, les événements qui remplissent cette époque tumultueuse et féconde, et d’en noter à mesure les répercussions sur la vie de la société française. Mais il faudrait pour cela plus d’espace qu’on ne peut m’en accorder ici. Les limites qui me sont imposées me forcent à séparer et à distribuer par grandes masses l’histoire politique de l’époque et l’évolution économique et sociale qui s’opère en même temps.
Je conterai donc d’abord les faits relatifs au gouvernement de l’État, en indiquant avec netteté les étapes qui ramènent la France de la République à l’Empire ; puis je suivrai, dans les théories et dans la pratique, la grande et longue bataille dont le régime du travail et de la propriété est alors l’objet et l’enjeu .
![]()
Première partie
Histoire politique
![]()
Chapitre premier
Le gouvernement provisoire. La république sera-t-elle sociale?
La marche générale de la Révolution de 1848 en France est à la fois particulière et très simple. D’ordinaire, une révolution présente dans son cours une courbe ascendante et une courbe descendante. C’est ainsi que le 9 thermidor marque dans la première Révolution française la fin du mouvement en avant et le commencement du retour en arrière. Ici rien de pareil. Le point culminant est atteint dès le début. Il se livre, durant quelques semaines, une lutte indécise entre les forces qui veulent maintenir la France à ce niveau et celles qui tendent à lui faire redescendre la pente gravie en trois jours. Cette lutte de forces est, au fond, une lutte de classes, qui se révèle dès les premiers instants, s’envenime bientôt en conflits aigus et donne leur sens aux « journées » échelonnées de mois en mois avec une étrange régularité : 25 février, 17 mars, 16 avril, 15 mai, 22 juin. Pendant ces quatre mois chacune des deux classes et des deux tendances opposées l’emporte tour à tour ; mais chaque victoire éphémère et incomplète de l’une est suivie d’une revanche de l’autre, jusqu’au moment où, dans le sang de la guerre civile, la classe et la tendance bourgeoises triomphent de la classe et de la tendance populaires. Dès lors, la réaction victorieuse se précipite et, de chute en chute, fait retomber le peuple et la bourgeoisie elle-même au-dessous du point d’où ils étaient partis à la conquête de la République Mais, malgré l’inutilité apparente de l’effort avorté, il y a des choses abattues qui ne se relèvent pas, des progrès réalisés qui subsistent, des idées lancées qui continuent leur mouvement à travers le monde.
Le 24 février 1848, pendant que Paris gronde, fume, bouillonne encore comme un volcan en éruption, la première affaire à régler entre les vainqueurs surpris par la facilité de leur victoire, « arrivée, suivant l’expression de Gabet, comme une bombe ou un éclair », est la constitution du nouveau gouvernement. Sera-ce la Régence ou la République ? Une bonne partie de la bourgeoisie se fût sans aucun doute accommodée d’un changement se bornant à mettre la couronne sur une autre tête. Les républicains modérés croyaient la République prématurée. L’avocat Marie, un des chefs de l’opposition sous Louis-Philippe, disait : « Son temps n’est pas venu. Je l’aime trop pour souhaiter qu’elle naisse avant terme. » Béranger a écrit plus tard : « Nous voulions descendre marche à marche ; on nous a fait sauver un étage. » Mais il fallait compter avec les combattants des barricades qui n’entendaient pas qu’on renouvelât ce qu’ils appelaient l’escamotage de 1830. Déjà le peuple célébrait à sa façon les funérailles de la royauté, en brûlant les voitures de gala et le trône avec une allégresse gouailleuse. A la Chambre, la Régence disparaissait avant d’avoir existé ; la duchesse d’Orléans, le duc de Nemours suivaient Louis-Philippe sur le chemin de l’exil, et l’on décidait de nommer un gouvernement provisoire.
Une liste est alors soumise en plein tumulte, je ne dirai pas au vote de l’Assemblée (car il n’y a plus, à proprement parler, d’Assemblée), mais à l’approbation de la foule bigarrée qui se presse dans la salle envahie. Lamartine, Arago, Ledru-Rollin sont nommés par acclamation ; avec eux passe sans encombre Dupont de l’Eure, le patriarche de la démocratie, dans la vénérable majesté de sa quatre-vingt-deuxième année. Marie, Crémieux, Garnier-Pagès sont acceptés malgré des contestations assez vives. Le nom de Louis Blanc, le socialiste, prononcé par quelques voix, est volontairement omis par Lamartine qui aide à dresser la liste.
Mais il existe une tradition révolutionnaire, une sorte de cérémonial réglé d’avance. Le Gouvernement provisoire, après ce simulacre d’élection parlementaire, doit aller à l’Hôtel de ville se faire reconnaître et, pour ainsi dire, sacrer par le peuple. Il se trouve là en présence d’un courant venant d’ailleurs, d’une autre liste émanant de la presse avancée et des sociétés secrètes. On discute. Un semblant d’élection, dans la salle Saint-Jean, aboutit à la réunion des deux listes rivales. Marrast, Flocon, Louis Blanc, qui représentent le National et la Réforme, Albert, un ouvrier mécanicien qui a quitté la veille sa blouse et ses outils de travail, et qui est le candidat des sociétés secrètes, sont adjoints aux députés déjà désignés. Les trois derniers élus reçoivent, ou plutôt subissent d’abord, le titre de secrétaires, et, dans les premières séances, on oublie de convoquer Albert.
Ainsi se trahit, dès l’origine, une sourde dissidence entre les onze hommes qui se chargent de présider aux destinées de la France. On peut distinguer parmi eux trois groupes divers. Le plus nombreux comprend les républicains modérés, ceux qui considèrent la révolution comme accomplie, du moment que la monarchie censitaire et la Chambre des Pairs ont été balayées par la nation. Ce sont : Dupont de l’Eure, Arago, Crémieux, Garnier-Pagès, Lamartine, Marie et Marrast. Le plus avancé se compose des républicains socialistes Albert et Louis Blanc, partisans déclarés d’une profonde transformation économique. Entre ces deux extrêmes se placent, poids mobile oscillant de droite à gauche, des radicaux, des démocrates. Flocon, Ledru-Rollin, qui veulent très sincèrement des réformes sociales sans trop savoir lesquelles, mais qui n’entendent pas qu’on touche à la constitution de la propriété et au régime du salariat.
Les premiers correspondent à cette partie moyenne, instruite et aisée de la bourgeoisie, qui se sent majeure et capable de diriger, sans roi, sans cour et sans nobles, les affaires publiques ; les derniers résument en eux les velléités frondeuses et vaguement humanitaires des petits bourgeois, des petits boutiquiers, des petits artisans qui souffrent des impôts mal assis, des inégalités consacrées par la loi et accrues par le développement du grand commerce et de la grande industrie, mais sans être réduits à la condition précaire des travailleurs contraints de louer leurs bras pour vivre. Les autres, enfin, sont les porte-voix de la classe ouvrière proprement dite et de ses aspirations imprécises, mais nettement orientées vers un régime plus égalitaire qui doit s’établir par l’association des hommes et la socialisation des choses. Tous, d’ailleurs, reflètent les opinions et représentent les intérêts des villes, non des campagnes.
Gouvernement de concentration, gouvernement de compromis, hétérogène et discordant, capable de s’entendre sur quelques points d’un programme restreint, condamné, dès qu’il se présentera une question brûlante, à des tiraillements sans fin, à des défiances mutuelles, à des débats violents, à des solutions équivoques et bâtardes ! Amalgame d’éléments contraires, qui peut être bon pour la résistance à des ennemis communs et pour une époque rassise, mais qui l’est beaucoup moins pour l’action et pour un moment révolutionnaire ! Éclectisme périlleux qui paralyse les initiatives hardies, empêche toute politique énergique et suivie et qui, pratiqué de nouveau en 1870, n’a pas mieux réussi qu’en 1848 ; car l’unité de direction dans les grandes crises est une condition de salut. Les disputes inévitables de la majorité et de la minorité devaient conduire à la neutralisation des volontés, à l’impuissance qui naît de l’incohérence. C’est de cette maladie originelle qu’allait pâtir ce Gouvernement provisoire dont Proudhon a pu dire : « Il n’a pas su, voulu, osé. »
A peine constitué, il hésite à se qualifier, à s’engager sans retour. Républicain de fait, le sera-t-il de nom ? Osera-t-il devancer le vote de la nation sur un sujet de pareille importance ? Les témoins de ces heures troubles s’accordent à noter les scrupules et les tergiversations de Marie, de Garnier-Pagès, de Lamartine lui-même. Mais toute la journée, du milieu des groupes armés qui fourmillent sur la place de Grève montent des sommations d’en finir. Raspail donne deux heures au gouvernement pour se décider. Lagrange et des insurgés, qui se sont improvisés Délégués du Peuple et installés dans l’Hôtel de ville, surveillent et harcèlent les maîtres du pouvoir. Lamartine propose une formule longue et embarrassée. On amende, on simplifie. Les modérés ne veulent pas de la rédaction trop tranchante : Le gouvernement provisoire proclame la République. Les avancés ne veulent pas de la rédaction trop timide : « Le gouvernement provisoire désire la République. » Crémieux fait alors prévaloir ce moyen terme : « Le gouvernement provisoire veut la République, sauf ratification par le peuple, qui sera immédiatement consulté. »
Aussitôt des ouvriers, sur une large bande de toile blanche, charbonnent ces mots en lettres énormes : « La République une et indivisible est proclamée en France. » Ils grimpent sur le rebord d’une fenêtre et développent l’inscription à la clarté des torches. Une formidable acclamation retentit, suivie d’un cri de détresse. Un des ouvriers venait de tomber sur la place et on l’emportait tout sanglant. Les anciens auraient vu là un présage. Hélas ! La République de 1848, après avoir suscité un élan d’enthousiasme, devait tomber, elle aussi, dans le sang ouvrier.
La République était proclamée. Mais que devait-elle être ? Serait-elle un simple changement dans l’organisation politique de la France ? Toucherait-elle à son organisation économique ? Grave problème qui se posait de façon obscure en cette heure critique, mais qui allait se dégager en pleine lumière et devenir la question essentielle du moment. Les bourgeois avaient entendu, pendant la bataille, un cri qu’ils ne comprenaient pas : « Vive la République démocratique et sociale ! » Sociale ! Qu’est-ce que cela pouvait bien signifier ? Une estampe du temps figure la Révolution de Février sous les traits du sphinx classique, dévoreur d’hommes ; et c’était bien, en effet, une terrible, une mortelle énigme qu’elle posait à la France et à l’Europe.
Cela fut sensible dès le matin du 25 février. Des faubourgs et des quartiers pauvres étaient descendus sur la place de Grève des hommes armés de fusils, de sabres et portant, qui une ceinture rouge, qui un bonnet rouge, qui un ruban rouge au chapeau ; autour d’eux ils distribuaient des insignes rouges ; au-dessus d’eux ils faisaient claquer au vent des bannières rouges ; les maisons, l’Hôtel de ville, la statue d’Henri IV furent bientôt pavoisées de rouge, et le gouvernement provisoire fut sommé de remplacer le drapeau tricolore par le drapeau rouge.
A considérer froidement les choses, il faut avouer que le drapeau tricolore n’a pas grand sens comme symbole républicain, pour peu qu’on se reporte à son origine. Chacun sait comment il fut formé ; lorsque Louis XVI revint de Versailles dans sa capitale, le blanc, emblème de la dynastie des Bourbons, fut inséré entre le rouge et le bleu, couleurs du Tiers État et de Paris, pour marquer la réconciliation du peuple avec la royauté. Mais la première République l’avait gardé quand même ; l’Empire l’avait porté sur mille champs de bataille ; la Restauration l’avait abattu ; la Révolution de 1830 l’avait relevé. C’étaient ses titres anciens. En revanche il avait abrité la monarchie de Louis-Philippe, la domination exclusive de la bourgeoisie, le régime qui venait de sombrer ; il pouvait passer pour compromis dans la défaite. C’étaient ses torts récents.
Le drapeau rouge était celui qui avait flotté sur les barricades ; il avait figuré dans mainte émeute ; par cela seul qu’il devait être déployé chaque fois qu’au nom de la loi on sommait un attroupement de se disperser, il avait pris une signification révolutionnaire. Le drapeau de la répression par la force était devenu le drapeau de l’insurrection armée. Or l’insurrection était victorieuse ; il semblait avoir le droit d’être à l’honneur comme il avait été au combat.
Malheureusement les symboles sont vagues de leur nature ; ils ont surtout la signification qu’on leur prête et le drapeau rouge symbolisait deux choses différentes, que ne distinguaient pas toujours nettement ceux qui l’arboraient et que confondaient obstinément, soit peur, soit calcul, tous ceux qui s’en effarouchaient. C’était, d’une part, un passé tragique, vivant et flamboyant dans les mémoires, Quatre-vingt-treize, la guerre civile et la guerre à tous les trônes, l’échafaud, la Terreur ; c’était, d’autre part, l’avènement du « peuple » au pouvoir, l’obligation pour le Tiers État de compter avec le quatrième État, l’ascension des pauvres au rang des riches, le redressement du travail en face du capital, la poussée vers l’abolition des classes et du salariat, tout cet ensemble très vague qui, sous le nom de République sociale, s’esquissait à demi voilé dans la brume de l’avenir.
Ces deux significations du drapeau rouge, toutes deux également déplaisantes à la bourgeoisie, apparaissent clairement dans le conflit dont il est l’occasion. Lamartine, qui dirige la résistance à son adoption, lui reproche d’être un « symbole de sang », et, oubliant que le rouge est dans l’Église chrétienne l’emblème de la charité et qu’il brilla sur l’oriflamme des rois de France, il proteste contre une couleur « qui excite les hommes comme les brutes » ; il l’accuse d’annoncer « une république convulsive » ; et quand, harmonieux magnétiseur delà surexcitation populaire, il lance la phrase fameuse : « Le drapeau rouge n’a jamais fait que le tour du Champ de Mars, traîné dans le sang du peuple en 91 et 93, et le drapeau tricolore a fait le tour du monde avec le nom, la gloire et la liberté de la patrie… », il ne commet pas seulement une éloquente erreur historique, puisque Bailly, maire de Paris, fut précisément condamné pour avoir fait tirer sur des citoyens en omettant de déployer le drapeau avertisseur du recours à la force ; mais il laisse habilement dans l’ombre la moitié de la question ; il semble proscrire uniquement ce qu’il nomme « le drapeau de la Terreur » ; et pourtant il sait, il reconnaît lui-même qu’il y a autre chose dans le débat engagé, qu’en demandant le remplacement du drapeau tricolore ses adversaires entendent répudier un régime « où le riche continue à jouir et le pauvre à souffrir, le fabricant à exploiter l’homme en le condamnant au salaire ou à la famine » ; en un mot il sent très bien qu’il s’agit là d’une lutte de classes qui sont en désaccord, non point seulement sur des moyens, mais sur le but à poursuivre. « C’était, a-t-il écrit la lutte ouverte des prolétaires contre la bourgeoisie. »
Lamartine, racontant plus tard cette journée, qui fut sa journée, la fait finir dans une clarté d’apothéose dont il est le centre rayonnant et, sur la foi de son récit, l’histoire complaisante a docilement accepté la légende d’une multitude en délire soudainement apaisée par la puissance d’un grand charmeur et dupeur d’oreilles. La vérité est qu’il fallut autre chose pour calmer l’orage. ...