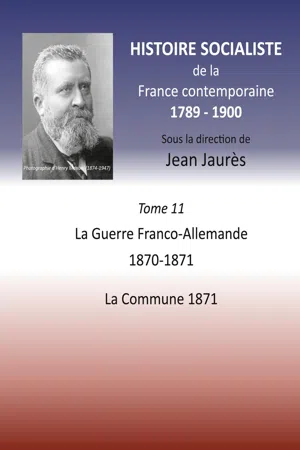![]()
LA COMMUNE
1871
par Louis DUBREUILH
![]()
Chapitre I
Paris assiégé
La Commune a surgi six mois trop tard. Quand les événements, et beaucoup plus la dérobade calculée de ses adversaires que l’impulsion résolue de ses partisans, la jetèrent enfin à la barre, l’occasion était manquée. Le mouvement prolétaire était vaincu d’avance, d’avance voué à l’écrasement et au massacre.
Au 8 octobre, au 31 octobre, dans le Paris du siège bouillonnant comme un cratère, dans ce Paris ivre de fureur sacrée et de vastes espoirs, aux énergies populaires intactes et frémissantes, c’était l’heure. Au 22 janvier, malgré le bombardement et le rationnement, malgré Champigny et Buzenval, il était temps encore.
La paix conclue, les forts livrés, les canons de l’étranger surplombant directement l’enceinte, de Saint-Denis jusqu’à Vincennes, et par delà, la province retombée entière à l’abdication et à l’inconscience animale, il n’y avait plus place que pour un geste héroïque, que pour un holocauste grandiose, mais quasi-vain. Les classes privilégiées avaient licence de se rire du soulèvement désespéré d’un peuple aux abois. Ce peuple, en effet, ne pouvait échapper à leurs prises que pour tomber sous la botte du Prussien, qui — elles en avaient la patriotique assurance — le leur aurait reconduit mitraillé et ligoté.
Qu’on se remémore l’autre Commune, la première, celle de 92 et de 93. Celle-ci n’a dominé, entraîné à sa remorque la Convention et, par la Convention, la nation, que parce qu’elle a voulu, parce qu’elle a su étreindre et étouffer ensemble, dans ses bras vigoureux, l’ennemi du dehors et le traître du dedans. Elle ne sériait pas dans son audace et dans son combat, et les coups, qu’au 10 août et au 2 septembre, elle frappait dans ses murs sur les conspirateurs et les ci-devant, comme ceux qu’à Valmy et à Jemmapes elle assénait, par ses sans-culottes sur la tête de l’envahisseur, visaient au même but, convergeaient à la même fin, à la ruine du vieux monde, qu’elle s’était donné mission d’abattre, pour que la Révolution s’accomplît. C’est cette double offensive qui lui a valu la maîtrise, qui lui a permis de balayer, sous son souffle orageux, comme un fétu de paille, royauté, noblesse, clergé, et de fonder une France nouvelle.
De même, la deuxième Commune n’avait raison d’être, possibilité de s’imposer, de durer et de vaincre, qu’en se dressant à la fois, Commune révolutionnaire, contre l’ennemi de l’extérieur, le Prussien envahisseur, et contre l’ennemi de l’intérieur, le bourgeois capitulard, et en courant sus du même élan à tous deux. Son salut et son triomphe étaient au prix de cette double action, de cette attaque simultanée, en ne distinguant pas entre le capitalisme coiffé du casque à pointe qui déferlait d’Allemagne et le capitalisme indigène, son complice, impatient de soumission et de capitulation, sachant bien que toute victoire parisienne eût été une victoire prolétaire, une victoire de la Révolution.
Tout au cours du siège, la classe ouvrière avait plus ou moins consciemment reconnu la nécessité de ce corps à corps avec l’intégralité des forces capitalistes, tant nationales qu’étrangères, et tout mis en œuvre, par ses éléments les plus perspicaces et les plus ardents, pour le provoquer.
De là les divers mouvements insurrectionnels conduits par les bataillons des quartiers les plus populeux, de Belleville, de Montmartre, dans le but de chasser de l’Hôtel de Ville les occupants bourgeois et d’y installer la dictature de la classe ouvrière, maîtresse de la République et du pouvoir.
L’occasion s’offrait extraordinairement tentante et favorable. Pour défendre Paris investi dès la mi-septembre et bientôt bombardé, il avait bien fallu, en effet, armer la population, appeler dans les rangs de la garde nationale tous les adultes valides. Au premier moment, on avait essayé d’une sélection, de s’en tenir à 80 ou 90,000 hommes plus ou moins triés sur le volet ; mais en présence de la volonté formelle, des démonstrations incessantes des faubourgs, des réclamations des maires talonnés par leurs administrés, force était d’aller jusqu’au bout, de fournir un équipement, des armes, des munitions à chaque citoyen. Ainsi, à côté de quelques milliers de hauts bourgeois, isolés, noyés dans ce vaste ensemble, coude à coude avec quelque cent mille hommes tirés de la boutique et du bureau s’étaient trouvés enrégimentés et armés deux cents ou deux cent cinquante mille prolétaires. Depuis 1793 on n’avait pas revu pareil spectacle : tous les habitants d’une ville, et de quelle ville ? de Paris capitale, en possession de ces deux instruments de libération : le bulletin de vote et le fusil.
Certes, l’on comprend les réserves gouvernementales et bourgeoises du début, les appréhensions et les alarmes qui suivirent et allèrent croissant jusqu’a la fin dans les conseils de la « Défense nationale ». Armer le peuple de Paris, c’était, en effet, du même coup, armer la Révolution et rompre, à l’avantage du producteur et du salarié, le savant équilibre de forces, qui seul rend possible la perpétuité de l’iniquité capitaliste.
Or, ce peuple, nul mieux que les trois Jules : Favre, Simon et Ferry, mieux que Picard, Garnier-Pagès et leurs comparses ne le connaissaient.
Ce peuple, c’était l’artisanerie du faubourg Saint-Antoine et du Temple et, derrière, les masses plus serrées et plus compactes encore des quartiers excentriques, pullulante fourmilières de travailleurs : Belleville, Montmartre, Grenelle, la Glacière, déjà pénétrés dans leur élite par la propagande socialiste : celle de Proudhon et de l’Internationale, celle des Blanquistes.
Depuis 1862, ce peuple remis de l’effroyable saignée de juin avait défié l’Empire dans un duel à mort, toujours en mouvement, toujours en éveil, assiégeant les clubs où retentissait la parole d’émancipation politique et sociale, se mobilisant sur les boulevards, à chaque occasion de manifestation, par dix mille et par vingt mille, se jetant par cent mille à la suite du char funèbre de Victor Noir.
Ce peuple, il est vrai, avait fait de Favre, de Picard et des autres ses représentants au Corps législatif. Pourquoi ? Parce qu’il croyait, avec leurs noms connus, leur célébrité de barreau ou de presse, qu’ils étaient des projectiles meilleurs, comme on disait alors, à lancer contre la bâtisse impériale ; mais il y avait longtemps qu’il avait cessé de placer en eux une confiance de tout repos. Presque quotidiennement, élus et électeurs s’étaient heurtés, les premiers se satisfaisant au jeu puéril d’une opposition de plus en plus platonique et loyaliste, se préparant peut-être à esquisser, à l’instar d’Emile Ollivier, une conversion complète vers l’Empire libéral, les autres poussant à l’opposition irréductible, irréconciliable, à la conquête de force de la République.
De ce peuple, comment donc Favre, Picard, Simon, devenus à leur tour le pouvoir, ne se seraient-ils pas défiés et gardés ? Dès lors, ils le redoutaient ; dès lors aussi, ils le haïssaient. Ils savaient trop, en somme, où ces masses en voulaient venir et que la République à laquelle elles avaient si passionnément aspiré, et qu’elles tenaient enfin, n’était pas pour elles comme pour eux un simulacre vain, la caricature des régimes de compression et de privilèges qu’elles avaient subis depuis quatre-vingts ans, mais la rédemptrice vivante et agissante, l’initiatrice des temps nouveaux rompant en visière à tout le passé, apportant dans les plis lourds de son péplum aux travailleurs spoliés et broyés : sécurité, bien-être, liberté, la vaincue et l’égorgée de juin 48, la République démocratique et sociale. Aux yeux des futurs bourreaux, bourgeois d’abord, républicains ensuite, s’il en restait, cette foi, déjà, était un crime, cette espérance un arrêt de mort.
Telle était, au 4 Septembre, la situation. Tels étaient les personnages du drame qui commençait et qui allait avoir son épilogue à la Commune.
Cependant, si, à cette heure solennelle, le peuple de Paris n’était pas son maître, s’il avait abdiqué une fois de plus, se déchargeant sur d’autres du soin de sa défense, c’était bien sa faute en attendant que ce fût son châtiment. Après avoir envahi le Corps législatif, en avoir chassé les laquais de l’homme de Décembre et proclamé la déchéance, il pouvait garder devers lui le pouvoir qu’il venait de conquérir. Entrainement, habitude, défiance de soi, de ses capacités politiques, il s’était remis lui-même entre les mains de ceux dont il était payé, il semble, pour savoir la débilité et la déloyauté et qui n’avaient d’autre titre que d’être ses élus, les élus de Paris.
Néanmoins, l’abandon populaire n’avait pas été si entier que dés le 4 Septembre, au soir, le gouvernement de la « Défense nationale », pas même installé, n’eut reçu la visite des premiers délégués de la classe ouvrière. Ces délégués sortaient de la Corderie. Ils étaient mandatés par la section parisienne de l’Internationale et la Fédération des Chambres syndicales ouvrières.
Ce fut Gambetta qui les accueillit et écouta leur communication.
Ces délégués venaient dire les conditions auxquelles eux et leurs commettants étaient disposés à mettre leur concours entier à la disposition du nouveau gouvernement.
Ces conditions étaient telles :
Élection immédiate à Paris des conseils municipaux, ayant mission spéciale, en outre de leurs fonctions administratives, d’organiser rapidement la formation des bataillons de la garde nationale et leur armement. — Suppression de la préfecture de police et restitution aux municipalités parisiennes de la plupart des services centralisés à cette préfecture. — Déclaration en principe de l’éligibilité et de la révocabilité de tous les magistrats et élection de ces magistrats dans le plus bref délai possible. — Abrogation de toutes les lois répressives, restrictives et fiscales régissant la presse ; reconnaissance du droit entier de réunion et de celui d’association. — Suppression du budget des cultes. — Annulation de toutes les condamnations politiques prononcées à ce jour ; cessation de toutes poursuites intentées antérieurement et libération de toutes les personnes incarcérées à la suite des derniers événements.
Ce programme, on peut en juger, en outre des mesures immédiates commandées par les circonstances, ne dépassait pas le programme sur lequel Gambetta en personne avait été élu un an auparavant, le programme de 1869, le programme de Belleville.
Le tribun répondit par des généralités, des phrases et des assurances vagues. Il parla d’amnistie, allégua que la liberté de la presse était d’ores et déjà un fait acquis par la suppression du timbre et du cautionnement. Pour le surplus, il promit son bienveillant examen et celui de ses collègues.
La vraie réponse vint le lendemain. Le gouvernement, au lieu de convoquer les électeurs, nommait lui-même, après le maire central de Paris, les maires et adjoints des vingt arrondissements, tous naturellement choisis parmi ses affiliés les plus complaisants et très nettement hostiles aux travailleurs. L’un d’eux, par exemple, M. Richard, maire du XIXe, ne se gênait pas pour déclarer « qu’on n’en avait pas assez tué en juin 48 ».
Défi évident et cynique. La Corderie le releva. Les organisations ouvrières qui, dès ce moment y avaient leur centre et qui devaient au reste, en tant que telles, se confondre bientôt dans des formations nouvelles et plus en rapport avec les obligations du moment, se virent immédiatement rejointes par une foule de citoyens et une association plus souple et plus forte y surgit spontanément. Cette association, appelée à un rôle de premier plan, se constitua sous le nom de Comité central républicain des vingt arrondissements.
Ce Comité central n’était que l’émanation, ainsi que son titre l’indiquait, des Comités d’arrondissement, créés à raison de un par arrondissement, l’organe de rapport et de coordination de ces groupements dénommés eux-mêmes : Comités républicains de vigilance.
Ces Comités de vigilance, pour leur compte, tiraient directement leur origine du suffrage populaire exprimé en réunion publique par les habitants de chaque arrondissement. Ils avaient pour mission de recueillir toutes les propositions et aussi toutes les réclamations des citoyens concernant l’administration et la défense. Ils s’attribuaient au surplus le contrôle et la surveillance de tous les magistrats et fonctionnaires locaux, maires, adjoints, etc., désignés, comme on le sait, par le pouvoir, et qui n’avaient que trop tendance à ne pas conformer leurs décisions et actes aux vœux et besoins de leurs administrés.
Chacun de ces Comités choisissait quatre de ses membres, quatre délégués qui, réunis aux délégués des dix-neuf autres arrondissements, soit, au total, quatre-vingts citoyens, formaient la représentation de l’ensemble, autrement dit le Comité central.
À peine constitué, le Comité central s’affirmait et prenait contact avec la capitale assiégée en affichant une déclaration adoptée dans ses séances du 13 et du 14 septembre et où il détaillait les mesures acclamées, sur son initiative, dans les réunions publiques de quartier, déjà soumises au gouvernement pour être traduites en décrets, mesures « ayant pour but de pourvoir au salut de la patrie ainsi qu’à la fondation définitive d’un régime véritablement républicain par le concours permanent de l’initiative individuelle et de la solidarité populaire. »
Ces mesures étaient de plusieurs espèces : mesures de sécurité publique, mesures visant les subsistances et les logements, mesures en vue de la défense de Paris, mesures en vue de la défense des départements.
Sur les premières, nous n’insisterons pas, puisqu’elles ne faisaient guère que répéter les propositions présentées, le soir même du 4 Septembre, au gouvernement par les délégués de la Corderie. Les deux dernières touchant à la défense de Paris et des départements se caractérisaient surtout en ce point qu’elles spécifiaient l’élection immédiate, par la garde mobile, de tous les chefs qui devaient la conduire au feu, au lieu et place des chefs jusqu’alors imposés d’en haut, ainsi que l’armement universalisé de tous les citoyens. Mais les plus typiques, sans contredit, les plus importantes de ces mesures étaient celles portées au titre : Subsistances et logements.
Voici comment, à ce sujet, s’exprimait, le Comité central :
« Exproprier, pour cause d’utilité publique, toute denrée alimentaire et de première nécessité actuellement emmagasinée dans Paris, chez les marchands en gros et en détail, en garantissant à ceux-ci le paiement de ces denrées, après la guerre, au moyen d’une reconnaissance des marchandises expropriées et cotées au prix de revient ;
« Elire dans chaque rue, ou au moins dans chaque quartier, une Commission chargée d’inventorier les objets de consommation et d’en déclarer les détenteurs actuels personnellement responsables envers l’Administration municipale ;
« Répartir les approvisionnements classés par nature entre tous les habitants de Paris, au moyen de bons, qui leur seront périodiquement délivrés dans chaque arrondissement, au prorata :
1° du nombre de personnes composant la famille de chaque citoyen ;
2° de la quantité de produits consommables constatée par les Commissions ci-dessus désignées ;
3° de la durée maximum probable du siège.
Les municipalités devront encore assurer à tout citoyen et à sa famille le logement qui lui est indispensable. »
Il est évident que si ces mesures, qui n’étaient du reste qu’un commencement, avaient reçu application, non seulement elles eussent entraîné une prolongation considérable du siège, mais encore apporté des modifications si profondes, si radicales dans les rapports des classes, qu’il aurait été bien difficile, la crise passée, d’en faire disparaître complètement les traces. Ces mesures, qui constituaient vraiment la dominante de la déclaration, supposaient que toutes les classes ainsi appelées concurremment à collaborer au sacrifice et à participer à la bataille, on verrait bien vite s’effacer, dans la privation commune et le péril partagé, les séculaires oppositions de luxe et de pauvreté, de raffinement et de grossièreté, d’instruction et d’ignorance, toutes les distinctions sociales, et qu’ainsi un régime socialiste, une république égalitaire se forgerait sur l’enclume de la guerre, au feu du canon de l’ennemi.
Tout l’esprit de la Commune vivait déjà dans ces mesures, dans cette déclaration, baptisée du nom éloquent d’Affiche rouge, et dont le rude appel, s’il avait été entendu, pouvait être le point de départ d’une régénération complète de la société française.
Tout l’esprit de la Commune y était et aussi — et ce n’est pas la remarque la moins suggestive — les hommes de la Commune. Sur les 46 signataires de l’affiche on retrouve, en effet, les noms de 11 de ceux qui devaient être, en mars ou avril, envoyés par le peuple de Paris à l’Hôtel de Ville : Cluserel, Demoy, Johannard, Lefrançais, Ch. Longuet, Benoit Malon, Oudet. Pindy, Ranvier, Ed. Vaillant, Jules Vallès ; et d’autres noms encore, comme ceux de Genton, de Millière, qui, lors de la répression versaillaise, s’inscrivirent au martyrologe des derniers défenseurs du drapeau rouge.
À ceci rien de surprenant, puisque le Comité central, la Corderie n’étaient en somme que le centre de ralliement des éléments les plus ardents, les plus militants, les mieux informés aussi, de ceux qui sondaient du coup d’œil le plus exercé et le plus sûr les douteuses perspectives de l’avenir. Toute la vie intense et tourmentée de la grande cité assiégée y refluait, s’y concentrait, s’y exaspérait ; son vouloir obscur de délivrance et d’émancipation s’y faisait conscient ; ses aspirations s’y matérialisaient en résolutions et en actes. La Corderie siégeait en quelque sorte en permanence. Les délégués des vingt arrondissements s’y rendaient chaque jour, l’après-midi, dans leur costume de garde national, ligne ou artillerie. Ils apportaient les nouvelles de leur milieu, s’éclairaient, se concertaient et décidaient ; puis revenaient le soir dans leur arrondissement respectif apporter au siège des Comités locaux, dans les clubs de quartier, les informations générales puisées à source sûre, dévoiler à leurs commettants les ...