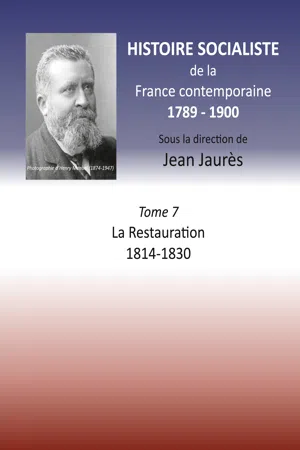![]()
TOME VII
LA RESTAURATION
1814-1830
par René VIVIANI
![]()
Première partie
De la première à la seconde capitulation de Paris
Du 30 mars 1814 au 8 juillet 1815
![]()
Chapitre premier
La première abdication
La première capitulation de Paris. — Situation de la capitale. — La noblesse et la bourgeoisie. — Défilé des alliés. — Réunion chez Talleyrand. — M. de Vitrolles. — Le Sénat et la déchéance. — Napoléon à Fontainebleau. — Les maréchaux. — Défection de Marmont. — L’abdication. — L’Ile d’Elbe.
Le 1er janvier 1814, la coalition européenne avait jeté près d’un million de soldats sur la France. Le flot sombre des uniformes lointains avait mis près de trois mois à recouvrir le pays, depuis la frontière de l’est jusqu’à Paris. Les ennemis ne s’approchaient qu’avec une terreur mêlée de respect de cette capitale jusqu’alors inviolée, et qui semblait devoir tenir toujours en réserve quelque prodige. Mais le 30 mars, pour la première fois depuis bien des siècles, Paris aperçut la fumée d’un camp ennemi. Enserré par plus de deux cent mille hommes, il subit la mitraille continuelle. À l’intérieur de la ville, vingt mille hommes, débris d’armées épuisées et refoulées, résistaient encore, mêlés de polytechniciens, aussi d’hommes du peuple. Les chefs, Mortier, Moncey, Marmont, coupés de l’empereur depuis des jours, déshabitués, par la formidable initiative du conquérant, de toute énergie propre, se battaient en soldats, ne commandaient pas en généraux. Sous les pas de l’ennemi, peu à peu ils reculaient, ayant sous leurs ordres, quelquefois contradictoires, exactement l’effectif suffisant pour couvrir un cinquième de l’énorme enceinte qu’il eût fallu défendre. De la ville morne aucun enthousiasme ne jaillissait ; aucune peur non plus n’apparaissait. Sauf en ses quartiers populaires les plus exposés, Paris semblait absent de lui-même. Pendant la fusillade, alors que les obus tombaient sur les quartiers qui constituent maintenant la Trinité, la population, sur les boulevards, échangeait à voix basse ses impressions.
Le matin du 30 mars, l’impératrice et le roi de Rome, sur la pression de Joseph et du conseil, en dépit de l’opposition calculée de Talleyrand, avaient quitté Paris. Leur carrosse, suivi d’innombrables voitures, avait amené hors de Paris, en Touraine, l’impératrice qui quittait sans une larme, sans un regret, un trône que la loi des diplomaties lui avait imposé. Le long convoi, le triste convoi de l’Empire, avait défilé sous le regard de quelques passants, et cette fuite d’une dynastie attestait l’inutilité de la défense. Joseph, il est vrai, restait, médiocre représentant de l’empereur, invisible et intolérable. Mais à qui n’avait pas su conserver Madrid et le trône d’Espagne, l’autorité manquait pour protéger Paris et le trône de Napoléon. Du reste, au mépris d’une promesse solennelle, lui aussi devait fuir… Cependant, il avait laissé à Marmont la latitude de capituler quand l’heure semblerait décisive.
Le duc de Raguse, dont la capacité militaire aurait répudié, si elle l’eût pu, la terrible tâche de défendre Paris, continuait le combat. Mais le cercle noir des uniformes enserrait de plus en plus la ville, l’étouffait, devenait son seul horizon. Rien que sous la pression physique de tant d’hommes, les combattants, peu à peu, reculaient. Les postes étaient intenables. Les barrières emportées et reprises, et emportées encore, ouvrirent au flot les rues de la ville. Maintenant on se battait de maison à maison, de porte à porte, et les fenêtres étaient des créneaux. Marmont, blessé, les habits en lambeaux, l’épée dans sa seule main valide, n’était plus que le chef dérisoire d’une armée fictive… Vers les quatre heures, il dépêcha vers l’ennemi des parlementaires. Si vive était la fusillade que le premier fut tué, les deux autres furent blessés. Labédoyère revint, ne pouvant se faire jour à travers la mitraille. Enfin, par la route où commandait le général Compan, et qui était plus protégée, un parlementaire se put montrer. Il parla, offrit une suspension d’armes. Le feu cessa vers les cinq heures du soir.
Était-ce là tout l’effort que pouvait tenter Paris ? N’avait-il pas des hommes et des munitions ? N’aurait-il pas dû être organisé en vue d’un siège que la plus élémentaire prudence devait prévoir ? Est-ce la trahison, est-ce l’inertie, est-ce l’anarchie, est-ce l’ignorance qui furent les complices de la défaite ? Napoléon, en tous cas, était le premier coupable. Coupable de n’avoir pas prévu, dès le mois de janvier 1814, que la coalition tendait vers Paris ; coupable de n’avoir pas armé la capitale ; coupable de n’avoir pas compris que la reddition de Paris, ce n’était pas seulement une défaite militaire, mais une catastrophe dynastique.
Il a prétendu, il est vrai, avoir laissé des ordres, et le témoignage du général Dejean, son aide de camp, par lui dépêché à Joseph en fuite et qu’il rejoignit au bois de Boulogne, demeure décisif. Mais un chef tel que lui, habitué à tout prévoir et qui avait fait si souvent entrer la faiblesse humaine dans ses calculs, ne se contente pas de donner des ordres : il laisse des subordonnés capables de les comprendre et de les exécuter. Or, sur qui reposait, en ces journées décisives, la confiance de Napoléon ? Sur son frère Joseph dont il avait mesuré la médiocrité en toutes matières et en toutes occasions ; sur le ministre de la guerre Clarke, duc de Feltre, qu’une carrière exclusivement menée dans les bureaux prédisposait peu à des responsabilités soudaines. Puis, près d’eux Hullin, en qui le général n’avait pas effacé le simple soldat, Savary, absorbé par le contrôle minutieux et policier que comportait sa charge. Et c’est tout. Fallait-il s’étonner si ces médiocrités réunies n’avaient pu faire face au péril ? Une seule explication peut être tentée : c’est que Napoléon espérait revenir à Paris. Mais cependant, s’il devait revenir, pourquoi avait-il donné des ordres inconciliables avec sa présence ? Et, quand il a vu qu’il ne pouvait se rejeter dans Paris, pourquoi n’avoir pas chargé d’une mission de fermeté et de résistance un maréchal ? Il y avait bien Mortier, il y avait bien Marmont. Mais ils étaient venus, sans le savoir, s’engouffrer dans Paris, les Prussiens derrière eux ; et si, au lieu de se jeter dans ses murs, ils eussent bifurqué vers le centre ou vers la Loire, Paris n’avait pas un seul homme de guerre pour préparer sa défense.
La responsabilité générale de Napoléon est donc complète : c’est sur lui, à travers ses représentants médiocres et incapables, que pèse le poids de la capitulation qui se prépare. Il est vrai que, par certains détails, la responsabilité de Joseph et celle de Clarke sont mises en suffisant relief. Il n’était pas nécessaire d’être un homme de guerre accompli, il suffisait d’être un administrateur pour parer au péril. Il y avait dans Paris plus de soixante mille hommes, si l’on veut compter les gardes nationales, les officiers sans emploi et qui en réclamaient, les ouvriers anciens soldats, au nombre de vingt mille, et qui, rebutés dans leur requête, ne purent qu’errer, lamentables et inutiles, à travers une ville où, secrètement, tout ce qui était riche et possédait prenait parti pour l’ennemi. Tout cela manqua. Manquèrent aussi les canons. Il y en avait deux cents au parc de Grenelle : on en plaça six pour défendre Montmartre, six pièces de six auxquelles on apporta des boulets de huit ! Le pain, le vin manquèrent : et plus de soixante mille rations de pain, vingt mille de vin étaient rentrées dans Paris après l’avoir quitté. On put nourrir les alliés, on ne put nourrir les vingt et un mille combattants du dernier jour, qui, cependant, résistèrent au delà de l’épuisement humain.
Mais qu’importe ? Et même si Paris eût prolongé la résistance, même si l’empereur, tant attendu, eût pu se glisser parmi les défenseurs de la ville, même alors, le sort politique eût été semblable et semblable l’arrêt du destin. Il était trop tard pour l’empereur dont le génie militaire avait besoin, pour prendre son essor, de s’appuyer aux réalités vivantes qui, maintenant, faisaient défaut. C’était peu de chose que l’armée de Paris, presque un fantôme errant sur les remparts ébréchés. Et pardessus tout manquait la grande âme à qui la défaite souffle un enthousiasme héroïque. Où était-elle, en ces tristes journées d’humiliation, la grande âme de Paris ? Où était le Paris des enrôlements volontaires, où étaient sa flamme, son courage et son orgueil ? Où était la France ? Napoléon, qui a dû poser la question, a dû entendre la réponse, et le million d’hommes que son geste de conquérant avait fauchés a dû défiler, en un éclair sinistre, devant sa mémoire…
Marmont avait donc signé la suspension des hostilités. Pour lui, la dualité effroyable des devoirs allait maintenant commencer. Chef militaire, il avait gagné des heures pour permettre à l’empereur, dont des émissaires annonçaient l’approche, de venir saisir d’une main souveraine les responsabilités dernières. Dans l’effroyable tourmente de fer et de feu qui menaçait de déraciner Paris, il avait arrêté une suspension d’armes. Mais la trêve était de courte durée et le canon devait, dès minuit, à nouveau retentir. Que faire ? Attendre ? Mais l’heure courait, courait avec les contradictions ironiques du temps, courait pour lui, Marmont, avec une rapidité meurtrière, tandis que pour Napoléon, en carriole de poste sur la route de Paris, les lentes et mortelles minutes à peine se succédaient. Et puis, il subit le contact de la ville, la vue des habitants, entendit leurs plaintes. Il entendit les doléances adroites du commerce, de la finance, et les arguments ingénieux de la haute banque surent, par la bouche de MM. Laffitte et Perregaux, trouver le chemin de son cœur. Cependant, que faire ? Qu’un chef militaire, submergé pour ainsi dire par le destin, signe une suspension d’hostilités, cela est possible. Qu’un chef militaire signe même une capitulation purement militaire, cela encore est dans son droit, opprimé par la force. Mais pouvait-on se faire illusion sur la portée politique de la capitulation de Paris ? Ce n’était pas seulement la ville ouverte à l’ennemi, c’était le trône, c’était l’Empire qui étaient livrés… Cependant, l’heure courait : sur les hauteurs de Paris, la mort, la mort, encore la mort se dressait. Au bas, toutes les rumeurs tour à tour grondantes et adulatrices, la menace, la prière, le sentiment, l’intérêt, les hommes du monde, les hommes d’affaires, tout ce qui cherchait en la paix le repos, le plaisir, le luxe, tout fut pour Marmont une intolérable contrainte. Dans cette ville, tout ce qui possédait désirait secrètement la paix, et, puisque la paix dépendait du succès des armes ennemies, souhaitait l’abominable triomphe : l’armée épuisée, le peuple silencieux, la bourgeoisie et l’autocratie impériale ardemment attachées à la capitulation, tel était le spectacle qui s’offrait à Marmont.
« Je ne suis pas le chef du gouvernement, disait-il.
— Mais vous avez eu le pouvoir de signer un armistice qui protège les troupes, qui leur ouvre la route paisible de la Touraine ; allez-vous partir et livrer la population à ce bombardement ? »
C’était là la logique. De plus, Marmont se trompait sur ses pouvoirs : il avait reçu de Joseph l’autorisation de capituler, et qu’était Joseph, sinon le représentant de l’empereur, dépositaire de ses ordres et de ses volontés ?
Et Joseph avait, par la fuite de Marie-Louise, par la sienne, attesté deux fois que le gouvernement trouvait la ville intenable. Pourquoi des milliers d’êtres auraient-ils péri quand ceux qui avaient tiré d’eux honneurs et pouvoir tournaient le dos au péril? Tout se coalisait contre le duc de Raguse : il céda. Il choisit comme représentant dans les négociations le colonel Fabvier et la capitulation de Paris fut signée. Ainsi, par un destin singulier, c’était Marmont qui assistait à l’agonie sanglante de l’Empire : seize ans plus tard, toujours commandant en chef, il assistera à l’agonie sanglante de la Restauration. En seize ans, ses mains auront tenu et laissé choir deux couronnes.
La capitulation avait été signée à minuit. Le lendemain devait marquer le défilé à travers Paris des troupes alliées. La coalition allait enfin pouvoir chevaucher victorieuse dans les rues de cette capitale où tant de merveilles étaient accumulées. C’était la capitale de la Révolution, la capitale de l’Empire, la cité prodigieuse d’où tant d’éclairs avaient à l’Europe annoncé la foudre. Au devant des cinquante mille hommes admis à cette fête de la victoire marchait l’empereur Alexandre. Il était pâle et grave, sentant enfin qu’il jouait le rôle entrevu par un orgueil qui voulait se déguiser en bonté, maître de Paris, touchant au but, rendant à Napoléon la triomphale visite de Moscou qui avait vu les aigles victorieuses, comme Paris voyait maintenant les aigles vaincues. À sa droite, Schwartzenberg, le généralissime, représentant l’empereur d’Autriche, le père de Marie-Louise encore impératrice des Français. À sa gauche, le roi de Prusse. Le cortège impérial s’arrêta à la porte Saint-Martin et de là le défilé commença. Il devait durer la journée entière et ne se terminer qu’à cinq heures du soir. Un ciel de printemps par sa clarté douce s’était fait le complice de cette fête de la force. Jamais, dans une journée plus lumineuse, une plus éclatante avalanche d’uniformes bariolés n’avait passé ; jamais, sauf dans les autres capitales, en d’autres temps, quand l’ambition napoléonienne imposait aux vaincus la dure loi qui maintenant l’abaissait.
Une particularité, qui fut vite expliquée, causa, a-t-on dit, un malentendu politique, un peu trop grossier cependant. Tous les soldats de la coalition portaient un brassard blanc au bras droit.
Le bruit se répandit que c’était un symbole de paix auquel la population opposa le même symbole en arborant des mouchoirs blancs. On dit qu’Alexandre prit ces mouchoirs blancs pour des symboles royalistes et fut frappé de la sympathie subite dont étaient entourés les Bourbons. Cela paraît bien inadmissible, d’autant plus que la raison pour laquelle le brassard avait été placé fut divulguée : les troupes de la coalition s’étant un jour, dans la mêlée des uniformes, méconnues au point de se fusiller, le brassard leur devait servir de signe de reconnaissance.
Une foule immense, sans cesse accrue, couvrait les rues, si bien que les colonnes ennemies, presque étouffées, flottaient avant de retrouver leur route. La crainte des officiers, des officiers russes surtout, la crainte plus tard avouée par eux, fut très vive. Dans les quartiers populeux, aux environs de la Bastille, le peuple avait manifesté à la fois sa tristesse et sa fureur. Des cris de : Vive l’Empereur étaient partis, moins pour saluer à l’agonie une dynastie condamnée que pour condenser dans une acclamation sonore toute la colère et toute la protestation. Même un officier russe, saisi, désarçonné, blessé, n’avait été arraché des mains populaires que par la force. Mais, à mesure que le défilé s’avançait dans Paris, ceux qui le guidaient perdirent leur crainte. Dès qu’il eut pénétré dans les quartiers riches, sur les boulevards, à la fureur marquée dans les quartiers populaires succéda, sans même la transition du silence, l’accueil le plus chaleureux. Tous ceux qui possédaient, toute la richesse, toute la noblesse acclamaient la coalition victorieuse de la patrie. Une atmosphère d’adulation enveloppait les alliés.
À la Madeleine, ce fut du délire, on criait : « Vivent les libérateurs ». Des cosaques libéraient la France ! Mais on criait surtout : « Vivent les Bourbons ! » Une troupe de jeunes hommes, ardente, active, circulait, acclamait la royauté d’autrefois. Ce cri n’avait aucun écho. Peu d’hommes, sauf les vieillards, avaient entendu crier : « Vive le Roi. » Quant aux Bourbons, la splendeur impériale avait fait tort au pâle souvenir que l’on aurait pu garder de princes médiocres. On criait tout de même. Des balcons mondains, surchargés de femmes élégantes, descendaient des baisers. Quelques dames de l’aristocratie et de la bourgeoisie rompirent les rangs des soldats pour remercier plus tendrement « les libérateurs ». La comtesse de Dino, nièce de Talleyrand, monta en croupe sur le cheval d’un cosaque. D’autres rivalisaient de bassesse, et, tandis que les filles publiques elles-mêmes gardaient leur prostitution de cette souillure, les femmes du monde comblaient de leurs caresses les soldats meurtriers d’autres soldats — qui étaient couchés aux portes de Paris.
Quatorze mille alliés, en effet, six mille Français étaient morts, des blessés agonisaient sans soins ni remèdes, et la saturnale royaliste continuait. Les hommes ne furent pas inférieurs dans cette émulation des servitudes. Un Maubreuil attacha à la queue de son cheval la croix d’honneur. Un Sosthène de La Rochefoucauld voulut, en vain, faire tomber sur la place Vendôme la colonne. Bien entendu, il avait reçu de Napoléon un suprême bienfait : la restitution de ses biens confisqués par la Révolution, aux temps de l’émigration. L’empereur Alexandre, le grand-duc Constantin, le roi de Prusse cachaient à peine leur dégoût. L’un se rappelait que la jeunesse allemande s’était levée pour mourir en face de l’invasion. L’autre se rappelait que l’aristocratie russe avait fait de Moscou un désert avant d’en faire un brasier. Et leurs yeux étonnés mesuraient, en cette journée d’humiliation, la profondeur de la chute. C’était bien la chute, en effet. La souillure n’était pas dans la défaite qui suit la victoire, dans l’invasion d’une France vidée par le despotisme, dans la reddition de la capitale, ni certes dans le triomphe éphémère de l’ennemi. La souillure était là, dans l’accueil que la bourgeoisie enrichie par la Révolution, l’aristocratie impériale et l’aristocratie royaliste faisaient aux soldats envahisseurs. Certes la guerre avait été terrible, et la défaite napoléonienne apparaissait à quelques-uns comme le gage du relèvement de la patrie. Jamais pays n’avait plus mérité le répit que cette pauvre France. Depuis vingt ans, par mille plaies ouvertes, son sang avait coulé, et ses veines, comme les yeux des mères, étaient taries. Le spectacle offert était effroyable. Toute la jeunesse fauchée avant l’âge, l’adolescence elle-même enrôlée, les ateliers et les sillons vidés pour emplir la caserne et, dans les villes, seulement des vieillards et de tout jeunes hommes, la virilité ravie par la bataille incessante. Des réfractaires hâves, pâles, traqués ; des mères dont les lèvres se chargeaient de malédictions muettes. Ni commerce ni industrie. C’était là que l’avidité d’un homme, l’ambition désordonnée, une fureur de conquêtes avaient mené la France. C’est vrai, et jamais on ne trouvera de trop sombres couleurs pour ce tableau… Mais qui avait acclamé, au retour de ses chevauchées à travers l’Europe, l’homme néfaste par qui sombrait la patrie ? Qui avait trouvé les flatteuses formules pour ajouter à l’auréole du génie qui venait de ravager le monde ? Les mêmes femmes, les mêmes hommes, la même société, la même lie qui, maintenant, débordait dans les rues pour acclamer le vainqueur. Pendant tout le temps qu’avait duré l’infernale conquête, aucun d’eux n’avait élevé la voix, et les parlementaires et les nobles avaient laissé à une femme le bénéfice immortel des invectives jetées au colosse. Même, ne pouvant ou n’osant protester, ils n’avaient pas gardé devant cette débauche de la force ce silence empreint de dignité et de dédain qui inquiète la victoire elle-même.
C’est seulement en 1814, après s’être tu devant les victoires impériales, qu’à la veille des défaites de la patrie, M. Lainé, à la Chambre, avait osé parler ; et même, en M. Lainé, on sentit bien plus tard que seul le royaliste, et non le patriote, s’était ému, quand on le vit, à Bordeaux, hisser le drapeau blanc sous la protection de Wellington, et accepter d’être le préfet de la Gironde avec l’appui des baïonnettes anglaises. Les uns avaient mendié, comme la famille des La Rochefoucauld, comme celle de Talleyrand. D’autres avaient trafiqué, comme les Laffite et les Péréjoux, et ce n’est pas eux qui avaient souffert de l’interminable combat. Au contraire, le peuple avait protesté ; un jour, dans le quartier Saint-Antoine, un jeune homme atteint par la conscription s’était placé derrière l’empereur et avait injurié le tyran. En vain la police impériale l’avait voulu capturer. D’autres fois, des conscrits criaient dans la capitale, appela...