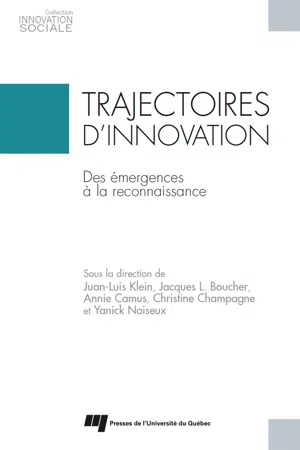![]()
PARTIE 1
Approches transformatives de l’innovation sociale
![]()
1 LA REFONDATION DU DÉBAT SUR L’INNOVATION SOCIALE1
Jean-Louis Laville
Dans les politiques publiques ou dans la recherche universitaire la notion d’innovation sociale bénéficie d’un consensus favorable. Qui aujourd’hui oserait critiquer ce qui semble avoir les atouts de la modernité et de la créativité tout en répondant à des besoins sociaux réels ? Néanmoins, s’il y a consensus, c’est parce que l’innovation sociale est une formule polysémique qui permet à des acteurs différents de se l’approprier. Comme il a été exposé dans des textes précédents (Laville, 2014, 2016a), l’apparent accord sur la notion ne doit pas occulter le fait qu’elle renvoie à deux acceptions contrastées : la première a pour horizon un changement synonyme de démocratisation de la société ; la seconde se contente d’une amélioration du modèle économique dominant. En ce sens, l’innovation sociale actualise une opposition séculaire entre deux versions, forte et faible, de la solidarité.
La conception de l’innovation sociale reposant sur une solidarité forte et visant à amener une transformation a été au centre des recherches pour lesquelles les approches du CRISES font référence tant en Amérique du Nord qu’en Europe (Klein, 2017). Toutefois, avec l’amplification des politiques d’austérité, visibles dans la deuxième décennie du XXIe siècle, une évolution des politiques publiques donne la priorité à une approche fonctionnelle correspondant à la version plus faible de la solidarité. Cette orientation a profondément déstabilisé la version forte de l’innovation sociale. D’une part, la recherche de légitimation conduit à atténuer les différences avec la version faible pour se faire reconnaître de la part d’autorités indifférentes ou hostiles ; d’autre part, cette banalisation suscite des critiques dénonçant l’innovation sociale comme un leurre mis en place par les pouvoirs existants afin de maintenir leur emprise sur la société.
L’hypothèse défendue dans cette contribution est que l’innovation sociale, pour ne pas être écartelée entre ces tendances contradictoires, doit faire l’objet d’un questionnement épistémologique, théorique et méthodologique renouvelé.
1. L’innovation sociale, entre normalisation et dénonciation
La notion d’innovation sociale réactualise une vieille controverse entre deux conceptions, forte et faible, de la solidarité. L’architecture institutionnelle dominante du XXe siècle a confondu solidarité forte et intervention de l’État social avec la mise en place de nombreuses politiques publiques. À la fin du siècle dernier, le recours à la notion d’innovation sociale témoigne de l’effacement de la synergie entre marché et État sous les effets cumulatifs des crises culturelle et économique. Alors que la crise culturelle amène les nouveaux mouvements sociaux sur le terrain des innovations sociales dans la société civile et des initiatives citoyennes, la crise économique conduit à une autre approche des innovations sociales comme élargissement des innovations technologiques. Si les séparations entre les deux démarches ne sont plus étanches, au début du XXIe siècle, ce sont bien deux régimes de production, de régulation et d’appropriation (Pestre, 2006) de l’innovation sociale qui se sont mis en place. Ceux-ci correspondent à deux modèles de développement et de société différents.
1.1. Une inflexion en faveur de la version faible de l’innovation
Au Québec, comme ailleurs, la période de crise du début des années 1980 a été considérée comme « fertile en innovations sociales » et la recherche a permis d’amplifier « leur repérage et leur reconnaissance » grâce en particulier à « des partenariats de recherche avec les intervenants du milieu » (Bouchard, 2011, p. 11). Dans la même veine, des innovations telles que l’insertion par l’activité économique ont engendré des modes d’action publique inédits, ouvrant la voie à un État social qualifié d’actif (Gardin, Laville et Nyssens, 2013). Dans ce contexte, l’économie sociale et solidaire est un vecteur important d’innovation sociale, susceptible d’influer sur le cadre institutionnel comme c’est le cas avec ce qui a été appelé « le modèle québécois » (Lévesque et Petitclerc, 2008). Toutefois, les effets cumulatifs des politiques d’austérité des dernières années nous ont conduits vers un autre modèle. Cette trajectoire ne saurait être éludée alors qu’une seconde vague de néolibéralisme présente un discours explicite sur la question sociale.
En effet, la première vague de néolibéralisme (Hayek, 1983 ; Friedman, 2016) vise l’institution d’une concurrence généralisée par le transfert d’activités publiques ou non lucratives vers le secteur marchand. L’isomorphisme marchand auquel est soumis l’ensemble des activités productives est censé produire une uniformisation décisive pour aller vers une société de marché. Ce registre économique est lié à un second, plus politique. Si l’objectif est de restreindre le périmètre d’intervention de l’État, il s’agit également d’endiguer les revendications émanant des nouveaux mouvements sociaux et de contrecarrer par une remise en ordre économique une « extension indéfinie de la démocratie rendant les sociétés ingouvernables » (Crozier, Huntington et Watanuki, 1975). Autrement dit, la démocratie ne vaut que si elle n’entrave pas la concurrence libre. Les préconisations néolibérales ont été largement adoptées par les gouvernants, comme en témoigne le consensus de Washington qui, en 1989, recommande le recours à des mécanismes de marché, une intervention publique minimale et l’ouverture accentuée à la concurrence internationale. Les résistances rencontrées, dont les rassemblements altermondialistes ont été emblématiques, alertent alors les pouvoirs économiques et politiques sur les risques accrus de tensions avec les populations.
C’est pour se prémunir contre ce danger que s’élabore le discours dans lequel le mécanisme « froid » de la concurrence est complété par les valeurs « chaudes » (Foucault, 2004, p. 247-248) de l’entreprise sociale et de l’innovation sociale. À mesure que l’on avance dans le XXIe siècle, la seconde vague de néolibéralisme affirme en effet que le capitalisme peut être moralisé et que l’innovation sociale, par la mobilisation des outils de l’entreprise, peut mieux s’attaquer aux questions sociales. L’innovation sociale est dès lors systématiquement convoquée dans son acception faible qui a vocation à reconfigurer les initiatives citoyennes. Ce qui caractérise cette vague, c’est donc un recours explicite à l’innovation sociale, avec une propension comme au XIXe siècle à privilégier la lutte contre la pauvreté. Plusieurs écoles théoriques (ressources marchandes, innovation, managérialisme) participent à son déferlement.
▪ L’école des ressources marchandes recommande la mobilisation accrue de ces ressources dans les associations sans but lucratif afin de mieux remplir leurs missions (Skloot, 1987 ; Young et Salamon, 2002).
▪ L’école de l’innovation insiste pour sa part sur la personnalité de l’entrepreneur, agent de changement privilégié (Bornstein, 2004).
▪ Enfin, l’école du managérialisme combine les deux précédentes et y ajoute une valorisation inédite du management censé contrôler le bon usage des ressources investies. Elle est fondée sur une croyance dans les vertus de la gestion pour résoudre les problèmes sociaux. Le managérialisme est en effet « un système de description, d’explication et d’interprétation du monde à partir des catégories de la gestion » (Chanlat, 1998) ; il accorde une place prioritaire à la performance, à la rationalité instrumentale et à l’auditabilité (Avare et Sponem, 2013, p. 142).
Cette troisième école promeut une nouvelle normativité dans le social par mimétisme avec les entreprises privées, comme l’exprime nettement Yunus (2008) se réclamant d’un social business, qui est un capitalisme à but social, pouvant s’autofinancer sur le marché. C’est bien l’épreuve marchande qui est privilégiée par tout un appareillage qui va très fortement lier le social business à de grandes entreprises. Des montages comme ceux faits au Bangladesh avec Danone et Veolia sont peu nombreux mais se présentent comme l’expression d’un modèle général qui permettrait d’éradiquer la pauvreté et serait applicable dans la culture (Hearn, 2014), comme pour l’aide internationale (Faber et Naïdo, 2014). Ce récit du sauvetage des pauvres par leur retour sur le marché à travers des formes de capitalisme à but social est relayé par de nouveaux instruments du marketing, ce que l’on appelle les techniques de bottom of the pyramid ou bas de la pyramide. Tout cela s’articule avec la venture philanthropy, c’est-à-dire une philanthropie beaucoup plus soucieuse de la rentabilité de ses investissements. Un outillage complémentaire est proposé : les social impact bonds ou investissements à impact social, qui permettraient de faire prendre en charge les actions sociales par des investisseurs privés, ceux-ci étant remboursés de leur prise de risque quand l’action réussit et au contraire, perdant leur mise si l’action échoue. Au total, c’est tout un appareillage du capitalisme à but social qui s’impose comme une évidence à travers ces outils. Social business, bottom of the pyramid, venture philanthropy, social impact bonds, tous ces termes émanant de l’univers anglo-saxon sont repris par la Commission européenne dans les textes sur l’innovation sociale. L’hypothèse sous-jacente est claire : il n’y a qu’une seule manière de faire de l’économie, mais le capitalisme peut se doter d’un but social. L’innovation sociale, dans cette perspective de solidarité faible, va dans le sens d’un plaidoyer pour la capacité d’auto-réforme du capitalisme et de sa moralisation. Dans ce schéma, l’innovation sociale ne promeut pas la transformation sociale, mais œuvre plutôt en faveur de la seule réparation sociale.
Dans ce contexte, l’innovation sociale comporte différentes caractéristiques. La première réside dans le parallèle entre capitalisme et néo-capitalisme. Au XIXe siècle, la naturalisation du capitalisme comme économie moderne a été sous-tendue par l’affirmation de sa capacité à procurer la richesse aux nations et aux populations. La non-réalisation de cette promesse a entraîné une inflexion philanthropique, le développement capitaliste devant s’accompagner d’une compassion envers les plus pauvres, indissociable d’un contrôle de leur comportement. Cette « entreprise de moralisation des pauvres », selon les termes de Thompson (1988), a signifié une réduction de la question sociale à celle de la pauvreté. C’est cette même évolution en phases que l’on retrouve dans le néocapitalisme. Centré dans la première étape de la fin du XXe siècle sur le rétablissement d’une concurrence généralisée, il l’a complétée au début du XXIe siècle par une rhétorique de l’innovation sociale. Ciblant des groupes bénéficiaires, elle réintroduit une forme de paternalisme à leur égard. Avec les objectifs du millénaire au début du XXIe siècle, les stratégies de réduction de la pauvreté s’ajoutent aux programmes d’ajustement structurel généralisés dans le sillage du consensus de Washington. Des collectivités publiques réduisent les coûts dans les dépenses sociales tout en lançant des appels d’offres pour l’innovation sociale. Certes, le vocabulaire adopté s’enrichit de l’inclusion, de l’empowerment et de la sécurité économique mais sans que soient touchées la déréglementation des marchés et les politiques macroéconomiques d’austérité (Bacqué et Biewener, 2015, p. 91). Dans ce modèle, l’innovation sociale a pour objet de générer des apprentissages et de faciliter l’acquisition de compétences au niveau microéconomique sans que soient prises en compte les affectations de ressources au niveau macroéconomique.
En conséquence, la deuxième caractéristique importante tient à ce que la forme de l’entreprise est privilégiée comme mode d’action, à tel point que l’on peut se demander avec Laval (2007) si celle-ci n’est pas devenue la seule forme légitime de l’action collective. En tout cas, elle renvoie toutes les autres formes d’expression de la société civile au passéisme. Cette invalidation symbolique évoque encore celle qui, pendant des siècles, a frappé les cultures et économies indigènes, assimilées à des formes d’organisation arriérées pour fonder la confusion entre économie capitaliste et modernité. Cette attention à l’entreprise fait le lien avec la figure de l’entrepreneur social. Cet entrepreneur est envisagé comme un acteur rationnel et engagé qui conduit et gère l’entreprise sociale sous le double angle du social et de l’économique.
La troisième caractéristique découle de la deuxième. L’argumentaire est un plaidoyer pour l’action privée, qui concilie réactivité et proximité, s’opposant ainsi à une action publique identifiée à la bureaucratie. Le regroupement entre société civile et entreprises est encouragé dans une démarche qui, en Grande-Bretagne, a réuni ces entités dans l’idée d’un secteur indépendant dès les années 1980, puis d’une Big Society dans les années 2000. La conséquence, comme l’ont noté Defourny et Nyssens (2013a, p. 31), peut en être « un processus de hiérarchisation et de sélection des défis sociaux en fonction de leur possibilité à être traités sur un mode entrepreneurial et marchand ».
Ce faisant, et c’est la quatrième caractéristique, s’opère un choix contraire à celui de l’État social ; la solidarité n’est plus un ensemble de règles défini par les mécanismes de la démocratie représentative, mais elle résulte plutôt de l’action éclairée d’acteurs privés, entreprises, mécènes ou fondations. Cette résolution privée de la question sociale induit une dépolitisation. Elle peut même favoriser la dérive de la démocratie vers la ploutocratie, si l’on reprend les craintes exprimées par Barkan (2013) et justifiées par la puissance de certaines fondations.
Ce constat ne signifie pas que les modalités de coopération entre entreprises, pouvoirs publics et société civile sont à condamner. Toutefois, il alerte sur le formatage de ces partenariats suivant les buts poursuivis par des interlocuteurs privés en raison de leurs seuls moyens financiers. Surtout, cette approche faible décourage la réflexion sur les problèmes de pouvoir en optant pour l’empirisme et en se défiant de toute théorie qui ne cadrerait pas avec le mainstream économique et gestionnaire. Elle ignore les données sociologiques et anthropologiques sur la structure des rapports sociaux.
1.2. Un risque accru de normalisation et de dénonciation
L’engouement dont bénéficie cette vision auprès des gouvernements subissant de fortes contraintes budgétaires n’est pas sans conséquences sur le discours de justification de l’ESS (économie sociale et solidaire). Cette dernière, on le sait, se démarque du référentiel philanthropique pour intégrer la lutte contre les discriminations et les injustices ; elle insiste moins sur la personnalité des entrepreneurs et plus sur la dimension collective des entreprises ; elle s’ouvre à l’articulation avec les politiques publiques. Cependant, elle souffre d’insuffisances.
Tout d’abord, en confondant ESS et entreprises d’ESS, elle adhère à cette survalorisation de l’entreprise véhiculée par le néolibéralisme. Ce faisant, elle marginalise certaines expériences actuelles significatives (circuits courts, monnaies sociales locales, etc.) ainsi que les composantes associatives (où se situent la majorité des emplois et des activités), bénévoles et informelles (d’où émergent une partie non négligeable des actions de la société civile). Ensuite, la centralité accordée à l’organisation dans la théorisation de l’économie sociale (type d’entreprise, distribution des bénéfices, distribution du pouvoir) a entretenu un flou quant aux définitions de l’économie et de la solidarité retenues. Cela se traduit par une variabilité des discours sur le positionnement économique allant de la volonté d’une réussite sur le marché jusqu’au souhait de constituer une alternative au capitalisme, ainsi que par une appréhension réductrice de la solidarité à travers le prisme de l’intérêt (intérêt mutuel dans le cas de service aux membres, intérêt général dans le cas de service à la collectivité). De plus, l’ESS doit expérimenter des modalités d’action susceptibles de conforter des fonctionnements démocratiques, qui ne peuvent pas être garantis uniquement par la propriété collective, et d’autoriser des négociations sur le cadre institutionnel.
En somme, l’ESS se présentant comme « large et inclusive » constitue un compromis politique nécessaire et rassembleur susceptible d’en favoriser la reconnaissance. Si l’on s’arrête là, néanmoins, sa dimension conceptuelle n’est pas traitée. Sur ce plan, il importe de rappeler qu’il n’y a pas deux ensembles d’organisations, les unes d’économie sociale, les autres d’économie solidaire, qu’il s’agirait de réunir. La problématique de l’économie solidaire vient d’une réflexion sur l’incomplétude théorique de l’économie sociale : elle vise à introduire des définitions de l’économie et de la démocratie qui autorisent une approche compréhensive des initiatives. Celles-ci sont des entreprises mais ne sont pas que des entreprises : elles ont une dimension citoyenne d’espace public dans la société civile, pour parler comme Habermas (1993), ou d’enquête sociale, pour parler comme Dewey (2010).
Le déficit de problématisation de l’ESS débouche sur un isomorphisme normatif et un alignement au moins partiel sur une visi...