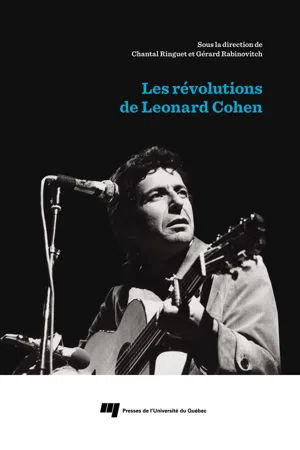
- 296 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
Les révolutions de Leonard Cohen
À propos de ce livre
Leonard Cohen est l'un des plus grands auteurs-compositeurs-interprètes de l'époque contemporaine. Son œuvre présente un remarquable concentré de ce qui fait l'âme du monde juif – le désir d'échapper à un destin chargé de souffrances et de rémissions, la capacité de se réinventer par-delà l'origine, l'exil et la perte –, tout en étant bien «?de son temps?», c'est-à-dire profondément ancrée dans la culture nord-américaine. Elle est surtout ponctuée de nombreuses révolutions qui surgissent dans et par le langage, qu'il soit poétique, romanesque, musical ou spirituel.
Pour saisir les effets et les traces découlant de ces révolutions, sont réunis dans cet ouvrage les textes de chercheurs, d'artistes, d'écrivains et de traducteurs dont le parcours, les intérêts et les réalisations présentent des affinités d'ordre littéraire, musical ou sentimental avec Leonard Cohen. Laissant transparaître leur sensibilité, leur attachement, voire leur amour pour Cohen, les auteurs dévoilent les multiples facettes de ce grand artiste qui inspire, fascine et subjugue. Leurs réflexions, à la fois intimistes et fouillées, jettent un nouvel éclairage sur cette œuvre qui ne cesse d'éblouir par sa force créatrice et par son pouvoir de refléter les «?paradoxes de la modernité?».
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Les révolutions de Leonard Cohen par Chantal Ringuet,Gérard Rabinovitch en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Littérature et Critique littéraire nord-américaine. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
ET TRANSMISSION,
DE PERTES EN DEUILS
Tantra et transcendance dans Les perdants magnifiques de Leonard Cohen1
Hugh Hazelton
Les perdants magnifiques de Leonard Cohen est l’un des romans les plus anarchiques, les plus innovateurs et les plus cruciaux de la littérature canadienne. De forme protéique, il franchit souvent la frontière entre les genres lorsque son lyrisme hautement poétique se mue en poème en prose et que les narrateurs changent abruptement de sujet sous l’impulsion de leurs propres caprices d’association qui semblent souvent aboutir à un collage d’images éclectiques. Comme le fait remarquer le critique Dennis Duffy: «Par son énergie, cette centrifugation étourdissante, Les perdants magnifiques ressemble à l’une de ces machines de Tinguely, une œuvre habile d’une grande ingéniosité, qui vibre jusqu’à se disloquer en morceaux2.» En raison de son caractère expérimental extrême et de la juxtaposition parfois débridée d’éléments en opposition, le roman est souvent considéré comme typique de son époque, et même daté par elle. Toutefois, en la relisant cinquante ans après sa publication en 1966, le lecteur est surpris par sa contemporanéité, et même son actualité, puisque sous cet assemblage à première vue chaotique d’éléments disparates, Les perdants magnifiques est un texte élaboré avec soin et imprégné d’une cosmologie étonnamment cohérente.
Les perdants magnifiques a été rédigé à cette époque exaltante d’expérimentation sexuelle et de libération politique, une période où «la magie [était] vivante3» pour citer ce puissant hymne à l’Esprit dans la deuxième section du livre. Sous son étrangeté, toutefois, le roman fait appel de manière adroite et complexe à l’engagement du lecteur, aux doubles, au symbolisme, aux parallèles historiques, aux associations de mots, ainsi qu’aux références à la littérature et à la culture populaire, qui ont tous été réunis et assemblés avec grand soin dans la configuration d’ensemble. L’exubérance et l’imprévisibilité du livre, son caractère ludique inhérent et ses multiples niveaux d’interprétation reposent sur les fondements solides d’une vision remarquablement cohésive – celle d’une lutte entre les principes de la douleur et du plaisir, l’affirmation ou le rejet de l’énergie vitale et le désir de transcendance qui donne forme à la fois au catholicisme janséniste et à la philosophie tantrique bouddhiste et hindoue.
Les voix narratives
Trois voix narratives se partagent le roman. Toutes anonymes, elles racontent chacune un des trois «livres» du roman. Le Livre I, intitulé «Leur histoire à tous», est écrit à la première personne par un historien qui fait des recherches en vue de rédiger la biographie de Catherine Tekakwitha (maintenant désignée sous le nom de Kateri), la Mohawk du XVIIe siècle convertie au catholicisme, dont la mortification extrême et le vœu de chasteté en ont fait une sainte aux yeux du peuple. Elle sera canonisée en 2012 (ses reliques sont conservées dans un sanctuaire à Kahnawake, village mohawk à l’ouest de Montréal). Même s’il est profondément déprimé et solitaire, le narrateur s’isole complètement. Dans une métaphore de l’exploration de l’inconscient, il se terre dans son appartement au sous-sol d’un immeuble, il s’éloigne du monde naturel, apparemment pour écrire sur la vie de Catherine. Toutefois, il a atteint une impasse: sa vie et son œuvre ont perdu leur sens et il essaie de comprendre comment le retrouver, tout en souffrant de constipation extrême (et extrêmement métaphorique). Son esprit divague et il mêle constamment ses souvenirs, des réflexions sur sa vie personnelle et des remarques à l’intention de F., son ami décédé, et de sa défunte épouse Edith, au sujet des notes prétendument historiques auxquelles il travaille.
Le Livre II, «Une longue lettre de F.», est aussi écrit à la première personne et prend la forme d’une missive adressée à l’historien par F., son mentor et amant, découverte après la mort de ce dernier. Les rôles de lecteur et d’auteur du roman sont inversés: le «Je» de la première section devient le «Tu» du deuxième livre. F. a écrit cette lettre d’un hôpital carcéral pour aliénés où on l’a interné pour avoir fait sauter une statue de la reine Victoria. À la suite de l’attentat, il a perdu son pouce (son phallus) et meurt à petit feu d’une maladie vénérienne dégénérative non précisée – probablement la syphilis – qui finira par lui faire perdre la raison. Le personnage de F. est beaucoup plus résilient que les deux autres narrateurs, et il réussit à écrire toute sa lettre en ayant une main enfouie dans le vagin de son infirmière – qui s’avérera être une complice. Il termine aussi la biographie de son ami sur Catherine Tekakwitha, après avoir visiblement deviné que l’historien ne la terminerait jamais. À la fin de sa lettre, F. découvre à l’intérieur du vagin de l’infirmière un message révolutionnaire enveloppé dans de la toile cirée, «écrit à l’encre sympathique, et [les] humeurs [de l’infirmière] ont joué le rôle d’un révélateur» (p. 292). Il finit par s’enfuir de l’hôpital.
Le Livre III des Perdants magnifiques, «Épilogue à la troisième personne», est la seule section qui n’est pas entièrement racontée à la première personne. Son protagoniste, un ermite, semble être un amalgame de l’historien et de F., peut-être une incarnation des enseignements de F. dans la forme corporelle de son ami. L’ermite, qui vit depuis d’innombrables années dans un état méditatif – ou du moins inconscient – dans une cabane perchée dans un arbre chez F., est couvert de feuilles et de crasse. Il évoque Valmiki, le narrateur de Ramayana, qui
resta assis durant des années, sans bouger, à ce point immobile que des termites avaient érigé une termitière par-dessus lui [et] Valmiki demeura assis à l’intérieur […] durant des milliers d’années, ne laissant voir que ses yeux, essayant de trouver la Vérité, les mains jointes et l’esprit perdu dans sa contemplation4.
Un jour de printemps, il se réveille et se rend au centre-ville de Montréal en autostop où il atteint la moksha en étant transformé en film de Ray Charles projeté sur le ciel nocturne au-dessus du boulevard Saint-Laurent, la Main. Charles lui-même, un Noir américain aveugle qui a été exploité sans pitié par l’industrie du disque au début des années 1960, pourrait être ici le symbole de la victime ultime, le Perdant magnifique suprême, qui est aussi, bien entendu, possiblement le révolutionnaire le plus convaincu et le plus transcendant qui soit. Les dernières pages de l’épilogue reviennent au point de vue de la première personne et sont probablement écrites par un troisième narrateur-observateur qui a trouvé ou rédigé les autres manuscrits.
Toutefois, deux autres personnes font partie intégrante du texte. La première, bien entendu, est Catherine Tekakwitha, dont on découvre la personnalité et l’histoire au fil du roman. La deuxième est le lecteur. Linda Hutcheon, qui a comparé Les perdants magnifiques à Trou de mémoire d’Hubert Aquin, a évoqué les «difficultés herméneutiques» que présentent ces deux romans, où «le lecteur doit “trouver un sens” aux ambiguïtés délibérées, aux paradoxes, voire aux contradictions du texte5». Les perdants magnifiques implique le lecteur à la fois directement et indirectement. L’historien-narrateur du Livre I parsème son profil hagiographique (qui se désintègre progressivement) de la vie de Catherine Tekakwitha d’invocations constantes et d’apartés à l’intention des trois personnes, toutes décédées, qui ont le plus compté dans sa vie. Il interpelle sa femme Edith; il demande conseil à son ami F.; il décrit sa vie sexuelle à la sainte et lui raconte à quel point il est en train de s’enticher d’elle; il prie Dieu pour être compris. Le lecteur en vient à jouer le rôle des interlocuteurs disparus de ces conversations imaginaires. F. adresse sa lettre narrative à son ami historien dans un ton chaleureux, comme s’il discutait avec lui, lui parle comme son professeur, l’encourage ou le réprimande, fait appel à la ruse pour combler les vides, s’informe sur ses anciennes vicissitudes d’un air moqueur, anticipant ses moindres objections ou protestations pendant qu’il écrit. À la fin du roman, l’observateur-narrateur non identifié (s’agit-il encore de F.?) adresse cet envoi au lecteur, dans les mêmes termes que ceux que F. a utilisés auparavant pour parler à son ami historien: «Salut à vous qui me lisez aujourd’hui. Salut à toi qui me brises le cœur. Salut à toi, ami, à qui je manquerai toujours sur le chemin de la fin» (p. 317). Le lecteur est donc devenu le confident direct du narrateur et portera ensuite son œuvre dans le monde.
Le triangle amoureux
Les perdants magnifiques est axé sur un triangle amoureux bien campé dans une constellation de symboles. L’intrigue du roman est toute simple: F. éveille progressivement l’historien et sa femme amérindienne à l’extase spirituelle et sexuelle. Les deux personnages masculins sont hautement individualisés, tandis qu’Edith est beaucoup moins clairement définie. Pourtant, sous cette caractérisation se trouvent certaines figures très archétypales. L’historien lui-même est un Canadien anglophone qui a cherché le sens de la vie au moyen du rationalisme, mais a obtenu un résultat mitigé. Après la mort de sa femme et celle de son meilleur ami, il s’isole de plus en plus et se détache de son corps (un état symbolisé par sa constipation chronique, son laisser-aller et son besoin irrépressible de se masturber) et du monde extérieur (même l’animatrice des Disques du Petit Matin à la radio lui raccroche au nez). F. et l’historien ont grandi ensemble dans le même orphelinat montréalais (peut-être un symbole des Amériques abandonnées par leurs parents européens). F. (la lettre évoque sans doute le mot «fuck»), un Québécois francophone, est depuis longtemps le mentor spirituel et sexuel tyrannique de son ami et a une liaison avec Edith. Les enseignements de F. consistent à rejeter toute forme de répression et de systématisation de la vie, et d’aspirer à la transcendance par les expériences sexuelles. F. est aussi un révolutionnaire politique et social. Dans Les perdants magnifiques, le triangle est ainsi constitué des relations entre les Anglo-Canadiens, les Franco-Canadiens et les Premières Nations du Canada (et leur territoire).
Le personnage d’Edith est décrit en termes archétypaux fortement ancrés. À titre de l’une des dernières survivantes de la tribu indienne des Abishags, dont la «brève histoire est marquée par d’incessantes défaites» (p. 13), elle fut une victime sous plusieurs aspects. À l’âge de treize ans, elle fut violée par un groupe de jeunes Blancs de son village qui représentent l’esprit des habitants de la région: «Ils la rattrapèrent dans une carrière ou une mine abandonnée, un endroit minéral et très dur, propriété indirecte d’intérêts américains» (p. 84). Elle eut si peur «qu’elle en pissa sous elle» (p. 86). Ses agresseurs en perdirent leur érection et «s’acharnèrent sur l’enfant» avec l’index et des objets divers: tuyau de pipe, stylo à bille et petites branches d’arbre (p. 87). Elle implora sainte Kateri (Catherine Tekakwitha) (p. 87). Elle est l’Indienne violée par les Blancs, le Canada victimisé par les États-Unis, la Nature assaillie par l’Homme, la spiritualité et la beauté profanées par une civilisation matérialiste sans pitié et, bien entendu, elle est identifiée à Catherine Tekakwitha.
Des années plus tard en Argentine, à la fin de leur orgie dans un hôtel, F. renonce à jouer au Pygmalion avec le corps et la personnalité d’Edith. Il lui demande: «Qui es-tu?» Elle répond étonnamment en grec: «Je suis Isis, qui engendre tout, et aucun mortel n’a relevé mon voile» (p. 240). Cette déesse de la fertilité dans l’Égypte ancienne a été identifiée dans la mythologie comme l’épouse d’Osiris, dieu de la renaissance et de la vie éternelle. Selon le mythe, lorsque Osiris (serait-ce F.?) a été tué par un frère jaloux, Isis et Anubis, dieu funéraire et protecteur des embaumeurs (l’historien), le ramènent à la vie. Plus tard, comme l’explique Dennis Lee dans Savage Fields, son analyse du roman de Cohen, le culte d’Isis
se répandit ...
Table des matières
- Couverture
- Page légale
- Table des matières
- Introduction: D’une révolution à l’autre, une œuvre signée Leonard Cohen - Chantal Ringuet
- La contribution des Juifs à la musique populaire, de la France à l’Amérique - Jean-Claude Kuperminc
- DE L’ART À LA GUERRE, UN APPEL À LA RÉVOLTE
- TRAJECTOIRES DANS LE LANGAGE. L’EXIL, DE L’ÉTRANGER AU FAMILIER
- UN ACTE CRÉATEUR ALLIANT GRAVITÉ, DANSE ET GRATITUDE
- TRANSCENDANCE ET TRANSMISSION, DE PERTES EN DEUILS
- Liste non exhaustive des œuvres de Leonard Cohen
- Notices biographiques
- Quatrième de couverture