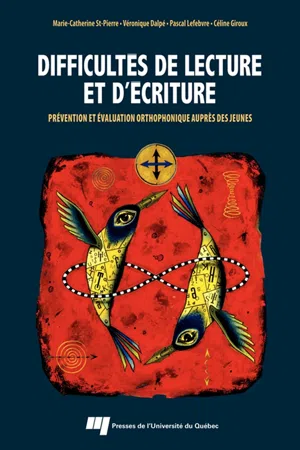
eBook - ePub
Difficultés de lecture et d'écriture
Prévention et évaluation orthophonique auprès des jeunes
- 298 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
Difficultés de lecture et d'écriture
Prévention et évaluation orthophonique auprès des jeunes
À propos de ce livre
Plusieurs jeunes présentent des difficultés de lecture et d'écriture. Cela nuit à leurs apprentissages, à la poursuite de leurs études et à leur implication active dans la société. Les intervenants qui travaillent auprès de ces jeunes doivent considérer une grande diversité de courants de pensée, ce qui complexifie la prise de décisions quant aux actions à entreprendre pour les aider._x000D_
_x000D_
En établissant un pont entre les connaissances scientifiques contemporaines et l'expertise clinique, cet ouvrage est l'un des rares en langue française qui propose des pratiques fondées sur les données issues de la recherche en langage écrit. Plus précisément, ce livre adopte une perspective langagière des difficultés de la lecture et de l'écriture et suggère une démarche clinique aux orthophonistes impliqués dans la prévention et l'évaluation des difficultés du langage écrit. Il s'agit d'une ressource indispensable à la formation et au perfectionnement des orthophonistes et des intervenants œuvrant en langage écrit auprès de la petite enfance et des jeunes d'âge préscolaire et scolaire.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Difficultés de lecture et d'écriture par Marie-Catherine St-Pierre,Véronique Dalpé,Pascal Lefebvre,Céline Giroux en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Bildung et Bildung Allgemein. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
Sujet
BildungSujet
Bildung Allgemein
Courants théoriques et langage écrit
Pascal Lefebvre et Marie-Catherine St-Pierre
Devant la pression croissante pour l’imputabilité des intervenants face aux services offerts à la population, les professionnels sont appelés de toutes parts à adopter une pratique fondée sur les faits scientifiques. Cette pratique implique non seulement l’utilisation des données les plus probantes fournies par la recherche, mais aussi l’expertise du clinicien ainsi que la prise en considération des caractéristiques particulières du client (Sackett et al., 2000). Ainsi, le clinicien doit s’appuyer sur son expérience et sur les ressources qui sont à sa disposition pour juger dans quelle mesure les résultats des différentes études effectuées auprès d’une population plus large s’appliquent au contexte, aux valeurs, aux attentes et aux préférences de l’individu auprès duquel il intervient. Cette analyse de la part du clinicien permet non seulement d’augmenter les chances de réussite des activités proposées, mais aussi de favoriser l’adhésion du client au processus thérapeutique. Cette pratique permet ainsi d’offrir les meilleurs services possibles tout en rehaussant la réputation des professionnels auprès de leur clientèle (Justice et Fey, 2004). L’implantation de ce type de pratique constitue néanmoins un défi de taille pour les intervenants de toutes les disciplines, incluant l’orthophonie (Kent, 2006). Pour ce faire, l’orthophoniste doit utiliser des critères rigoureux pour juger de la qualité des évidences scientifiques et se permettre de critiquer l’opinion des figures d’autorité lorsqu’elle entre en contradiction avec ces évidences (Johnson, 2006).
La pratique basée sur les faits scientifiques ne se limite cependant pas à l’application pure et simple de résultats issus d’études rigoureuses sur le plan méthodologique. Elle exige aussi des professionnels qu’ils soutiennent la pertinence de leurs activités cliniques par un raisonnement théorique. Le recours à une théorie valide et appuyée permet au clinicien de mettre en relation les éléments pertinents reliés au client, à l’activité clinique offerte et aux résultats escomptés. Il s’avère donc essentiel pour les orthophonistes de connaître et de comprendre les théories reliées au développement et aux troubles de la communication qui fournissent des explications documentées par des recherches scientifiques. Les modèles qui en découlent offrent des cadres de référence qui permettent au clinicien de bien cerner un problème, de le comprendre et de prendre les décisions éclairées menant à une prise en charge appropriée pour son client.
Les modèles théoriques de la lecture et à l’écriture sont particulièrement abordés dans le cadre de cet ouvrage. À ce sujet, deux grands courants théoriques ont marqué et marquent toujours l’étude du développement et du fonctionnement du langage écrit: celui des sciences cognitives et celui des sciences sociales. Selon la perspective adoptée, le langage écrit peut donc être considéré sous des angles tout à fait différents. De plus, à l’intérieur même de chacun de ces courants, s’inscrivent plusieurs familles de théories qui apportent un éclairage différent sur le développement et le fonctionnement du langage écrit. Le présent chapitre vise à décrire les principales caractéristiques de ces théories ainsi que leur apport respectif aux activités des orthophonistes en matière de prévention, d’évaluation et d’intervention en langage écrit.
1.1 LES SCIENCES COGNITIVES
Les théories des sciences cognitives ont émergé notamment de la mise en commun des connaissances en linguistique, en psychologie et en sciences informatiques. Historiquement, ces théories ont révolutionné la psychologie au milieu du XXe siècle en proposant d’inférer les fonctions mentales humaines (Hiebert et Raphael, 1996). Cette idée s’opposait aux principes fondamentaux du behaviorisme, voulant que seuls les comportements observables puissent être décrits. Les théories des sciences cognitives conceptualisent les habiletés de lecture et d’écriture comme des mécanismes mentaux qui s’enclenchent chez l’individu et qui peuvent être étudiés hors de leur contexte habituel d’utilisation (Sfard, 1998; Stone, 2004). Ainsi, les chercheurs des sciences cognitives en sont venus à proposer des explications concernant le développement et le fonctionnement de ces mécanismes à partir des comportements de l’individu lors de tâches décontextualisées impliquant les habiletés sollicitées en lecture et en écriture. Au XXIe siècle, les avancées technologiques des neurosciences ont ouvert une nouvelle fenêtre pour étudier les mécanismes cognitifs de la lecture et de l’écriture. Les paradigmes neurophysiologiques (potentiels évoqués cognitifs, imagerie par résonance magnétique) permettent de recueillir des informations quant à l’activité cérébrale générée par l’exécution d’une tâche ciblée. L’activation neuronale ainsi captée permet de préciser la localisation des aires cérébrales et le décours temporel des activations impliquées dans la réalisation de la tâche. Cette avenue contemporaine permet aux chercheurs des sciences cognitives de confirmer la présence d’un fonctionnement cérébral particulier sous-jacent aux comportements, alors que celui-ci devait auparavant être inféré.
Trois types de théories émanent du courant des sciences cognitives: les théories développementales, les théories du traitement de l’information et celles du constructivisme. Ces théories tentent de décrire le fonctionnement mental de l’individu lors de l’apprentissage ou de l’usage du langage écrit. Elles précisent aussi le rôle joué par l’environnement de l’individu qui se limite à l’exposition nécessaire au développement des mécanismes cognitifs impliqués dans le traitement du langage écrit.
1.1.1 Les théories développementales
Les théories développementales se basent sur des données empiriques qui permettent de tracer un portrait des comportements reliés au langage écrit selon une séquence de développement. C’est donc à partir d’observations des comportements des enfants pendant leur apprentissage de la lecture et de l’écriture que divers modèles décrivant des stades d’acquisition du langage écrit ont été proposés.
Au début du XXe siècle, les travaux de Morphett et Washburne (1931) ont servi d’assises à la théorie de la maturation, qui stipulait que les enfants n’avaient pas les capacités mentales pour apprendre à lire et à écrire avant l’âge de 6 ans et demi. Ce n’est qu’à la fin des années 1970 que Holdaway a proposé la théorie du développement de la littératie (1979), mettant ainsi terme à cinquante ans d’influence de la théorie de la maturation dans le domaine de l’éducation. La théorie du développement de la littératie de Holdaway proposait que, dès les premières années de vie, l’enfant commence à apprendre des comportements reliés à la lecture et à l’écriture en observant les adultes, en interagissant avec eux, puis en expérimentant par lui-même ces comportements. Cette théorie était le précurseur de ce qu’on appelle aujourd’hui les théories de l’éveil à l’écrit (Emergent Literacy Theories) (Clay, 1966; Whitehurst et Lonigan, 1998) et de la littératie familiale (Family Literacy Theories) (Taylor, 1983; Morrow et Neuman, 1995). Ces théories affirment que le développement de la lecture et de l’écriture fait partie prenante du développement du langage d’un enfant, et ce, dès sa naissance. Ce développement serait fortement influencé par l’environnement familial dans lequel l’enfant se retrouve.
À travers son caractère innovateur, la théorie de Holdaway (1979) a également ouvert la porte à une foule de modèles développementaux dits « par stades ». Parmi les modèles les plus connus, on retrouve ceux de Frith (1985) et de Chall (1983). Certains de ces modèles portent sur l’acquisition de la lecture uniquement, d’autres rendent plutôt compte du développement de l’écriture alors que quelques-uns décrivent les relations entre les deux. Ces modèles par stades, développés en anglais, emploient une terminologie variée pour décrire les étapes du développement, comme l’illustre le tableau 1.1.
Au-delà des divers modèles proposés et de leurs mécanismes sous-jacents, il appert qu’un consensus peut se dégager de ces nombreuses théories (Stahl et Murray, 1998). Apprendre à identifier et à orthographier des mots repose sur la mise en place précoce de deux types de mécanismes, soit le mécanisme logographique (utilisation des indices visuels de la forme des mots) et le mécanisme alphabétique (conversion séquentielle entre les graphèmes et les phonèmes de la langue), qui constituent en quelque sorte la fondation du développement orthographique. Bien que partageant généralement cette conceptualisation, ces théories diffèrent toutefois relativement au moment et à la séquence d’apparition de ces deux mécanismes dans le développement. Contrairement à une installation séquentielle des mécanismes logographiques et alphabétiques, Seymour (1993, 1997) propose plutôt un développement parallèle de ces derniers, faisant en sorte qu’ils contribuent conjointement au développement de l’orthographe. Cette conceptualisation repose sur l’existence d’interactions entre les mécanismes logographiques et alphabétiques qui seraient essentielles au développement des habiletés orthographiques. Ces interactions entre les éléments de nature visuelle des mécanismes logographiques et de nature phonologique des mécanismes alphabétiques seraient ainsi au cœur de l’élaboration du système orthographique.

Les théories proposant des modèles développementaux par stades ont été critiquées parce que la majorité des enfants ne franchissent pas nécessairement tous les stades de façon obligatoire. Des théories parallèles, dont celles par vagues superposées (Overlapping Waves Theories) (Siegler, 2000; Varnhagen, McCallum et Burstow, 1997) et celles par répertoire (Repertoire Theories) (Kelman et Appel, 2004), ont été proposées afin de pallier ce problème. Dans les théories par vagues superposées, on utilise davantage le terme « phase » plutôt que « stade », laissant ainsi entrevoir plus de souplesse et de perméabilité entre les différentes étapes développementales. Selon les théories par répertoire, à chacune des phases, le jeune utiliserait plutôt un ensemble de stratégies différentes selon la familiarité et la complexité des mots qu’il rencontre et les connaissances linguistiques qu’il a acquises.
Les modèles issus des théories développementales décrivent les étapes de l’apprentissage du langage écrit ainsi que les habiletés cognitives qui sont nécessaires pour passer d’un stade à un autre. Les chercheurs qui les ont élaborés et utilisés pour l’étude de l’acquisition du code écrit sur un plan fondamental n’ont pas établi de liens étroits entre la théorie et la pratique clinique. Ces approches ont par contre défini des cadres de référence utiles pour les intervenants et ces modèles s’avèrent pertinents pour la pratique de l’orthophonie en langage écrit. D’une part, les théories d’éveil à l’écrit et de littératie familiale servent de fondements aux activités de prévention des difficultés de lecture et d’écriture. En effet, les activités de stimulation et de dépistage visant des habiletés particulières d’éveil à l’écrit ainsi que les actions à poser afin de favoriser la collaboration de la famille et des autres milieux de vie de l’enfant sont issues de ces théories. D’autre part, en ce qui concerne les modèles développementaux par stades, ils sont utiles pour élaborer des programmes d’activités adaptés au niveau scolaire des enfants, pour déterminer des repères développementaux, pour situer les performances des enfants lors de l’évaluation orthophonique, de même que pour déterminer des objectifs de traitement et d’intervention adaptés au niveau de développement.
1.1.2 Les théories du traitement de l’information
Parallèlement à la description de séquences développementales de comportements reliés à l’écrit par l’intermédiaire des théories développementales, les chercheurs du domaine des sciences cognitives se sont également penchés sur le fonctionnement du cerveau humain. Les théories du traitement de l’information ont alors généré des modèles fonctionnels, c’est-à-dire qui tentent d’expliquer quelles sont les procédures cognitives mises en branle lors de la lecture et de l’écriture et comment celles-ci sont orchestrées. Dans ces modèles, l’individu est donc considéré comme un « processeur » traitant les stimuli provenant de son environnement. La vitesse et la qualité du traitement effectué par ce processeur dépendent de la nature et de la quantité des informations à traiter (Stone, 2004). Les théories du traitement de l’information ont proposé deux principaux types de modèles expliquant, entre autres, la lecture et l’écriture: les modèles d’architecture fonctionnelle et les modèles connexionnistes.
Les modèles d’architecture fonctionnelle
Les modèles d’architecture fonctionnelle de la lecture et de l’écriture ont pour objectif de rendre compte des différentes étapes de traitement impliquées. Dans ces modèles, les composantes de traitement sont représentées par des boîtes et les interactions uni- ou bidirectionnelles sont représentées par des flèches. Le modèle proposé se veut une représentation fidèle de la séquence des opérations cognitives effectuées par les lecteurs et les scripteurs compétents. Ces modèles ont été élaborés à partir d’études de cas chez les adultes cérébrolésés (Caramazza, 1986). Ainsi, c’est l’observation des déficits des individus aux prises avec des lésions cérébrales qui a permis de mieux comprendre le fonctionnement cognitif typique.
Les modèles d’architecture fonctionnelle ont d’abord schématisé l’identification et l’orthographe de mots isolés, mécanismes qui sont respectivement à la base de la lecture et l’écriture. Les modèles à deux voies sont ceux qui sont prédominants aujourd’hui dans l’appréhension des processus cognitifs mis en jeu dans l’identification de mots (Marshall et Newcombe, 1973; Coltheart, 1978) et l’orthographe (Roeltgen et Heilman, 1984; Ellis et Young, 1998). Ces modèles suggèrent que le traitement en lecture et en écriture repose sur deux types de procédures: l’une dite d’assemblage, qui exploite les informations phonologiques associées aux graphèmes pour lire ou écrire les mots inconnus ou les pseudomots, et l’autre dite d’adressage, qui utilise directement les informations orthographiques emmagasinées en mémoire à long terme pour lire ou écrire les mots connus.
Étant donné que les modèles d’architecture fonctionnelle à deux voies visent à expliquer le traitement cognitif chez le lecteur/scripteur expert, ils s’appliquent difficilement à l’enfant chez qui les connaissances et les habiletés de lecture et d’écriture sont en développement. Devant ce constat, Share (1995) a proposé l’hypothèse d’autodidaxie (Self-Teaching Hypothesis) du développement des procédures d’assemblage et d’adressage. Cette hypothèse tente de rendre compte à la fois des stades des modèles développementaux et des interrelations potentielles entre les deux procédures. Selon cette hypothèse, les habiletés phonologiques utilisées lors de la procédure d’assemblage servent de mécanisme permettant à l’enfant d’acquérir de façon autodidacte des représentations orthographiques détaillées qui sont nécessaires au développement de la procédure d’adressage. Lorsque l’enfant rencontre un mot nouveau, il doit analyser toute la séquence des lettres de ce mot. L’attention portée par le lecteur sur chacun des graphèmes lui permet graduellement de préciser la séquence des lettres qui sera emmagasinée en mémoire. C’est par l’emmagasinage en mémoire de ces représentations que se développe son lexique orthographique, sur lequel repose par ailleurs la procédure d’adressage nécessaire à l’identification rapide des mots en lecture.
Depuis les années 1970, nombre de versions et d’améliorations des modèles à deux voies ont été, et continuent toujours, d’être proposées (Norris et Brown, 1985; Patterson et Morton, 1985; Coltheart et al., 1993; Coltheart et al., 2001). Ces nouvelles versions suggèrent des nuances concernant entre autres les caractéristiques des modules présents dans le modèle ou encore l’activation parallèle des deux voies lors de l’identification de mots. Par ailleurs, d’autres modèles ont également été développés pour rendre compte du traitement des mots morphologiquement complexes, c’est-à-dire de mots composés de plus d’un morphème. Selon certains de ces modèles (Jarvella et Meijers, 1983; MacKay, 1978), les mots complexes doivent êtres segmentés en morphèmes lors de la lecture. Selon d’autres (Bradley, 1980; Butterworth, 1983; Henderson, Wallis et Knight, 1994; Kempley et Morton, 1982; Manelis et Tharp, 1977; Rubin, Becker et Freeman, 1979), les mots morphologiquement complexes ont plutôt une représentation complète dans le lexique orthographique. D’autres modèles (Caramazza, Laudanna et Romani, 1988; Marslen-Wilson et al., 1994; Niemi, Laine et Tuominen, 1994; Taft, 1994) combinent ces deux points de vue en proposant l’utilisation de deux voies parallèles, dont l’utilisation dépend des caractéristiques des mots telles que leur fréquence ou la fréquence des morphèmes qui les constituent. Récemment, des modèles intégrant l’identification de mots morphologiquement simples et complexes ont aussi été proposés (Reichle et Perfetti, 2003).
Outre leur apport dans l’explication du fonctionnement et de l’apprentissage typiques de l’identification de mots, les modèles à deux voies et la théorie de l’autodidaxie ont aussi contribué à une meilleure compréhension du fonctionnement déficitaire des procédures en lecture chez certains élèves. Qu’elles relèvent d’un développement insuffisant de l’une, de l’autre ou des deux procédures à la fois, les difficultés que rencontrent les enfants au contact du code écrit sont souvent observées en présence d’une diversité de symptômes qui sont associés à la présence d’un déficit dans le traitement de l’information phonologique, à des troubles sensoriels dans les domaines visuel ou auditif, ou à un déficit sur le plan moteur.
L’origine des difficultés rencontrées par l...
Table des matières
- Couverture
- Faux-Titre
- PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
- Titre
- Copyright
- Remerciements
- Table des matières
- Introduction
- Chapitre 1 Courants théoriques et langage écrit Pascal Lefebvre et Marie-Catherine St-Pierre
- Chapitre 2 Composantes de la lecture et de l’écriture Véronique Dalpé, Céline Giroux, Pascal Lefebvre et Marie-Catherine St-Pierre
- Chapitre 3 Habiletés mises en jeu dans la lecture et l’écriture et facteurs d’influence Véronique Dalpé, Marie-Catherine St-Pierre et Pascal Lefebvre
- Chapitre 4 Difficultés en langage écrit Conceptualisations et terminologies contemporaines Marie-Catherine St-Pierre, Céline Giroux et Pascal Lefebvre
- Chapitre 5 Prévention des difficultés du langage écrit Pascal Lefebvre et Céline Giroux
- Chapitre 6 Démarche d’évaluation des difficultés du langage écrit Marie-Catherine St-Pierre, Véronique Dalpé et Céline Giroux
- Conclusion
- Bibliographie
- Notices biographiques
- Couverture arrière