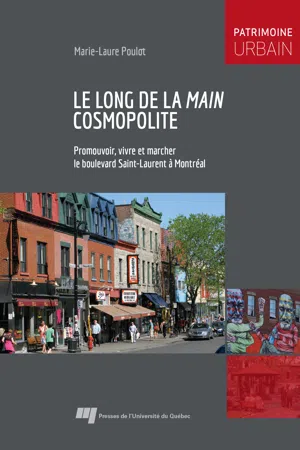
eBook - ePub
Le long de la Main cosmopolite
Promouvoir, vivre et marcher le boulevard Saint-Laurent à Montréal
- 436 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
Le long de la Main cosmopolite
Promouvoir, vivre et marcher le boulevard Saint-Laurent à Montréal
À propos de ce livre
À Montréal, le boulevard Saint-Laurent résume à lui seul les différentes dimensions du cosmopolitisme. L'artère représente autant une coupure dans la ville – la frontière entre les «?deux solitudes?», francophone et anglophone – qu'une couture, puisqu'elle a été un lieu d'accueil privilégié pour les nouveaux venus tout au long du XXe siècle. Dans cet ancien corridor de l'immigration, devenu espace d'échanges et de récits, se rencontrent et parfois se confrontent les diverses expressions du cosmopolitisme (commerciale et quotidienne, politique et culturelle).
Marquée par l'empreinte de différents pouvoirs et soumise à de multiples jeux d'influences, la rue patrimonialisée est l'objet de politiques contrastées, en quête d'images et de stratégies. Fortement valorisés dans le marketing urbain, le boulevard Saint-Laurent et ses quartiers demeurent toutefois des lieux d'incarnation privilégiés de l'identité montréalaise qui offrent un cadre à certaines de ses figures et de ses ambiances les plus remarquables. S'y déclinent de multiples expériences citadines, où se construisent les formes d'un cosmopolitisme de quartiers, enjeu politique autant qu'image de marque. L'enquête rapportée dans cet ouvrage témoigne d'une pratique approfondie des quartiers traversés par le boulevard, s'appuie sur les représentations littéraires, artistiques et citoyennes qu'ils inspirent et s'attarde à comprendre les relations entre ses différents acteurs – commerces, associations et administration municipale.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Le long de la Main cosmopolite par Marie-Laure Poulot en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Architecture et Architecture générale. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
Sujet
ArchitecturePARTIE 1
LE BOULEVARD SAINT-LAURENT, L’INCARNATION D’UN COSMOPOLITISME IDENTITAIRE
Toutes les grandes villes se targuent d’avoir de grandes avenues. À Montréal, il y a Sherbrooke, ou la commerciale Sainte-Catherine, mais unique est cette rue qui change de visage tout au long de son développement (à nous, de Montréal, qui nous forgeons souvent une identité en regardant celle des autres, on pourrait se dire que Saint-Laurent est notre petit Broadway à « nous autres » ou un spectaculaire boulevard Saint-Martin emprunté, et remodelé sur une plus grande échelle, directement à Paris).
NORMAND THÉRIAULT, 2005,
« Depuis 100 ans, la “Main” »,
Le Devoir, p. H 1.
« Depuis 100 ans, la “Main” »,
Le Devoir, p. H 1.
Extraites d’un article paru dans Le Devoir à l’occasion d’un cahier spécial consacré à la Main, ces quelques lignes soulignent l’importance du boulevard Saint-Laurent dans la ville de Montréal. Cette artère sud-nord, longue de quelque six kilomètres du Vieux-Port à la rue Jean-Talon, traverse trois arrondissements (Ville-Marie, Plateau-Mont-Royal et Rosemont–Petite-Patrie) et plusieurs quartiers. Parfois frontière et marge, parfois centre, la Main concentre et multiplie caractérisations et adjectifs renvoyant à son statut particulier dans l’histoire de la ville, notamment du point de vue de sa diversité ethnoculturelle. Le boulevard Saint-Laurent possédait en effet une fonction d’accueil pour les nouveaux venus des différentes vagues d’immigration des XIXe et XXe siècles. « Plus que d’autres espaces de la ville, pour l’étranger, dans le prolongement de la réflexion simmelienne, la rue “ethnique” offre la double possibilité d’une expérience de la similitude communautaire et de la dissemblance sociétale81. » La concentration des différences, ajoutée à son rôle de frontière est-ouest, fait du boulevard le support de la forme de la ville, un emblème de la montréalité. Ce vocable de la montréalité (montrealness), d’abord utilisé par l’architecte Melvin Charney82, a été repris pour énoncer le caractère identitaire de Montréal83 et pour souligner l’écart entre la métropole, de plus en plus cosmopolite, et le reste de la province québécoise84. Selon Jocelyn Létourneau, il y a « consolidation de la “distinction montréalaise” (ce que certains appellent ouvertement la montréalité), notamment fondée sur le caractère cosmopolite de la ville et sa prétention à se représenter et se repositionner comme cité globale branchée sur le monde85 ». Létourneau fait explicitement le lien entre cosmopolitisme et montréalité, qu’il définit comme une « sorte d’identité métropolitaine aux enracinements pluriethniques et aux résonances cosmopolites86 ».
Les représentations de cet espace sont si nombreuses qu’elles construisent un imaginaire patrimonial du cosmopolitisme du boulevard à travers les récits journalistiques, littéraires ou politiques. Ces récits proviennent de plusieurs échelles de l’action publique (État fédéral, État provincial, Municipalité centrale et municipalités d’arrondissements) et renvoient à différents imaginaires de la diversité : multiculturalisme, interculturalisme, diversité ethnique. Ces derniers se superposent au boulevard, sans nécessairement se recouper, tant au niveau spatial qu’au niveau du projet politique. Le boulevard Saint-Laurent figure ainsi un espace privilégié pour comprendre le cosmopolitisme, mais quelles sont les valeurs véhiculées par les choix des politiques de la diversité et comment peut-on les analyser sur l’espace du boulevard Saint-Laurent ? En d’autres termes, quelles sont les cristallisations matérielles et immatérielles des constructions narratives autour du cosmopolitisme sur le boulevard ? Il s’agira de montrer dans cette partie comment le cosmopolitisme sur le boulevard est au fondement de l’identité montréalaise : au cœur des récits sur la ville de Montréal et sur l’immigration, il se décline en projet politique, identitaire et patrimonial.
Le chapitre 1 est centré sur la rue comme lieu métonymique de l’histoire de la diversité culturelle montréalaise. Objet géographique à analyser en soi, le boulevard constitue un prisme pour comprendre le cosmopolitisme comme projet politique. Le chapitre 2 interroge quant à lui la patrimonialisation du cosmopolitisme du boulevard, à différentes échelles. Quand les reconnaissances fédérales, provinciales et municipales du patrimoine se superposent les unes aux autres, la société civile, par le biais d’associations, y construit un « nous » montréalais autour du cosmopolitisme comme identité urbaine.
Chapitre 1
Une Main Street reflet du cosmopolitisme urbain et politique
Streets and their sidewalks, the main public space of a city,
are its most vital organs. Think of a city and what
comes to mind ? Its streets.
are its most vital organs. Think of a city and what
comes to mind ? Its streets.
JANE JACOBS, 1961,
The Death and Life of Great American Cities, p. 29.
The Death and Life of Great American Cities, p. 29.
L’objectif de ce premier chapitre est d’interroger le boulevard Saint-Laurent comme espace de lecture du concept du « cosmopolitisme », en tant que projet politique et identitaire montréalais. Il s’agit aussi de passer d’une lecture théorique du cosmopolitisme à sa traduction empirique et spatiale, à partir de la rue. Lien entre sphère publique politique et espace public matériel, le boulevard Saint-Laurent, comme rue commerçante centrale, constitue un espace pertinent pour appréhender les traductions spatiales des politiques de la diversité. L’accueil et l’insertion des immigrants ont fortement évolué à toutes les échelles de la fédération (Canada, Québec, Montréal) depuis les années 1970. Le boulevard n’est pas forcément une priorité de cette politique. Cependant, c’est le lieu d’installation des immigrants aux XIXe et XXe siècles et, en tant que tel, il permet de comprendre l’importance du fait migratoire dans la construction de la métropole montréalaise, de même que l’antagonisme traditionnel entre francophones et anglophones. Le boulevard Saint-Laurent est un espace privilégié de construction d’un paysage cosmopolite. Dans le contexte québécois d’interculturalisme, les deux éléments forts à retenir sont le statut central de la langue française et la reconnaissance du besoin d’une politique d’aménagement de la diversité, deux points qui ont des incidences sur l’espace urbain (langue d’affichage, marquage, toponymie, aménagement urbain). On peut alors se demander s’il existe des spécificités montréalaises dans cette mise en valeur de la diversité.
Ce chapitre est l’occasion de souligner les traductions spatiales du cosmopolitisme à travers trois dimensions identitaires de la rue : une dimension historique (le boulevard comme ancienne frontière), une dimension politique (le boulevard reflet de ces politiques de gestion de la diversité) et une dimension urbaine (le boulevard comme rue principale dans l’organisation de la ville).
Le boulevard Saint-Laurent : métonymie de la ville et de l’histoire de l’immigration
Vivre la Main, c’est vivre une ville en raccourci.
NORMAND THÉRIAULT, 2005,
« Depuis 100 ans, la “Main” »,
Le Devoir, p. H 1.
« Depuis 100 ans, la “Main” »,
Le Devoir, p. H 1.
D’abord frontière entre anglophones et francophones, le boulevard devient couture : il est l’espace de rencontre et le lien entre ces différents quartiers ethniques. Les marques laissées par les immigrants permettent de délimiter la rue et son épaisseur. Par cette concentration et l’urbanité qui en résulte du fait de la coprésence de groupes différents, le boulevard, espace public urbain par excellence, constitue un espace pour lire le cosmopolitisme urbain.
Un espace frontière entre francophones et anglophones
D’abord évidemment, ça se trouve être comme une frontière entre l’est et l’ouest et entre les francophones et les anglophones de la ville, au départ […] Parce qu’il y a quand même eu des anglophones sur le boulevard Saint-Laurent et aux alentours, mais c’était vraiment comme une limite si on veut (une résidente du boulevard Saint-Laurent, entretien du 2 octobre 2012).
Une « frontière », une « limite » : c’est ainsi que la plupart des personnes décrivent le boulevard. Une employée de l’association multiethnique pour l’intégration des personnes handicapées, installée sur le boulevard, se souvient des premières années où elle est arrivée d’Italie à Montréal. À l’époque de ses études à l’Université Concordia dans les années 1970, un soir de sortie dans un restaurant sur l’avenue du Parc, une de ses collègues était complètement perdue : elle n’était jamais venue « de l’autre côté » du boulevard, du côté anglophone. Pour elle, le boulevard Saint-Laurent constituait « un mur de séparation », comme si c’étaient « deux mondes coupés » (entretien du 18 octobre 2011). La littérature québécoise véhicule cette même image : le boulevard est « rue de démarcation » chez Mordecai Richler87, « manière de méridien de Greenwich montréalais » chez l’écrivaine québécoise Dominique Fortier88, ou encore « frontière » chez Alain Médam89.
Depuis sa naissance au milieu du XVIIIe siècle, la ville de Montréal présente une dualité linguistique, entre francophones et anglophones. D’abord à dominante française et autochtone, Montréal devient successivement majoritairement francophone puis anglophone après les victoires britanniques de 1759 et 1760 et l’arrivée massive d’Écossais et d’Irlandais. Le groupe francophone l’emporte à nouveau dans la seconde moitié du XIXe siècle. Ces deux groupes linguistiques organisent alors la ville en formant une mosaïque de quartiers selon la langue, la religion et l’origine. À l’est du boulevard, s’étendent les quartiers francophones, avec les Canadiens français ; et à l’ouest, les anglophones, avec les quartiers anglais, irlandais ou écossais. Cette séparation est cependant à nuancer. L’historien Paul-André Linteau90 souligne la présence de Canadiens français à l’ouest, et inversement. Le géographe Raoul Blanchard91 ajoute quant à lui une « troisième ville » aux francophone et anglophone : la ville « israélite ». Malgré cette porosité, la répartition spatiale est-ouest de l’époque « a eu une influence profonde sur la vie sociale, économique et politique à Montréal92 ». Surtout, cette séparation a pu atténuer les risques de conflits entre les différents groupes grâce à « une véritable stratégie de cloisonnement ethnique93 ». Ce partage de l’île jusque dans les années 1960 découle de l’application « du principe de coexistence pacifique » selon lequel « les bonnes barrières sociales permettent le bon voisinage94 » avec l’existence d’organisations, d’associations et d’institutions de chaque groupe. La géographe Claire McNicoll95 avançait en 1993 la notion de « confort culturel » pour expliquer cette ségrégation résidentielle montréalaise : selon elle, cette caractéristique se poursuivrait aujourd’hui, ce que Martha Radice96 confirme par son étude des Montréalais anglophones. L’inconnu conditionne en effet un désir d’« agrégation » avec ses semblables dans un environnement culturel spécifique.
Une scission sociale s’ajoute à cette scission linguistique et résidentielle. Puisque les quartiers francophones sont largement ouvriers tandis que les quartiers anglophones sont historiquement plus aisés, c’est une « ségrégation double » qui s’opère sur le sol montréalais97. Bien que majoritaire numériquement dès le milieu du XIXe siècle, le groupe francophone est réduit au statut de minorité par rapport à la population anglophone jusque dans les années 1960, quand débute la Révolution tranquille98. Cette expression correspond à une remise en cause des figures identitaires traditionnelles, notamment en ce qui concerne la religion catholique et les autorités ecclésiastiques. Ces changements vont de pair avec le « rééchelonnement de la province par rapport aux autres régions nord-américaines » : pour répondre au déclassement, « il s’agit d’util...
Table des matières
- Couverture
- Titre
- Crédits
- Liste des encadrés
- Liste des figures
- Liste des tableaux
- Liste des principaux sigles et acronymes
- Introduction
- Partie 1 – Le boulevard Saint-Laurent, l’incarnation d’un cosmopolitisme identitaire
- Partie 2 – Le branding du boulevard Saint-Laurent
- Partie 3 – Vivre et raconter le boulevard Saint-Laurent
- Conclusion
- Bibliographie
- Notes