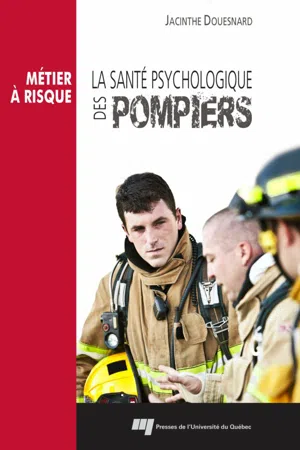
- 150 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
La santé psychologique des pompiers
À propos de ce livre
Qu'est-ce qui permet aux pompiers de maintenir une bonne santé physique et psychologique dans un environnement de travail risqué? L'auteure présente une analyse du métier de pompier et décrit les stratégies employées pour affronter le danger.
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à La santé psychologique des pompiers par Jacinthe Douesnard en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans Psychologie et Psychologie industrielle et organisationnelle. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
CHAPITRE 1
RISQUES ET SANTÉ PSYCHOLOGIQUE
DANS LE MÉTIER DE POMPIER
Portrait de la situation
1.1. UN TRAVAIL À HAUT RISQUE D’ATTEINTE À LA SANTÉ PSYCHOLOGIQUE
1.1.1. ORIGINE ET DESCRIPTION DU MÉTIER DE POMPIER PERMANENT
Le travail de pompier est considéré par Woodall (1998) comme l’un des métiers les plus exigeants, tant sur le plan physique que psychologique. Avant d’aborder la description du métier de pompier et les différents risques qui y sont liés, les prochaines lignes présentent quelques éléments relatifs à l’historique de ce métier et à son évolution dans le temps.
Appelés soldats du feu et sapeurs-pompiers en Europe francophone, firefighters aux États-Unis, firemen au Canada anglais et pompiers au Canada français, ces travailleurs sont principalement responsables de la lutte contre les incendies. Les premières traces d’activités organisées autour de la lutte incendie remontent à l’époque de l’Égypte ancienne. Cependant, c’est à Rome, sous le règne d’Auguste (vers l’an 6) que l’on a vu apparaître les premiers regroupements structurés, appelés « vigiles », dont la tâche spécifique était de lutter contre les incendies (Carcopino, 1939). D’ailleurs, il est possible d’en retrouver les traces dans les écrits de Suétone, historien romain ayant vécu entre le Ier et le IIe siècle de notre ère, principalement connu pour sa Vie des douze Césars où il précise que « contre les incendies [Auguste] imagina des postes de nuit et de vigiles » (Suétone, 119, trad. de Grimal, 1973, p. 99). Rattachées à l’armée romaine, les personnes qui travaillaient pour la vigile patrouillaient à pied dans les quartiers de Rome pour déceler les premiers signes d’incendie et intervenir.
Déjà, à cette époque, il y avait des spécialisations de tâches chez les pompiers, telles que les présentent Hacquard et al., (1952, p. 146-147) dans Le Guide romain antique :
Chaque centurie [de vigiles] comprend plusieurs sections spécialisées :
- aquarii (alimentation en eau) ;
- siphonarii (manœuvre des pompes) ;
- centonarii (extinction des petits incendies au moyen de couvertures imbibées de vinaigre) ;
- emitularii (manœuvre de matelas destinés à amortir la chute des sinistrés) ;
- carcerarii, horrearii, balnearii (protection des prisons, des magasins, des thermes).
Chaque centurie compte en outre des médecins.
De manière similaire, en Gaule Narbonnaise (territoire de l’actuelle France, conquise par l’Empire romain vers 188 av. J.-C.), les ancêtres des premiers sapeurs-pompiers français étaient membres de corporations officiellement reconnues :
Le seul service [en Gaule] sur lequel nous soyons un peu renseignés est celui des pompiers, assuré par des corporations privées dont l’État réclamait les services : chiffonniers et ouvriers du bâtiment, les uns parce que les vieilles étoffes et couvertures servaient à étouffer la flamme, les autres parce qu’ils avaient le matériel nécessaire à limiter les dégâts et à opérer les sauvetages – la hache et l’échelle (Duval, 1952, p. 64).
Duval (1952) fournit également des précisions sur la façon dont ils étaient recrutés pour combattre les incendies :
Les corporations sont fréquentes surtout en [Gaule] Narbonnaise où l’influence des coutumes sociales romaines est la plus forte : « porteurs d’arbres » et « ouvriers charpentiers », dendrophori et fabri tignarii (ou plus simplement fabri, les « ouvriers » par excellence).Les dendrophori assuraient le transport des arbres destinés à l’industrie et au commerce, au travail du charpentier et à la consommation du charbon de bois, et leur nom grec s’explique par le fait qu’on avait recours à leur corporation pour porter solennellement le pin sacré dans les processions du culte de Cybèle, la Mère des dieux.Les fabri désignaient les ouvriers du bâtiment, charpentiers et maçons tous ensemble, ainsi que les constructeurs de navires. Et l’importance des constructions en bois donnant matière à des incendies fréquents, c’est aux membres de ces deux corporations, habiles à manier la hache et à placer l’échelle, que les cités confiaient le soin de limiter les incendies et d’opérer les sauvetages (Duval, 1952, p. 129).
Cependant, à cette époque, les interventions avaient principalement pour but de limiter, autant que possible, la propagation du feu, et les moyens utilisés étaient très rudimentaires. En effet, ce n’est que vers les années 1670 que les premiers boyaux d’arrosage firent leur apparition, suivis par la pompe à incendie autour des années 1725. Aux États-Unis, les premiers regroupements de surveillants d’incendie ont vu le jour au milieu du XVIIe siècle ; vers les années 1850, les premières compagnies de pompiers salariés furent mises sur pied. Au Québec, il faut remonter aux années 1800 pour trouver les premiers regroupements officiels portant le titre de pompiers ; par exemple, on avance la date de 1832 pour la ville de Québec (Grenier, 2003) et 1863 pour la ville de Montréal (ville de Montréal, 2008). Néanmoins, avant l’arrivée des casernes dans ces villes, la lutte aux incendies se faisait par des citoyens dits de bonne volonté qui intervenaient sur les lieux d’incendies (Grenier, 2003).
De nos jours, l’extinction des incendies représente toujours l’activité la plus connue du métier de pompier. Cependant, le travail des pompiers ne se résume pas à éteindre des feux. Ils ont au contraire une grande diversité de tâches à effectuer ; par exemple, ils sont responsables de certains volets de prévention en matière de sécurité incendie auprès du public. De plus, ils sont présents sur les lieux d’accidents de voiture, surtout pour déloger les victimes prises sous les décombres, en utilisant notamment les pinces de désincarcération. Ils peuvent avoir à intervenir pour faire du sauvetage sur des plans d’eau, des sauvetages en hauteur ou en espace clos et dans des situations où des produits chimiques représentent un danger. Ces travailleurs sont également à pied d’œuvre lors de dégâts d’eau, d’inondations. Ils participent en outre aux différentes mesures d’urgence d’une ville (évacuation de sinistrés, alerte à la bombe, etc.). Ils peuvent travailler dans divers milieux, comme les municipalités, les bases militaires, les aéroports, etc. D’une manière générale, ils assurent la protection des personnes, des biens, des moyens de production économique et de l’environnement. Le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (2006) présente les principales fonctions des pompiers de cette façon :
intervenir en cas d’incendies, d’accidents (routiers, industriels, aériens, etc.), d’effondrements de bâtiment, de catastrophes naturelles ; porter secours à des victimes ; combattre des incendies au moyen de divers équipements et méthodes (haches, eau, extincteurs chimiques, échelles, véhicules, bateaux, etc.) ; employer des méthodes de premiers soins appropriées ; éduquer le public en matière de sécurité.
Selon le ministère de la Sécurité publique du Québec (MSPQ, 2007), on dénombre 753 services municipaux de sécurité incendie dans la province de Québec. Cela représente près de 21 800 pompiers, premiers répondants et officiers. La majorité d’entre eux (17 300) sont des pompiers volontaires1 (volunteer firefighters), qui travaillent habituellement dans des municipalités de moins de 200 000 habitants. Les 4 300 autres pompiers travaillent dans des villes plus grandes et ce sont des pompiers permanents (career firefighters). Ils travaillent en lien étroit avec leurs collègues, partageant de longs quarts de travail (entre 10 heures et 24 heures de suite, avec des horaires de jour et de nuit). Un pompier permanent va entrer le matin à la caserne, manger et s’entraîner à la caserne, puis repartir chez lui le soir quand son quart de travail est terminé ou encore rester pour dormir à la caserne s’il travaille de nuit. Il est présent à la caserne, avec son équipe, pour attendre les alarmes et la fonction de pompier est son principal emploi. Le quotidien du travail est alors vécu de façon soutenue, ce qui n’est pas le cas des pompiers volontaires qui répondent aux appels d’urgence, sans vivre au quotidien dans une caserne. En effet, ces derniers occupent habituellement un autre emploi, qu’ils quittent lorsqu’ils sont appelés à répondre à une alarme incendie. Par conséquent, ils n’occupent pas la fonction de pompier comme principal emploi.
1.1.2. RISQUES INHÉRENTS AU MÉTIER DE POMPIER
La littérature scientifique fait état des risques liés au métier de pompier. En effet, dans les milieux incendies, il est possible de se trouver dans des situations éprouvantes et exigeantes tant sur le plan physique que mental. Ces exigences, inhérentes au métier de pompier, représentent des facteurs de risque d’atteinte à leur santé psychologique. Dans bien des interventions, les pompiers sont exposés à des situations dangereuses, menaçant leur propre vie, celle de leurs collègues ou celle des citoyens. Ils peuvent également être témoins de pertes matérielles importantes, de souffrances humaines, de blessures graves, de brûlures et même de la mort. En tant qu’intervenants d’urgence, ils sauvent des victimes, retirent des personnes mortes des décombres, assistent à des scènes éprouvantes émotionnellement (Maltais et al., 2001). La plupart du temps, ils doivent intervenir rapidement et accomplir des gestes lourds de conséquences : quand une catastrophe survient, les demandes les plus pressantes reposent sur les épaules des répondants de première ligne (composés, outre des pompiers, des policiers et des services médicaux d’urgence, dont les ambulanciers) (Duckworth, 1991).
Le travail de pompier est exigeant, complexe, chargé de responsabilités et le rythme de travail est particulier. En effet, certains auteurs évoquent par exemple les temps de travail inégaux des intervenants en situation d’urgence, c’est-à-dire l’absence (ou les trop brèves périodes) de repos entre les interventions, conjuguée au travail échelonné sur de longues heures (Gibbs et al., 1996 ; Mitchell et Dyregrov, 1993). Les pompiers risquent de devoir demeurer sur les lieux de l’intervention pendant une longue période, qui dépasse parfois le temps normal de travail. Ils peuvent également être appelés à quitter la caserne dès qu’ils rentrent d’un appel, n’ayant parfois pas le temps de retrouver l’énergie nécessaire pour être efficaces à l’intervention suivante. À l’opposé, les pompiers peuvent être pendant de longues heures en sous-charge lors d’un quart de travail. Par conséquent, ils sont susceptibles de s’ennuyer au cours de ces périodes, en attente d’un appel. Il est alors possible de constater que les exigences physiques et psychologiques ne sont pas constantes dans le métier de pompier : elles sont à la fois variables et imprévisibles.
Cette charge de travail fluctuante a été identifiée comme un facteur psychosocial exigeant pour les travailleurs, notamment dans une étude menée auprès des téléopérateurs (Hoekstra et al., 1995 ; Hurrell et al., 1996). De plus, l’attente entre les interventions se fait dans un climat de proximité avec les collègues. Cet aspect rend possibles le renfo...
Table des matières
- Couverture
- Copyright
- REMERCIEMENTS
- LISTE DES TABLEAUX
- INTRODUCTION
- CHAPITRE 1 - RISQUES ET SANTÉ PSYCHOLOGIQUE DANS LE MÉTIER DE POMPIER Portrait de la situation
- CHAPITRE 2 - PROCÉDURES UTILISÉES POUR ANALYSER LE RAPPORT AU TRAVAIL ET AUX RISQUES DANS LE MÉTIER DE POMPIER
- CHAPITRE 3 - LE TRAVAIL DES POMPIERS VU DE L’INTÉRIEUR
- CHAPITRE 4 - STRATÉGIES COLLECTIVES DE DÉFENSE POUR AFFRONTER LES RISQUES DU MÉTIER
- CHAPITRE 5 - ENTRE LE RISQUE DE PERDRE LA VIE ET LA CONQUÊTE DE L’IDENTITÉ
- BIBLIOGRAPHIE
- Quatrième de couverture