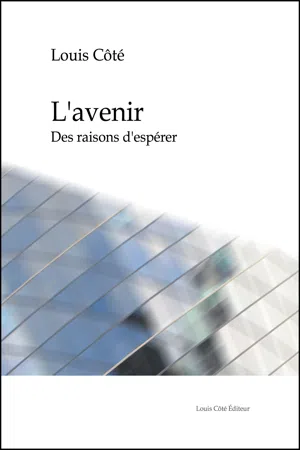![]()
Troisième partie
LES MENACES ET LES OPPORTUNITÉS DU TEMPS PRÉSENT
![]()
Chapitre 5
Un diagnostic historique
Comme nous l’avons annoncé en introduction, nous allons tenter dans cette troisième et dernière partie de cerner les principales évolutions sociétales en cours, dans le but de délimiter les menaces et de déceler les opportunités qui se présentent à nous, et de dégager ainsi un horizon d’action. Tenter, car cela n’est ni simple, ni évident, puisque non seulement les bouleversements majeurs que l’on connaît touchent de multiples sphères (technologique, économique, sociale, politique, culturelle), mais ils sont difficiles à déchiffrer. Depuis plus de 30 ans, différents modèles interprétatifs ont été proposés par des théoriciens, mettant l’accent tantôt sur l’idée de mutation ou de rupture, et avançant l’hypothèse d’une postmodernité, tantôt sur l’idée de continuité, et défendant la thèse d’une modernité avancée. Par ailleurs, plus récemment, invoquant l’accélération sans précédent du développement technologique, de nombreux essayistes ont propagé l’idée d’une transition révolutionnaire en voie de s’opérer. Selon le journaliste Jean-Claude Guillebaud, par exemple, nous serions en train de vivre une rupture historique et anthropologique d’une profondeur vertigineuse, « une grande bifurcation [comparable] à celle d’il y a douze mille ans, qui nous fit passer du paléolithique au néolithique ». L’historien Aldo Schiavone soutient pour sa part que « [n]ous entrons tout juste dans une nouvelle révolution technologique – la troisième de notre histoire, après les révolutions agricole et industrielle […] une transition révolutionnaire durant laquelle le rythme du changement est si rapide et son impact si profond que toute l’humanité en sortira radicalement transformée ».
Que penser de tels diagnostics ? Bien sûr, il nous faut savoir prendre du recul et ne pas laisser notre regard s’enfermer dans l’événementiel. Les phénomènes sociaux, nous l’avons souligné, ne se laissent appréhender qu’en tant que processus en devenir. Mais assistons-nous véritablement à une mutation à caractère global qui nous ferait transiter d’un ordre humain à un autre ? Ne sommes-nous pas plutôt entrés dans une nouvelle phase historique de la modernité qui, par-delà les transformations touchant les processus constitutifs de cette dernière, est en continuité avec les phases précédentes et dans laquelle prévalent toujours les logiques qui sous-tendent cette modernité ? Voilà les questions qui nous occuperont dans le présent chapitre. Disposant d’une vue d’ensemble, nous pourrons par la suite analyser plus à fond les enjeux économiques auxquels nous sommes confrontés et qui renferment sans doute les menaces les plus considérables du temps présent, pour examiner finalement les opportunités politiques et sociales éventuelles d’une réforme du capitalisme néolibéral.
1. Postmodernité ou modernité avancée ?
Comme l’explique Yves Bonny, dont l’apport nous sera précieux ici encore, le thème d’une mutation postmoderne a été traité dans deux orientations principales, « selon que l’on entend en limiter la portée à la sphère culturelle ou que l’on considère au contraire que nous faisons face aujourd’hui à une transformation beaucoup plus globale, concernant toutes les dimensions de la vie sociale et la société dans son ensemble ». Même en s’en tenant à la seconde perspective, ce qui sera notre fait, les modèles interprétatifs sont divers et peuvent être distingués, notamment, selon qu’ils nous proposent des lectures positives ou négatives de la postmodernité.
Souvent liées au postmodernisme, les lectures positives les plus notables ont été proposées dans les années 1980. Très critiques à l’égard de la modernité qu’elles associent à une volonté de mise en ordre rationnelle de la vie sociale et d’encadrement disciplinaire des individus, elles envisagent la postmodernité comme une rupture qui met fin aux projets d’assujettissement et qui ouvre la voie à l’émancipation du sujet individuel, à l’affirmation des identités particulières et à la pluralisation de la culture. De telles lectures s’accordent sans doute avec le passage à la société post-disciplinaire qui s’est effectué en Occident à partir des années 1960, passage marqué par l’accélération du processus d’individualisation, l’affirmation de l’accomplissement personnel comme valeur dominante, le refus des identités assignées, la tolérance au pluralisme et les transformations des modèles de socialisation et de rapport à l’autorité.
Mais il n’est pas du tout avéré qu’il convienne d’interpréter ce passage comme une sortie de la modernité, plutôt que comme une nouvelle phase de celle-ci. Les transformations relevées n’impliquent pas que les fondements structurels des sociétés modernes aient été révolutionnés et que la dynamique des processus constitutifs de la modernité ait été renversée. Bonny remarque d’ailleurs que certains des auteurs les plus importants ayant développé une lecture de la société post-disciplinaire comme postmodernité, Bauman et Lipovetsky par exemple, se sont ultérieurement éloignés d’une telle interprétation pour raisonner plutôt en termes de modernité avancée. Il en conclut que « la rhétorique du “postmoderne” correspond chez eux au vocabulaire et à la sensibilité d’une certaine époque beaucoup plus qu’à une conviction fermement enracinée de faire face à une mutation radicale ».
De leur côté, les auteurs qui portent un regard négatif sur la postmodernité la considèrent généralement comme une tendance en cours, plutôt que comme une rupture consommée. Bien sûr, les nombreux analystes qui dénoncent les dérives de la société contemporaine, qu’ils perçoivent comme étant porteuses d’une mutation tendancielle, ne se référent pas tous à la notion de postmodernité. Bonny cite, entre autres, Georges Balandier, qui qualifie de « surmodernité mondialisante » la construction continue d’un monde dans lequel les logiques marchande et financière s’articulent avec le pouvoir-faire croissant de la technoscience. Il mentionne également Habermas dont il rappelle la thèse d’un détournement du projet de la modernité lié à l’expansion des logiques économique et bureaucratique qui concourent à coloniser le monde vécu. Parmi les théories qui traitent formellement de la mutation postmoderne, Bonny s’arrête particulièrement sur celle de Michel Freitag qu’il évalue comme l’une des plus systématiques et des plus élaborées. Voyons cela.
Pour Freitag, nous dit Bonny, les manifestations les plus significatives et les plus lourdes de conséquences de la mutation postmoderne sont le technocratisme (qui correspond à toutes les formes de contrôle et de gestion immédiatement opérationnelle de l’action et des rapports sociaux), le technologisme (qui renvoie à la libération radicale des capacités développées dans le cadre de la technoscience), l’économisme (qui se rapporte à l’action des puissances économiques qui débordent les pouvoirs politiques) et l’hyperpuissance géostratégique (qui s’incarne dans les Etats-Unis). Ce portrait m’apparaît globalement en accord avec la critique postmoderniste habituelle. À mon sens, l’originalité de l’interprétation de Freitag réside principalement dans sa thèse de l’avènement progressif et très précoce de la postmodernité. Il conçoit en effet cette dernière comme « une nouvelle mutation globale du mode de constitution formel de la société et de la socialité, qui s’impose de manière positive, systématique et accélérée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais qui s’est manifestée déjà, d’abord surtout négativement, sous la forme de “crises”, depuis la deuxième moitié du XIXe siècle ». À ses yeux, la mutation sociétale postmoderne ne renvoie pas seulement aux dérives de la société contemporaine, mais trouve son origine dans la substitution progressive d’un mode de gestion organisationnel, décisionnel et opérationnel du social à la régulation politico-institutionnelle de forme universaliste qui prévalait antérieurement : passage d’un capitalisme d’entrepreneurs individuels à un capitalisme de grandes corporations à l’occasion de la deuxième révolution industrielle, établissement de droits sociaux sur la base d’intérêts et d’identités particuliers qui justifient un traitement spécifique, transformation de l’État de droit en une multitude d’organismes d’intervention, de gestion et de prise en charge directe du social et conquête de l’espace de la société civile par des groupes d’intérêts et d’affinités.
On peut être ou non d’accord avec les jugements portés par Freitag sur les principaux développements de nature économique, politique et sociale qui ont atteint les sociétés modernes à compter de la fin du XIXe siècle, la montée des mouvements sociaux et l’établissement de mécanismes de concertation entre l’État et les partenaires sociaux, par exemple, qu’il considère négativement. Mais lier ces développements à la postmodernité et les disjoindre ainsi de la modernité implique une conception réductrice qui limite cette dernière à la phase qualifiée par Peter Wagner de « modernité libérale restreinte », phase marquée par la prédominance du libéralisme économique et du libéralisme politique et qui ne concerne que le XIXe siècle.
Je crois qu’il est plus à propos de distinguer différentes phases de la modernité, dont la toute dernière peut être qualifiée de modernité avancée. Comme je l’ai indiqué au chapitre deux, on peut distinguer la modernité libérale – embrassant le long XIXe siècle, qui va de 1789 à 1914, elle est marquée par le développement du capitalisme industriel, la montée des États-nations occidentaux et la reconnaissance des droits individuels, mais sans prise en compte des conditions de leur réalisation –, la modernité organisée – rompant avec le libéralisme classique entré en crise à la suite de deux dépressions économiques majeures et deux guerres mondiales, elle repose sur l’affirmation d’un État social qui régule l’économie et favorise la généralisation de l’individualisation par une offre de protections sociales et de biens collectifs – et la modernité avancée qui a connu depuis la fin des années 1970 la mise en cause de l’État social dans un contexte de mondialisation accélérée et d’accentuation de l’individualisation.
Ainsi que le souligne Bonny, une telle interprétation implique que « les logiques de structuration des sociétés contemporaines sont fondamentalement les mêmes qu’à l’époque de la modernité “première” [… même si] en même temps ces sociétés connaissent des transformations majeures qui nous éloignent de plus en plus des formes d’organisation sociale et de représentation caractérisant le début des Temps modernes ». C’est ce que nous tenterons de démontrer dans une prochaine section. Mais, auparavant, nous allons nous pencher sur l’idée d’une transition révolutionnaire qui serait en voie de s’opérer sur la base des développements technologiques en cours.
2. Les conditions d’un passage d’un ordre humain à un autre
Qu’ils le déplorent et le craignent (ainsi d’un Balandier) ou qu’ils s’en réjouissent et le souhaitent (ainsi d’un Schiavone), de nombreux auteurs perçoivent la convergence des recherches actuelles mobilisant les technologies du vivant, de l’information et de l’intelligence artificielle comme porteuse de possibles inédits pour l’humanité. Cela soulève la question du rôle du développement des systèmes technico-économiques dans le passage d’un type de société à un autre ou, plutôt, d’un ordre humain à un autre. Comme nous l’avons vu dans les deux premiers chapitres, je distingue quatre ordres humains qui, ainsi que le résument les tableaux qui suivent, se différencient aux plans économique, sociopolitique et idéologique. Soulignons que les années inscrites indiquent les époques approximatives où s’affirment chaque ordre et que plutôt d’utiliser la notation « avant Jésus-Christ (av. J.-C.) /après Jésus-Christ (ap. J.-C.) », nous avons choisi d’utiliser la notation culturellement plus neutre « avant l’ère commune (AEC)/de l’ère commune (EC) ».
LE PREMIER ORDRE HUMAIN
| Caractéristiques | L’ordre primitif (50 000 aec) |
| Économiques | Chasse-cueillette Économie du don |
| Sociopolitiques | |