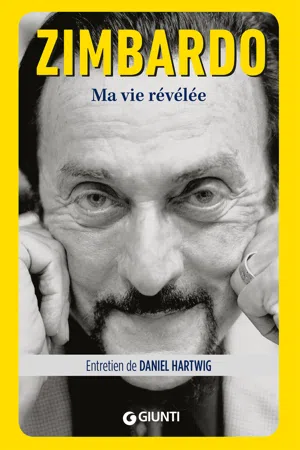![]()
1
Origines et événements marquants de ma vie*
• Ancêtres, enfance et vie familiale à New York
• Déménagement temporaire en Californie
• Camarade de lycée Stanley Milgram : sa carrière et ses expériences sur la soumission
• Expérience de Stanford (en résumé)
• Études de premier cycle
• Activisme social
Revenons à votre enfance, parlons un peu de vos origines familiales et de l’endroit où vous avez grandi.
Mes racines remontent jusqu’à deux petites villes de Sicile. La première, Cammarata, est près de Palerme. L’autre, Agira, est aux alentours de Catane. Du côté d’Agira, on trouve mes grands-parents maternels, et à Cammarata mes grands-parents paternels. Mon grand-père paternel Filippo Zimbardo et sa femme Vera Zimbardo sont les parents de George Zimbardo, mon père. La famille de ma mère, Margaret Zimbardo, vient de l’autre côté de l’île. Son nom de jeune fille était Bisicchia et son père était cordonnier. Mon autre grand-père, Philip, de qui j’ai hérité mon nom, était barbier. Ils étaient d’origine modeste, ils n’étaient pas allés à l’école. Ils sont partis pour l’Amérique lors de la grande migration sicilienne du début du XXe siècle. Je suis de la deuxième génération, mes parents sont nés ici.
J’ai grandi dans un quartier de New York appelé South Bronx. C’était un ghetto, comme un pays du tiers-monde. Mais ça, on ne le savait pas. Pour nous, c’était chouette. Je dis que j’ai grandi dans la pauvreté, car mon père se retrouvait souvent sans emploi. Il n’aimait pas particulièrement travailler. Il était barbier de profession, mais il n’aimait pas attendre les gens. Il préférait que les gens l’attendent, lui, parce qu’après sept sœurs, il était le premier garçon. On l’avait toujours traité comme un prince. Je me souviens que des années plus tard, alors qu’il était nettement plus âgé, ses sœurs le voyaient toujours comme un petit garçon adorable. Il avait des talents incroyables : une ouïe parfaite, une véritable oreille musicale. Il suffisait qu’il entende une chanson et dans la demi-heure il était capable de la jouer. Il jouait de tous les instruments à cordes — piano, mandoline, violon (où il était très bon) et guitare. Il chantait, il dansait. C’était un vrai boute-en-train.
Malheureusement, il s’est marié trop jeune. Avec ma mère, ils ont eu quatre enfants à un an et demi d’intervalle. Avoir plusieurs enfants en bas âge, c’est dur. Je suis né le 23 mars 1933, donc pendant la Grande Dépression. Quand il était sans emploi, on recevait l’assistance familiale, c’est-à-dire qu’on avait un chèque mensuel, de la nourriture gratuite à la banque alimentaire, et des vêtements gratuits en allant dans une boutique spécifique. Vous voyez, les choses étaient gratuites. Ce n’était pas la question de la survie, c’était juste humiliant. Après toutes ces années, je me souviens encore quand on allait chercher des habits dans un grand entrepôt.
À l’époque, les garçons portaient des shorts jusqu’à l’âge de sept, huit, neuf ans, puis ils passaient à des knickers, sortes de culottes bouffantes qui n’existent plus, jusqu’à dix, douze ans, après quoi ils avaient enfin leur premier pantalon long. Il y avait deux sortes de knickers, ceux à rayures fines et ceux à rayures larges. Le problème avec les knickers à rayures larges, c’est qu’ils faisaient du bruit quand on marchait, et ça faisait rigoler tout le monde. Au magasin, je fouillais dans la pile pour essayer d’éviter les moches — ils me semblaient tous identiques. Et pendant que je regardais, un homme est venu me dire : «Les mendiants n’ont pas à choisir. Prends au hasard et va-t’en.» Je me souviens avoir répondu, en larmes : «Je ne suis pas un mendiant. Et c’est votre travail. Vous êtes payé pour ça, vous n’avez pas à parler comme ça» ou quelque chose dans ce genre. C’est, encore une fois, l’un des aspects de la pauvreté dont les personnes en difficulté ne parlent pas. Juste l’humiliation d’être pauvre. Puis la guerre a éclaté, et mon père s’est intéressé à l’électronique. Sans formation, sans expérience, il a ouvert un petit magasin de radio avec un gars qui s’y connaissait et il a commencé à gagner de l’argent.
En 1947, mon père a construit un téléviseur à partir d’un simple schéma électrique. C’était après avoir été apprenti chez un vendeur de matériel électronique portoricain dont la boutique était au pied de notre appartement au 1005 East de la 151st Street. Je m’en souviens encore. Quand on pense que la télévision avait été inventée en 1946, un an avant. C’était un petit écran de huit pouces, mais nous avons regardé les World Series de baseball. Les Yankees contre les Dodgers. Je me souviens avoir fait payer cinquante cents aux gamins qui venaient voir. C’était vraiment fantastique. Le seul problème, encore une fois, c’était que mon père n’aimait pas travailler. J’ai dit : «Papa, on tient un filon en or. Tu sais t’y prendre. On va tous t’aider. On peut en monter un autre. Tout le monde veut en acheter un.» Il a dit : «Non, non. J’en ai fait un, c’était le défi. Désolé, ça ne m’intéresse pas.»
Voilà, ça c’était triste. Alors j’ai compris que la seule façon de sortir de la pauvreté, c’était l’école. J’ai compris ça très, très jeune. J’aimais l’école. L’école était ordonnée, propre, soignée ; le chaos n’y avait pas sa place. On laissait la pauvreté derrière soi. Les enseignants de l’époque étaient réellement admirables. Ils étaient vraiment héroïques. Ils venaient dans ces quartiers pauvres — parfois dangereux — et nous enseignaient non seulement leur matière, mais ils donnaient aussi des leçons sur la vie, l’importance de l’hygiène, la propreté personnelle. Je me souviens encore de la façon de dresser la table. Je voyais bien à l’époque que c’était quelque chose de très précieux et j’étais reconnaissant.
J’étais un très bon élève. Je suis passé de la Public School 25 de mes débuts, à la Public School 521 un collège de garçons. J’y ai obtenu mon brevet, puis je suis allé au lycée Stuyvesant, mais seulement pour un trimestre, car après avoir fréquenté uniquement des garçons au collège, j’ai dit : «Assez ! Assez d’être qu’entre mecs». Le lycée Stuyvesant était génial, c’était franchement de très haut niveau. Mais j’ai préféré passer au lycée James Monroe dans le Bronx parce qu’il y avait plein de jolies filles et mes amis y allaient. Puis, à la fin de 1947/1948, ma famille a déménagé à North Hollywood, en Californie. Mon père avait sept sœurs aînées et deux frères plus jeunes. Ils vivaient tous là-bas et faisaient pression sur mon père pour qu’il les rejoigne, pour réunir la famille. Alors on est partis. On a pris un DC-3, l’un de ces avions minuscules. Il paraît qu’on en voit un dans un film avec Clark Gable et Carole Lombard. C’était incroyablement cher.
Il nous a fallu vingt-quatre heures pour rejoindre Burbank depuis l’aéroport de LaGuardia, avec trois ou quatre arrêts. Mais pour nous, les enfants, c’était fabuleux. Malheureusement, 1948 fut l’année de la grande récession à Hollywood, en Californie. L’industrie du cinéma craignait que la vidéo ne prenne le dessus. Beaucoup de sociétés de défense perdaient leurs contrats publics. En clair, on est allés jusque là bas et il n’y avait pas de travail pour mon père (rires). On a fini par être encore plus pauvres qu’à New York, sauf que là, on était pauvres dans un endroit splendide.
La vie y était vraiment dure. Mais c’était si beau. C’était extraordinaire pour quelqu’un qui venait du Bronx où tout n’était que béton, acier et asphalte. Quand je donne des conférences, je montre toujours des photos du terrain de jeu — pas seulement des maisons qui l’entourent. Le terrain de jeu, c’était de l’asphalte et rien d’autre. Il était fermé le week-end, alors on devait escalader une clôture pour y jouer. Imaginez un peu : pas de verdure, pas d’herbe, pas de fleurs, pas d’arbres. Pour aller jusqu’à St Mary’s Park, je devais marcher sept blocs. J’y allais au moins une fois par an pour des projets scolaires, comme la maquette d’un village indien. Je savais que le seul bouleau de South Bronx se trouvait à St Mary’s Park. J’y allais, je coupais mon petit morceau d’écorce de bouleau pour en faire un petit canoë. Je pense que je l’ai encore, après toutes ces années. Et puis on débarque à North Hollywood, et là il y a des arbres et des fleurs partout.
Ce qui semblait le paradis s’est révélé un cauchemar pour moi personnellement. J’avais toujours été un gosse très populaire. J’avais fait en sorte de l’être. Quand je dis populaire, je veux dire que j’ai toujours été le président, vice-président, capitaine, vice-capitaine de tout, que ce soit des équipes sportives ou des classes.
Et pourquoi ça ?
Il va falloir remonter encore plus loin en arrière. À l’âge de cinq ans et demi, j’ai eu la coqueluche et une double pneumonie. La coqueluche est une maladie contagieuse. C’était en novembre 1938. À cette époque, beaucoup de maladies contagieuses circulaient dans les ghettos. Les gens vivaient dans une telle promiscuité, les conditions étaient très toxiques, l’air était toxique — tout ce qui pouvait être mauvais l’était. Ça vaut pour tous les ghettos du monde. Quand j’ai développé la pneumonie, j’avais cinq ans et demi, et il y avait à Manhattan un hôpital pour les enfants atteints de maladies contagieuses. L’hôpital Willard Parker. Il était destiné à tous les gamins de New York, entre deux ans et l’adolescence tardive. La loi exigeait de placer tous les jeunes malades dans ces hôpitaux jusqu’à ce qu’ils soient en bonne santé, débarrassés de la maladie.
J’y suis resté six mois, de novembre 1938 à avril 1939. Le problème, c’est qu’il n’y avait pas de médicaments. On n’avait pas encore inventé la pénicilline ni les sulfamides2. Ce qui veut dire que pour tous ces gosses qui souffraient de diphtérie, scarlatine, polio, et j’en passe, il n’y avait pas de traitement. On restait simplement au lit, tout le temps. Il n’y avait même pas le concept d’exercice dynamique — s’étirer allongé, faire quelque chose —, alors on restait juste allongé. En fait, on se couchait là et on se dégradait. Les muscles s’atrophiaient. Les gosses mouraient. J’ai encore cette image de grandes chambrées, tout en longueur, avec des lits côte à côte à perte de vue.
Les médecins venaient, prenaient votre dossier, disaient parfois : «Comment te sens-tu ?» On répondait : «Oh, très mal.» Et ils cochaient une case. Les infirmières passaient et la seule chose qu’elles faisaient, c’était de prendre votre température. Et ce qui arrivait, c’est qu’au réveil le matin, on leur demandait : «Madame, où est Billy ?»
«Oh. Il est rentré chez lui» disait l’infirmière.
«Pourquoi il n’a pas dit au revoir ?»
«Eh bien, il était pressé.»
Le lendemain, c’était le lit de Mary qui était vide. Et tout à coup, on comprenait. C’était une conspiration du déni, les enfants mouraient tout le temps, on s’en doutait, et comme les infirmières ne pouvaient pas dire qu’ils étaient morts, elles racontaient qu’ils étaient rentrés chez eux. Ce qui était terrible, c’était que nous, les gosses, on a dû participer à cette conspiration, parce qu’on voulait tous rentrer chez nous, mais pas de cette façon. Et pour aggraver cette situation horrible, il n’y avait pas de radio, pas de télévision. Pas de courrier des parents. Pas d’appels téléphoniques. De toute façon, les pauvres n’avaient pas le téléphone chez eux. Il y avait une heure de visite par semaine, le dimanche, ce qui est inimaginable pour un enfant qui attend toute la semaine. Alors, quand c’était dimanche, mes parents venaient avec mes frères. Ils étaient derrière une grande vitre. On poussait mon lit contre cette vitre. Il y avait un téléphone pour pouvoir discuter.
Bien sûr, tout le monde pleurait. Je pleurais pour être avec eux, ils pleuraient sans doute en voyant mon état. J’étais vraiment pâle. Avec une double pneumonie et la coqueluche, j’avais du mal à manger. J’avais du mal à mettre quoi que ce soit dans ma bouche parce que l’association de ces deux maladies rendait la déglutition et la respiration difficiles. Je maigrissais à vue d’œil. Alors ils pleuraient et pleuraient encore. Il y avait quatre groupes de visiteurs. Quand le cinquième arrivait, on retirait votre lit. Officiellement, la visite était censée durer deux heures, mais elle n’a jamais dépassé une heure.
C’était l’hiver et ma mère était enceinte. J’avais deux frères, Donald et George, chacun d’un an et demi plus jeune. Ma mère attendait ma future sœur, Vera. George avait une attelle sur une jambe. Il avait eu la polio, mais pas dans sa forme contagieuse. Les hivers étaient vraiment rudes à New York à cette époque, il y avait beaucoup de neige. Pour aller de chez nous dans le Bronx jusqu’à la gare, il fallait marcher environ six blocs. Il fallait compter au moins une demi-heure de train. Ensuite, encore cinq ou six blocs de la gare jusqu’à l’East River Drive où se trouvait l’hôpital. S’il neigeait, ma mère ne pouvait pas venir. Bien évidemment, on n’avait pas de voiture. Alors j’attendais toute la semaine, mais personne ne venait. Et ils ne pouvaient pas appeler pour avertir qu’ils ne venaient pas. C’était extrêmement déprimant.
Comment avez-vous réagi à cela en tant qu’enfant ?
J’ai réagi comme l’aurait fait un adulte. C’est ça le truc. J’ai décidé que je ne pouvais pas compter sur les médecins, que je ne pouvais pas compter sur mes parents, que je ne pouvais compter sur personne, alors j’allais devoir compter sur moi et sur Dieu. Je suis devenu très croyant, je priais tous les matins. «Bénissez-moi, mon Père. Je me bats. Je veux vivre. Je veux être en bonne santé, fort, courageux, intelligent, et j’ai besoin de votre aide.» Vous voyez : «Je serai gentil quand je sortirai», et ainsi de suite. «Faites que j’aille mieux le plus vite possible.» Et je faisais mes petites prières au cours de la journée.
Ma famille n’était pas religieuse. Mes parents n’allaient jamais à l’église, mais ils m’incitaient à y emmener mes petits frères. Malgré tout, des gamins mouraient tous les matins. J’ai pensé que Dieu ne tuerait pas les enfants, alors quand les lumières s’éteignaient, je supposais que c’était le diable qui venait faire son choix. Quelle était la meilleure stratégie dans ce cas ? La nuit, je priais le diable de ne pas me prendre. Je me sens encore coupable, parce que je disais : «Vous voyez, il y a plein d’enfants ici.» (rires) «Ils sont tous très gentils, mais si vous devez en prendre un, ne me prenez pas moi.» (rires) Et là je me glissais sous les draps et je m’endormais.
Je n’ai compris que plus tard que je pratiquais l’autohypnose. Quand je me réveillais, c’était le matin, je n’avais pas fait de rêves ni rien. C’est cette autohypnose que j’ai perfectionnée par la suite. En réalité, j’ai été formé à Manhattan, à la clinique d’hypnothérapie Morton Prince lorsque j’enseignais à l’Université de New York. Par la suite, j’ai mené un bon nombre de recherches en utilisant l’hypnose. Quand j’étais à l’Université de Stanford, je donnais toujours un grand cours sur l’hypnotisabilité. J’y faisais beaucoup de démonstrations et j’enseignais aux jeunes comment se servir de l’hypnose pour en tirer du positif.
Je suis devenu très indépendant. Mais une fois sorti de l’hôpital, me voilà revenu dans ce vieux quartier avec tous les gangs. Et à ce moment-là, j’étais un gosse vraiment maigre et chétif. J’étais rentré à la maison, tellement heureux d’y être revenu. Mais quand je descendais dans la rue, les gamins se mettaient à me hurler dessus, m’insulter et me pourchasser. Je ne comprenais pas ce qu’ils disaient, mais j’entendais qu’ils criaient que j’étais un «sale juif» ! Je courais et je courais, plus vite que mes agresseurs.
J’ai fini par être un bon coureur. (rires) Plus tard, je suis devenu le capitaine de l’équipe de course au lycée et au Brooklyn College, un établissement d’enseignement supérieur. D’ailleurs, notre équipe de relais, dont j’étais le sprinter final, a établi un nouveau record au Brooklyn College à l’époque. Finalement, il a fallu attendre que ma mère demande au fils du gardien, un Afro-Américain, Charlie Glassford — je m’en souviens encore après toutes ces années, j’avais dans les sept ans environ — de m’emmener à l’église le dimanche, pour qu’il dise : «Je ne peux pas l’emmener à l’église. Il est juif.»
Ma mère a répondu : «Non. Nous sommes catholiques.»
Il s’est exclamé : «Oh non, c’est pas vrai. Mais c’est parce qu’il est juif qu’on le frappe.»
Était-ce parce qu’ils pensaient que vous aviez l’air juif ?
Oui, parce que j’étais maigre, j’avais des yeux bleus et un grand nez. Les autres gosses étaient issus d’un vaste éventail de groupes ethniques. Cela corresponda...