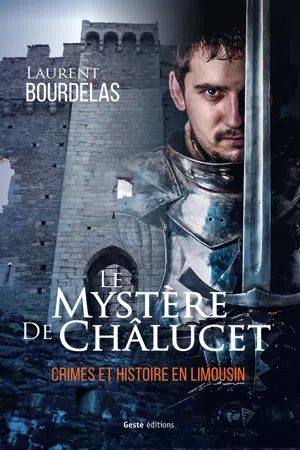![]()
- VI -
Le lieutenant Mathieu a préparé les informations demandées par Léonard Vinoy. Il est assis sur l’une des chaises faisant face au bureau, le capitaine est de trois quarts, observant le four à porcelaine.
— Châlucet est un site occupé depuis la protohistoire, divers sondages archéologiques l’ont montré. Sans doute les Lémovices – les Gaulois qui ont donné leur nom au Limousin – l’ont-ils également occupé. C’est ce que l’on appelle un site « en éperon » : une hauteur rocheuse entre deux rivières, la Briance et la Ligoure.
— Oui, je sais, Mathieu, je m’y suis promené dès l’enfance… avec mes parents et ma grand-mère, par tous les temps !
— Un mot, chef : c’est un site naturel protégé, avec une végétation et une faune intéressantes. Il y a sans doute eu un castrum au début du Moyen Âge, mais c’est surtout à partir du xiie siècle que l’on a trace des deux châteaux en pierre construits sur le site, de leur évolution et du village installé au confluent. Entremêlement de propriétés et de seigneuries, abbaye de Solignac non loin, chevaliers locaux et, plus tard, achat par Géraud de Maulmont, riche personnage influent du xiiie siècle, évoluant entre roi de France, Église et vicomté de Limoges. Il fit faire des travaux si importants sur la forteresse que l’on a pensé un temps que Châlucet était un château royal. Les deux châteaux sont entourés par une grande enceinte, l’éperon était barré par un profond fossé. À la fin du xive siècle, des routiers s’en sont emparé, et ils ont mis la région en coupe réglée sous le commandement de leur capitaine Perrot le Béarnais. Par la suite, la grande forteresse devint un repère de huguenots, ce que ne supportèrent pas les bourgeois de Limoges, fervents catholiques. Ils chargèrent donc le capitaine de la milice de la ville, Pierre de La Roche, dit « Vouzelle », de battre la campagne à la tête de deux cents hommes pour empêcher les allées et venues des protestants et effrayer la garnison de la forteresse. On décida de mener une opération d’envergure sur Châlucet. Des habitants de Saint-Léonard-de-Noblat, Solignac et Eymoutiers se joignirent à la milice limougeaude. Le 14 octobre 1577, la troupe, composée de fantassins et de cavaliers, s’achemina vers Châlucet. On entreprit de faire le siège de la forteresse, malgré la défense véhémente de sa garnison. Le 19 octobre, les soixante soldats et les familles de réformés, qui s’étaient réfugiés dans le château, finirent par se rendre. On leur laissa la vie sauve. La fortification fut ensuite démantelée. Pour payer les frais de cette expédition, les habitants de Limoges durent payer un impôt spécial. Mais les troubles n’avaient pas cessé en Limousin où s’activaient désormais les partisans de la Ligue. Les Limougeauds restèrent fidèles à Henri III puis au roi de Navarre, leur vicomte, seigneur notamment de Châlucet. Mais, en 1593, ils furent avertis que des hommes de guerre avaient été vus dans les parages. Ils décidèrent alors d’écarter tout nouveau risque. Le 4 janvier, une assemblée générale des habitants de Limoges résolut la démolition définitive de Châlucet, avec l’accord des officiers royaux. Le 5 janvier 1593, une centaine de miliciens, accompagnés des archers du vice-sénéchal et de volontaires, arrivèrent sur place. Mathieu du Mas, maître-charpentier, François de Rancon, maître-maçon, et leurs ouvriers étaient avec eux. Des habitants des environs rejoignirent cette assemblée. Au bout de quatre jours, si l’on en croit les Registres consulaires de Limoges, Châlucet fut totalement démantelé.
— Mathieu, tu racontes merveilleusement bien l’histoire. Je me demande pourquoi tu es devenu flic ! En tout cas, Châlucet est alors entré dans la torpeur pour quatre siècles.
— Oui, chef. Il est probable que les fermes des environs ont été construites avec des pierres du château ! En tout cas, c’est Prosper Mérimée qui fut à l’origine du classement des lieux. Il en a fait une très belle description dans son rapport. À la fin du xviiie siècle, c’est la famille de Verthamont qui était propriétaire – des conseillers au Parlement de Bordeaux. Après la Révolution, Châlucet a toujours appartenu à des familles en héritant comme d’une charge au milieu de leurs terres. Le lieu est demeuré longtemps à l’abandon, inspirant les poètes et les écrivains, les peintres et les photographes.
— Mais alors de quand date la mise en valeur ?
— L’idée date du xixe siècle. En 1859, le conseil général de la Haute-Vienne a demandé au préfet d’entrer en contact avec le propriétaire pour réfléchir à la protection de « ces nobles débris ». En 1887, l’érudit local Louis Guibert écrivait une monographie magistrale consacrée au site. Au xxe siècle, des associations furent créées, la plus active étant sans doute Châlucet en Limousin, qui œuvra dans les années 1990 pour la sauvegarde et l’animation du site et surtout pour son achat par une collectivité publique, ce qui fut finalement fait en 1996, le conseil général, dirigé par l’historien Jean-Claude
Peyronnet, s’en portant acquéreur, lançant une coûteuse opération de sauvetage qui dure encore et permettant d’entreprendre des fouilles.
— Et l’association ?
— Elle a été mise à l’écart, ce qui est dommage, mais c’est souvent le cas en pareilles circonstances. Depuis, le site est très visité par les touristes, sans animation particulière ni accueil vraiment à la hauteur d’un pareil lieu. Mais le nouveau président du conseil départemental a eu l’idée judicieuse de créer un conservateur du site et notre crucifié, qui s’était fixé dans la région depuis plusieurs années, semblait prêt à abandonner les Monuments historiques pour ce poste. D’autant plus qu’il avait suivi le dossier Châlucet pour l’État…
— Tu vois, Mathieu, mes grands-parents allaient parfois pique-niquer là-bas, sur les bords de la Briance, aux pieds du château, dans les années 1930. Ils prenaient le train jusqu’à Solignac puis poursuivaient la route à pied. Le Front populaire approchait, c’était un avant-goût pour mon grand-père Eugène, peintre en bâtiment. Mon père est né en 32, lui aussi a sans doute barboté dans la Briance ! Je ne sais pas s’il y avait Émile, le père d’Eugène… Lui, il s’est pendu à une poutre du grenier, en 36. Pas eu le temps de vraiment fêter Blum et Thorez ! Il y avait une fêlure, peut-être le souvenir de 14, où il avait été enseveli par l’explosion d’un obus et déterré in extremis par ses camarades. Ou la mort en couches de sa fille. Ou autre chose, va savoir. À Châlucet, quand j’étais gamin, il fallait avoir des bottes pour ne pas se faire déchirer la peau par les ronces ou piquer par une vipère. J’aimais bien cet endroit sauvage et dangereux. Par exemple, j’ai révisé mon bac assis dans la galerie des archers, à l’arrière du château haut. Nombreux étaient les étudiants qui y grimpaient la nuit, d’ailleurs. Tout ce que tu me dis est captivant, aussi bien en ce qui concerne le passé que pour aujourd’hui. Peut-être reste-t-il des frustrations, des déceptions… Nous allons creuser tout cela !
— Oui, chef. Et, comme nous sommes confrontés à une crucifixion, j’ai entendu dire aussi que les musiciens d’un groupe plus ou moins sataniste, Demon conviXion, aimaient aller chercher l’inspiration sur place.
— Eh bien, tout ça est prometteur ! Mais filons d’abord chez la veuve, si tu veux bien. Et débrouille-toi pour récupérer la bagnole avec le lecteur de CD.
Traverser la ville à pleine vitesse pour aller parler à la veuve d’un crucifié en écoutant Ugly Boy par Die Antwoord à plein volume fut une nouvelle expérience pour le jeune lieutenant Mathieu.
— J’adore ce groupe, lui dit Double Saint-Cyr. Je te conseille la video de Cookie thumper. Une fille affolante avec sa voix acidulée et de faux airs adolescents. En fait, c’est un trio de raprave sud-américain : Ninja, Yo-Landi Vi$$er et DJ Hi-Tek. Ils viennent du zef, un mouvement contre-culturel du pays.
Mathieu écoutait la musique et les commentaires tout en serrant la poignée, parce que Léon roulait vraiment vite et qu’il n’aimait pas ça. Ils remontèrent l’avenue François-Chénieux – une des rares artères à porter le nom d’un édile de droite –, Léon, en véritable cow-boy, déclencha sirène et gyrophare place Denis-Dussoubs, ils passèrent place des Carmes à toute allure, gagnèrent plus discrètement l’avenue Saint-Éloi et le cours Jean-Pénicaud. Ils arrivèrent donc rapidement devant la maison de Philippe Baillehache, dans le quartier cossu du square des Émailleurs. C’était en fait une grande villa blanc...