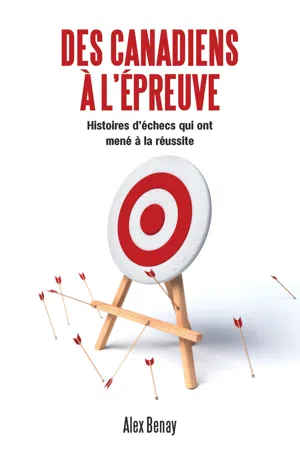9
Thomas Townsend
Chercheur invité au Centre en gestion et politiques publiques à l’Université d’Ottawa
Dire l’indicible lorsqu’on est au gouvernement
Dans les milieux du secteur public, Thomas est connu comme un homme d’action, quelqu’un qui mène à bien les choses. Il a travaillé à plusieurs paliers de l’appareil gouvernemental : aux Services correctionnels Canada, à la Mission du Canada auprès de l’Union européenne, ainsi qu’à titre de sous-ministre adjoint responsable du Projet de recherche sur les politiques. À l’heure actuelle, il est chercheur invité au Centre en gestion et politiques publiques à l’Université d’Ottawa. Il participe également au programme MBA exécutif à l’Université de Turku en Finlande. Peu de hauts responsables de la fonction publique sont disposés à parler d’échecs, mais heureusement, dans le cadre de ce projet, Thomas a bien voulu nous éclairer sur cet enjeu important!
— Alex Benay
« Le Scandale des commandites au gouvernement fédéral »
— Site Web de CBC, le 26 octobre 2006
« Le Scandale des commandites révèle de plus graves problèmes de gestion au gouvernement »
— Revue Maclean’s, le 19 juillet 2006
« Les pensionnats autochtones : une forme de génocide »
— Globe and Mail, le 17 février 2012
« Le désastre du sang contaminé : l’histoire d’une défaillance de système »
— CBC Radio, le 17 mars 1992
« Pourquoi le registre des armes d’épaule ne fonctionne-t-il pas – et n’a jamais fonctionné »
— National Post, le 11 décembre 2012
Nous avons un taux d’échec. Ceci est attribuable en partie au fait que nous essayons des choses que personne d’autre ne serait prêt à essayer. Je crois que ce doit être la crainte de l’échec qui paralyse les gens1.
Les échecs gouvernementaux font souvent la une des journaux. Il est probable que les lecteurs de ce chapitre auront plus de facilité à reconnaître les mauvais coups commis par le secteur public que les bons coups. Généralement, on fait état des échecs en matière d’actions blâmables, de malversations, de mauvaise gestion et d’incompétence. On présente l’échec dans le secteur public comme étant inacceptable en toutes circonstances.
Il faut souligner le fait que lorsqu’on met l’accent sur un autre secteur que le secteur public, les attitudes véhiculées à l’égard de l’échec sont différentes. Nous tolérons les échecs dans notre vie personnelle et dans l’entreprise privée. Nous nous réconfortons avec des expressions comme « qui vivra verra ». Nous disons à nos enfants « si vous ne réussissez pas du premier coup… ». Nous admirons la vision et la ténacité des inventeurs et des entrepreneurs comme Thomas Edison, qui a déclaré :
Je n’ai pas échoué 10 000 fois. Je n’ai pas échoué une seule fois. J’ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. Lorsque j’aurai éliminé toutes les solutions qui ne fonctionnent pas, je trouverai la solution qui fonctionne2.
En ce qui concerne le secteur public, est-il juste que nous maintenions un double standard en matière d’échec? La question reste ouverte. Il est incontestable, cependant, que l’intolérance à l’égard de l’échec dans le secteur public affecte la façon dont les fonctionnaires se comportent devant l’échec. Pour les fonctionnaires, l’échec est un sujet tabou; il leur est pratiquement impossible d’en parler. En réalité, il faut que la fonction publique dise l’indicible au sujet de l’échec.
Sur la foi de longues carrières en tant que fonctionnaires fédéraux, certains d’entre nous croient que les attitudes dominantes au sein de la fonction publique à l’égard de l’échec perpétuent une opportunité perdue importante et coûteuse. La crainte de l’échec – la crainte non seulement de l’échec lui-même, mais aussi la crainte d’une discussion franche sur l’échec – étouffe la créativité et l’innovation en plus d’entraver l’apprentissage. Dans son rapport au Parlement en 2016, le vérificateur général du Canada constate l’incapacité chronique du secteur public d’apprendre de ses échecs :
Nos audits relèvent ces mêmes problèmes au sein de différentes organisations à maintes et maintes reprises. Et ce que je trouve encore plus préoccupant, c’est que lorsque nous effectuons un suivi, nous constatons souvent que les résultats des programmes ne se sont pas améliorés. En seulement cinq ans, avec une centaine d’audits de performance et d’examens spéciaux à mon actif depuis le début de mon mandat, les résultats de certains audits évoquent les mots de l’illustre Yogi Berra – « encore du déjà vu »3.
Dans un monde en mutation rapide, cette litanie de problèmes gouvernementaux jamais réglés nous rappelle que les gouvernements ont besoin de relever rapidement les nouveaux défis. Le fait d’entretenir une relation dysfonctionnelle avec l’échec est néfaste non seulement pour la fonction publique, mais aussi pour les Canadiens en général. Il est temps que nous, au gouvernement, disions l’indicible avec confiance, à haute voix, et entre gens polis.
Si le problème décrit par le vérificateur général s’enracine dans la façon dont la fonction publique aborde l’échec, alors, quelle est la solution? Cette question nous amène au but de ce chapitre, où l’on propose une manière opportune d’établir une relation plus saine avec l’échec dans la fonction publique.
Le jour où les fonctionnaires auront la capacité et la volonté de valoriser l’échec, d’en tirer des avantages, le Canada et les Canadiens gagneront au change. Il pourrait même être souhaitable que les fonctionnaires aient la possibilité – dans des limites prescrites – de poursuivre des actions qui présentent une forte probabilité d’échec. (Je vais revenir sur ce sujet plus tard.)
Avant d’aller plus loin, soyons clairs sur une chose : on ne peut modifier la relation de la fonction publique avec l’échec que de façon limitée. Le greffier du Conseil privé – le plus haut fonctionnaire du gouvernement – a récemment déclaré, lors d’une réunion publique interne, que « celui qui n’échoue pas ne fait pas assez d’efforts ». Bien que le message semble avoir été bien reçu et motivé par une bonne intention, certaines personnes dans la salle ont peut-être hésité à le prendre au sérieux parce qu’elles savent que la crainte de l’échec dans le milieu gouvernemental est étayée par des vérités inaltérables. Deux d’entre elles sont particulièrement importantes.
Tout d’abord, les ministères sont là pour agir dans l’intérêt public. Ils investissent de l’argent public dans des politiques d’intérêt public sous la direction de ministres élus. Grâce à la combinaison des attentes publiques en matière de bonne gestion et des pressions politiques, on s’attend et on s’attendra toujours, heureusement, à ce que les actions gouvernementales soient soumises à la vigilance du public, et que ces actions soient prises en fonction de la responsabilité et d’une sensibilité aiguë à la perception publique.
Deuxièmement, tout ce que le secteur public fait, directement ou indirectement, vise à contribuer au bien-être public. Dans ce contexte, l’échec se traduit par une perte (réelle ou perçue) du bien-être. Dans les cas extrêmes, comme les tragédies des pensionnats autochtones établis pour les jeunes des Premières Nations ou encore de la crise du sang contaminé, l’échec du secteur public représente une question de vie et de mort.
Ainsi, même s’il est à souhaiter que nous acceptions l’échec dans le secteur public, nous devrons le faire avec prudence et de façon réaliste.
Comment faire pour améliorer la situation?
Le service public n’améliorera pas sa relation avec l’échec tant que l’échec sera traité comme un concept large et indifférencié se profilant au-dessus de nous, tel un ciel gris et informe. À cette fin, ce chapitre se déroule en trois étapes :
- Premièrement, je compte isoler plusieurs grandes catégories d’échecs, dont une en particulier qui pourrait nous permettre de concentrer nos efforts sur l’amélioration de notre relation avec l’échec.
- Deuxièmement, j’entends isoler trois facteurs généraux qui servent de signes avant-coureurs de la probabilité d’échec.
- Troisièmement, je vais proposer des mesures concrètes visant à renforcer la capacité de reconnaître et d’agir lorsque nous apercevons les signes avant-coureurs de cette probabilité d’échec.
À qui la faute, alors?
Un examen4 des rapports du vérificateur général entre 1988 et 2013 signale 614 cas d’échec dans le secteur public. Cet examen constate des dépassements de coûts, des paiements de prestations injustifiés, le non-respect des objectifs, la communication d’informations financières erronées, l’inefficacité dans la fourniture de services, des violations de politiques et de lignes directrices, des dépenses engagées pour des éléments n’offrant aucune valeur et de la gestion inappropriée.
Il serait raisonnable de supposer qu’une infime proportion de la population canadienne ait eu connaissance de plus d’un ou deux de ces 614 échecs. Quiconque a déjà passé du temps à l’intérieur de la fonction publique comprendra sans difficulté que la grande majorité des échecs ne présente aucun intérêt pour les rédacteurs des grands titres des médias. En ce qui concerne les préjudices causés, la majorité de ces échecs ont été relativement insignifiants, ces échecs étant rarement l’œuvre de gens coupables et mal intentionnés.
Selon une étude de l’échec dans le secteur privé5, publiée dans la Harvard Business Review, dans la grande majorité des cas d’échecs organisationnels, il ne sert pas à grand-chose de chercher à jeter le blâme sur quelqu’un. Amy Edmondson, l’auteur de cette étude, conclut que l’attribution du blâme a été utile dans moins de 5 % des cas qu’elle a examinés. Qui plus est, les gestionnaires impliqués dans le même ensemble d’échecs ont vu les choses d’une tout autre façon; ils ont estimé qu’il convenait dans 90 % des cas de désigner qui devrait en porter le blâme! (Cette constatation laisse croire que le secteur privé n’entretient pas nécessairement des relations plus saines avec l’échec que le secteur public.)
Mauvais échec; bon échec
Voici l’aperçu clé de madame Edmondson : les échecs ne sont pas tous égaux. Cet aperçu est d’une importance capitale pour la fonction publique fédérale canadienne. En effet, elle présente un éventail d’échecs, allant des échecs reprochables aux échecs louables.
- Les échecs évitables sont toujours mauvais; dans ces cas, chercher à attribuer le blâme peut être pertinent. Ce sont des échecs où les processus et les procédures sont normalisés et reproductibles. Les programmes offrant des prestations de revenu telles que la Sécurité de la vieillesse ou l’assurance-emploi sont des exemples correspondant à cette description. Dans ce genre de contexte, le ministère gouvernemental dispose d’un degré élevé de contrôle sur l’apparition d’échecs, et il est relativement facile d’isoler les causes de défaillances particulières. La responsabilité de tels échecs peut, et sans doute, doit être établie.
- Les échecs résultant de la complexité du processus ont tendance à se produire lors de périodes marquées par des conditions changeantes; il peut être contre-productif de considérer de tels échecs comme mauvais et reprochables. On peut penser aux échecs occasionnés par la lourdeur des processus gouvernementaux dans leurs interactions avec le public, et ce, dans un contexte où des sociétés privées telles que Amazon et eBay ont tellement introduit d’innovations dans le service à la clientèle qu’elles ont contribué à accroître les attentes du public. De plus, les processus peuvent être rigides au point d’empêcher le personnel de faire son travail, de sorte que le personnel doit choisir entre l’accomplissement de son travail et le respect des règles. Ce type d’échec peut résulter de causes multiples sur lesquelles aucun individu, programme, ni organisation n’exerce d’influence significative. Dans ce contexte, la recherche du « coupable » créerait plus de problèmes qu’elle n’offrirait de solutions. Elle finirait peut-être par désigner le coupable là où une telle désignation n’était pas méritée.
- Les échecs qui se produisent lorsqu’une organisation se trouve à la frontière de ce qu’elle connaît sont toujours bons (mais ces échecs doivent être gérés avec efficacité). Ces échecs peuvent se produire lorsque les organismes gouvernementaux décident de repenser fondamentalement les biens et services qu’ils livrent ou la façon dont ils livrent de tels biens et services. Lorsqu’on cherche à remplacer la vieille façon de faire des affaires par une nouvelle façon qui soit meilleure ou qui offre un nouveau service, il peut s’avérer nécessaire d’expérimenter et d’échouer. Mais dans ce contexte, le fait d’attribuer le blâme est contre-productif.
Nous cherchons à démontrer comment la fonction publique pourrait bâtir une relation plus saine avec l’échec. Une telle relation pourrait s’établir surtout dans le cas où l’organisation elle-même se trouve aux frontières de la connaissance. Dans ce contexte, le blâme a très peu de pertinence et le potentiel d’apprentissage de l’échec est élevé. Il y a deux principaux défis à relever dans ce contexte : le premier consiste à remplacer le concept selon lequel « aucun échec n’est autorisé » par le concept selon lequel on peut « échouer en toute sécurité »; le deuxième consiste à renforcer les capacités et les procédures de détection précoce de l’échec en vue de contribuer à l’apprentissage ainsi qu’à une adaptation réussie.
Échouer aux frontières de la connaissance – l’exemple de la SCEE
À la fin des années 1990, après trois décennies d’augmentation significative du coût de l’éducation, le gouvernement fédéral voulait s’assurer que l’éducation postsecondaire soit accessible à tous les Canadiens, en particulier aux étudiants des ménages à faible revenu. En 1998, il a donc lancé la Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE), en vue d’inciter les familles à épargner pour l’éducation de leurs enfants. Puisque le gouvernement fédéral n’avait rien essayé de pareil auparavant, il s’agissait d’un programme novateur. Comme j’étais responsable de ce programme, je peux m’appuyer sur mon expérience vécue pour en parler.
En 2003, une évaluation révélait un résultat inattendu et indésirable : les ménages à revenu élevé bénéficiaient de la SCEE dans des proportions beaucoup plus élevées que les ménages à faible revenu. En d’autres mots, une proportion importante des ressources du programme subventionnait les économies réalisées par des familles qui, selon toute vraisemblance, auraient économisé pour l’éducation de leurs enfants en l’absence du programme. En réponse, des efforts supplémentaires ont été déployés pour sensibiliser les ménages à faible revenu au programme; en outre, des ressources ont été attribuées à la mise en place d’incitations plus importantes pour ces ménages.
Nonobstant les efforts correctifs, une évaluation en 2015 révélait toujours que les ménages à revenu élevé étaient les principaux bénéficiaires de ce programme. Alors, faut-il en conclure que le programme a échoué? Sans doute a-t-il permis à certains ménages à faible revenu d’accéder à l’éducation postsecondaire, mais les principaux bénéficiaires se sont révélés être des familles qui auraient eu les moyens d’envoyer leurs jeunes à l’université sans subvention.
Aurait-on pu prévoir ces résultats inattendus au moment où la politique en était encore au stade de la discussion – cette politique qui consistait à subventionner l’accès à l’éducation postsecondaire, en mettant l’accent sur les familles à faible revenu? Oui, dans une certaine mesure, on aurait pu prévoir ces résultats. On aurait pu distribuer davantage de retombées de ce programme parmi un plus grand nombre de ménages à faible revenu, mais à une condition : que la conception et la mise en œuvre du programme fussent assorties d’une plus grande expérimentation opérationnelle.
Une fois qu’il est devenu évident que le programme ne donnait pas les résultats escomptés, pourquoi a-t-on préféré y apporter de petits ajustements au lieu d’entamer une refonte radicale? Parce qu’en absence d’incitation à mettre à l’essai différentes options de refonte « sur-le-champ » – et en l’absence de structures et de procédures permettant d’effectuer de telles expériences à petite échelle – les gestionnaires de programme se sont tout naturellement limités à apporter de petits changements sécurisants qui ne s’écarteraient pas du chemin tracé à l’avance.
Anticipation – Oui. Inquiétude – Non
Il est avantageux de choisir les frontières de la conn...