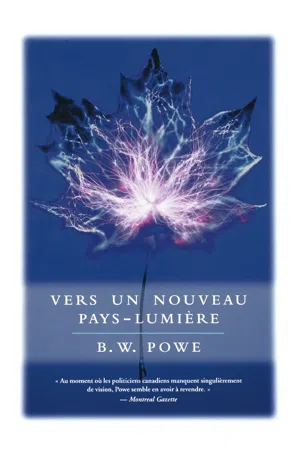![]()
Première méditation
AU PAYS DE LA COMMUNICATION
![]()
Au cours de son premier hiver canadien, [Alexander Graham] Bell avait repris certaines de ses expériences antérieures avec les diapasons . . . Le télégraphe harmonique ou multiple (prototype du téléphone) commençait à prendre forme. Il passait des heures dans le petit salon [. . .] à chanter une seule note, penché sur le piano, le pied sur la pédale, «à guetter une vibration dans le ton correspondant».
— AVITAL RONELL, décrivant la démarche
intellectuelle de Bell, dans The Telephone Book:
Technology-Schizophrenia-Electric Speech
Je perçois la communication comme la grande valeur du Canada, un pays où la bonne entente coexiste avec la mésentente, l’invective avec la conciliation, la négociation constante avec les limites comme les écarts du langage. Nous avons dû apprendre à nous joindre malgré un immense territoire, couvrant cinq fuseaux horaires et demi, étendue autrefois inculte et à peine peuplée, devenue un étalement de villes, de banlieues et de cités-satellites. Ici, la technologie forge des connexions et des déconnexions.
Au fil des comités et des assemblées qui établirent la carte du Canada en 1867, des controverses linguistiques et des crises politiques sur l’unité du pays, des débats publics et des référendums qui ont jalonné notre histoire depuis la Confédération, on peut distinguer et voir se tisser la trame d’une histoire: celle de la communication dynamique. Cette histoire est porteuse de milliers de messages, sur la nécessité de se parler, de s’écouter patiemment, sur l’urgent besoin d’un débat continu, sur la constatation ironique et subtile que notre pari audacieux et original doit s’incarner dans des conférences, des palabres et des communiqués, dans des images, des symboles et des signaux, dans des vibrations envoyées à travers les airs.
Depuis le début, les Canadiens ont dû poser des rails, construire des routes et des ponts, creuser des canaux, tendre des fils sur des poteaux télégraphiques, établir des réseaux de communication, des centres de transmission et de réception, établir les coordonnées complexes des liens qui allaient relier les côtes les plus éloignées, produire des traductions qui transmettraient la pensée d’un groupe linguistique à l’autre, dans un dialogue inextricable où la résolution de nos différends paraît souvent incertaine, voire improbable. Je prends la Tour CN, à Toronto, pour antenne, symbole de transmission du flux invisible, emblème d’accueil, qui invite l’esprit à prendre son essor.
Ce besoin, cette faim de communiquer a un envers, dans la décharge de bavardage inconséquent. C’est un bruit de fond qui peut déconcerter nos meilleurs instincts, entraver le flot de considérations morales: il peut s’agir de la grogne et de l’insinuation, du blâme et de l’accusation qui mènent au repli, au solipsisme politique qu’on appelle parfois le régionalisme. Configuré pour la communication, le Canada est une agora de voix nombreuses, où aucune ne prédomine, et dont la polyphonie produit parfois une cacophonie assourdissante.
Le champ de communication perpétuellement agité et changeant est ce qui rend le Canada si difficile à définir. Notre mythe, ou notre propension culturelle, diffère profondément de celui des États-Unis, avec son histoire individualiste, son militarisme et son commercialisme, ses conquêtes violentes d’espace et de peuples, sa notion millénariste de destinée manifeste. En Amérique, la créativité s’unit à la cruauté avec une force brutale et infiniment séduisante. Au Canada, nous nous serrons à la frontière de nos provinces avec les États américains, cherchant à nous associer en villes et en municipalités, forgeant des liens vitaux, construisant nos infrastructures communes (voies ferrées, barrages, projets hydroélectriques, satellites artificiels), pour ensuite nous montrer incapables de convenir du sens à donner à ce pays. Nous avons paradoxalement formé le consensus de ne pas nous laisser imposer une seule définition unificatrice. Nos conférences constitutionnelles et nos comités consultatifs incarnent un processus de déconstruction et de reconstruction graduelles. Or de nombreuses cultures, aux interprétations souvent contradictoires, se côtoient ici. Nos véhémentes discordes masquent peut-être une foi sous-jacente, comme si nous savions que nos débats confus et même acrimonieux, nos maladresses et nos malentendus, ces affrontements litigieux qui semblent saper notre bonne foi, pourraient nous induire à reconnaître nos différences, dans le sain respect de nos distances, et ainsi (autre paradoxe) à découvrir notre harmonie humaine profonde.
Nous résistons à articuler une version définitive du pays et de nous-mêmes parce que nous savons, au fond de notre âme, que notre histoire incarne le processus et la valeur de la communication même. Dans ce vaste et spacieux pays, aux lointains paisibles et solitaires, la contemplation et la rêverie peuvent nous inspirer: ici il est possible de penser, d’observer, de commenter, de réfléchir, d’interpréter, de se libérer des formes traditionnelles, pour être en mesure de rêver. Le déluge d’intensités électroniques ne fera qu’augmenter; or il peut être canalisé: communiquer, avec les autres, avec nos propres cerveaux, avec notre imagination même, avec la nature et avec la cité, par l’entremise de nos machines, est notre principale occupation. La culture, la possibilité d’affinité et de rapport est notre espoir primordial, tout comme parler, discuter, non pas simplement pour passer le temps, mais pour étendre l’interaction humaine au-delà de nos provinces. Nous savons que nous avons commencé sans idée prédéterminée de ce que nous étions ni d’où nous allions. Les pistes de communication, sans cesse changeantes, sont tout ce qui importe.
Le mythe du Canada, l’histoire cachée, est le récit d’un pays contemplatif, d’un lieu d’intériorité, où l’on peut s’interroger sur l’idée de nation, examiner les valeurs qu’on veut voir se manifester et se réaliser, réfléchir aux identités solitaires et aux rêves qu’on entend préserver. Nous attendons, au rendezvous des sociétés et des peuples, et dans notre attente souvent nous devenons perplexes, tentés par la colère et par des haines vengeresses, et pourtant attirés par des énergies à peine exprimées, des murmures dans l’air du nord, le souvenir persistant et pas toujours entièrement compris des efforts que nous avons mis à faire nôtre ce pays, par les libertés d’un nouveau monde.
Rappelons:
Les débats sur la Confédération (1864-1867).
Les représentants de l’Ouest (l’Ontario), de l’Est (le Québec) et des Maritimes se sont assemblés à Charlottetown, à Québec et dans la ville qui allait bientôt être rebaptisée Ottawa. Ils se sont réunis et ils se sont mis à parler, et leurs réunions se poursuivirent des jours durant, du matin au soir.
Suivirent des désaccords sincères, des discours ronflants, des arguments percutants, des regroupements, des tractations, des marchandages, des compromis et des concessions réciproques, des messes basses et de la grogne . . . Bref, d’après George Brown, un mélange de coaxing and wheedling, c’est-à-dire d’incitation et de cajolerie. La démarche était exploratoire, pleine d’incertitude, de lenteur, exigeant qu’on y voue de longues heures et des réserves de patience. Mais les représentants négociaient pour former une nouvelle union transcontinentale. Sir John A. Macdonald affirma que c’était «la deuxième fois que l’homme fondait une démocratie dans le Nouveau Monde...»
Octobre 1864, à Québec.
Le jour, il y avait des réunions, des délibérations autour de la table de conférence, et encore plus de mots, encore plus d’accommodements. Le soir, c’étaient des dîners, des bals, des conversations à bâtons rompus, des danses et encore des danses.
Edward Whelan, délégué de l’Île-du-Prince-Édouard, raconta ce qui suit: «Les ministres – les plus en vue surtout – sont les danseurs les plus infatigables que j’aie vus de ma vie; ils ne manquent pas une seule danse de toute la nuit.»
Et au sud de la frontière?
En septembre 1864, la guerre civile américaine atteignait son apogée sanglante. Sherman, le général unioniste, avait envahi Atlanta. En octobre, le général Hood, à la tête de l’armée confédérée, tendit une embuscade à Sherman à l’extérieur de la ville en flammes – mais la ruse de Hood ne parvint pas à retarder l’avance des troupes de Sherman. Au même moment, un autre général unioniste, Sheridan, dévastait la région de Shenandoah. Avant la fin de novembre, Hood s’était retiré en désordre, et Sherman avait rasé Atlanta. Les Yankees déferlèrent jusqu’à l’océan, traquant les rebelles, détruisant les voies ferrées, pillant les plantations et les fermes, brûlant les récoltes, faisant main basse sur les réserves de vivres, confisquant le bétail, jusqu’à ce que le Sud se rende, en 1865.
Pendant ce temps, au nord, des Canadiens de l’Ouest, des Canadiens de l’Est et les représentants des Maritimes parlementaient au sujet de l’unité. Quand ils ne débattaient pas la nature et la structure de la nouvelle nation, ils énonçaient de fortes opinions—qui n’étaient pas pour autant des positions définitives – quant à qui allait devoir endosser la plus grande part du fardeau de la dette nationale.
Rappelons:
Que le pari canadien fut en partie inspiré par la crainte de la guerre civile américaine et des raids fenian qui eurent lieu le long de la frontière vers le milieu des années 1860. Que, conscients du carnage qui avait lieu au sud, alarmés par la puissance militaire efficace et mobilisée de l’Union victorieuse, les politiciens canadiens se réunirent pour parler, parler d’une nouvelle espèce de pays et, par les mots, le mettre au monde.
Personne ne fut contraint de signer l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Pendant les débats, aucun individu, aucun groupe ne fit l’objet de tactiques d’intimidation ou de récupération déloyale, ni de coercition à la pointe d’un fusil ou d’une baïonnette, personne ne força quiconque à se ranger contre son gré. Les mots choisis par les pères de la Confédération ne consternèrent ni n’indignèrent aucun des participants des trois régions, pourtant bien différentes. Les politiciens, anglais aussi bien que français, convinrent d’un État parce que c’était dans leur intérêt et parce qu’ils étaient très conscients de leur vulnérabilité et souhaitaient se protéger. La délégation du Québec – dont Georges Étienne Cartier était un leader éloquent – reçut l’assurance que la province conserverait son propre système à l’intérieur du système plus grand, un geste délibéré et bien accueilli qui allait préserver un degré essentiel de dissidence au sein du nouveau pays.
Une lecture symbolique ou ésotérique des négociations et de la situation aux États-Unis et au Canada, respectivement, révélerait que les Américains combattirent leurs compatriotes sur le champ de bataille, souvent au sacrifice de leur vie, pour forger leur union d’acier, alors que les Canadiens s’affrontèrent autour de tables de négociation, apportant leurs arguments et leurs hésitations, forgeant les compromis et convenant des principes sur lesquels auraient lieu leurs débats futurs. Il semble bien que, quand les Américains perdent la tête et en viennent au meurtre, les Canadiens se disputent et prennent des notes.
Typiquement, l’union que les Canadiens improvisèrent était large, provisoire et variable. À aucun moment n’a-t-on le sentiment qu’ils tentaient de forger une identité spécifique: les mots qu’ils choisirent n’essayaient pas de promulguer des vérités éternelles. Le document qu’ils produisirent – l’Acte de l’Amérique du Nord britannique – était moins définitif, et beaucoup moins grandiose, que la Déclaration d’indépendance américaine, ou, tandis qu’on y est, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen française. L’entreprise canadienne dut paraître vague et irréaliste, en tout cas pétrie de paradoxes, car elle attelait ensemble des alliés improbables, les Français et les Anglais, et les populations disparates établies sur les côtes et à l’intérieur. Bien sûr, l’arrangement d’alors excluait beaucoup de gens. Il n’en demeure pas moins que le Epluribus unum américain s’accomplit par la guerre, sous les drapeaux, à grand renfort de parades et de fanfares militaires, en invoquant une cause vertueuse et certaine, sur des tas de cadavres et de décombres. Ici, on parvint à «la paix, l’ordre et le bon gouvernement» par la médiation, à coup de discours et d’ententes écrites, avec la garantie de reconnaître et de préserver nos différences: un processus dont on acceptait qu’il serait long et qu’il nécessiterait beaucoup de doigté.
Rappelons:
La fête du Dominion, le 1er juillet 1867.
Les fondateurs, à la dernière minute, rajoutèrent le mot «dominion» au titre du nouveau pays. Quelle en était la signification? Ils avaient d’abord pensé au mot «royaume», mais l’éliminèrent à cause de sa fâcheuse connotation d’empire. Suivirent des consultations, des discussions: ni «république» ni «État confédéré» ne trouvèrent grâce auprès des représentants, et plusieurs jugèrent l’appellation «dominion» obscure et même absconse. Il fut vite convenu que le titre serait surtout ornemental – une fioriture, sans plus —, un ajout improvisé, à réviser plus tard. «C’était plutôt absurde», ironisa avec hauteur le comte de Derby, un conseiller du premier ministre Disraeli.
En Grande-Bretagne, la classe dirigeante et les politiciens ne s’intéressaient pas beaucoup au Canada, et encore moins à sa désignation officielle, fût-ce «dominion» ou une autre. Disraeli, préoccupé par des questions de politique intérieure, comme le Reform Bill, qui étendait le privilège du vote à une plus grande partie du public britannique, et par l’ascension de Gladstone à la tête du parti libéral, qui menaçait sa survie politique, avait d’autres chats à fouetter.
Et la reine Victoria, que pensait-elle du mot «dominion»? «Ce n’est pas un ajout très heureux», laissa tomber la souveraine.
La première année, la population fêta spontanément l’anniversaire du dominion, sans avoir besoin d’un décret du gouvernement. Dans toutes les régions, on tint des feux d’artifice, des concerts en plein air, des discours publics, on déferla des bannières. Or il y avait une discontinuité provocante, même subversive, entre les messages formulés, de région en région, exprimant, une fois de plus, l’absence d’un idéal prépondérant, d’un concept uniforme, d’une seule communauté prédominante.
En Nouvelle-Écosse, une formule que les fondateurs avaient éliminée reparut sur des bannières:
SUCCESS TO THE CONFEDERACY
Et au Québec, on vit brandir le slogan:
BIENVENUE À LA NOUVELLE PUISSANCE
Ces messages étaient lourds de sens. De nuances, d’inflexions sous-jacentes. Confederacy désigne un État confédéré, c’est-à-dire un groupe d’États qui se liguent en un pacte, mais préservent chacun leur individualité: en bref, une fédération. Or, en 1867, les observateurs internationaux n’auraient pas manqué de constater que, si peu de temps après la guerre civile aux États-Unis et moins de cent ans après leur guerre d’Indépendance, ce terme annonçait et confirmait désormais une rébellion, et non une révolution.
«Puissance» a une étymologie intéressante, qui passe par l’italien possente, par l’anglais puissant ainsi que potent, et comporte des résonances ...