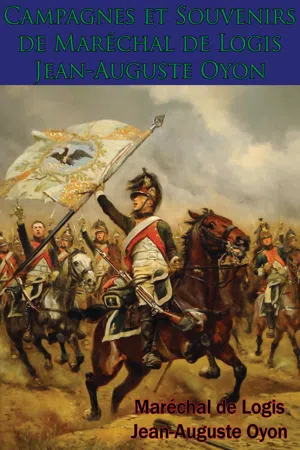
eBook - ePub
Campagnes et Souvenirs de Maréchal de Logis Jean-Auguste Oyon
- 257 pages
- French
- ePUB (adaptée aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
Campagnes et Souvenirs de Maréchal de Logis Jean-Auguste Oyon
À propos de ce livre
« Ulm et Austerlitz, le Portugal en 1807 et en 1808, Laon en 1814. Les amours de l'auteur occupent une place aussi importantes dans ses souvenirs que ses exploits militaires. » p 129 - Professeur Jean Tulard, Bibliographie Critique Sur Des Mémoires Sur Le Consulat Et L'Empire, Droz, Genève, 1971
Foire aux questions
Oui, vous pouvez résilier à tout moment à partir de l'onglet Abonnement dans les paramètres de votre compte sur le site Web de Perlego. Votre abonnement restera actif jusqu'à la fin de votre période de facturation actuelle. Découvrez comment résilier votre abonnement.
Non, les livres ne peuvent pas être téléchargés sous forme de fichiers externes, tels que des PDF, pour être utilisés en dehors de Perlego. Cependant, vous pouvez télécharger des livres dans l'application Perlego pour les lire hors ligne sur votre téléphone portable ou votre tablette. Découvrez-en plus ici.
Perlego propose deux abonnements : Essentiel et Complet
- Essentiel est idéal pour les étudiants et les professionnels qui aiment explorer un large éventail de sujets. Accédez à la bibliothèque Essentiel comprenant plus de 800 000 titres de référence et best-sellers dans les domaines du commerce, du développement personnel et des sciences humaines. Il comprend un temps de lecture illimité et la voix standard de la fonction Écouter.
- Complet est parfait pour les étudiants avancés et les chercheurs qui ont besoin d'un accès complet et illimité. Accédez à plus de 1,4 million de livres sur des centaines de sujets, y compris des titres académiques et spécialisés. L'abonnement Complet comprend également des fonctionnalités avancées telles que la fonction Écouter Premium et l'Assistant de recherche.
Nous sommes un service d'abonnement à des ouvrages universitaires en ligne, où vous pouvez accéder à toute une bibliothèque pour un prix inférieur à celui d'un seul livre par mois. Avec plus d'un million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce qu'il vous faut ! Découvrez-en plus ici.
Recherchez le symbole Écouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez l'écouter. L'outil Écouter lit le texte à haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, l'accélérer ou le ralentir. Découvrez-en plus ici.
Oui ! Vous pouvez utiliser l'application Perlego sur les appareils iOS ou Android pour lire à tout moment, n'importe où, même hors ligne. Parfait pour les trajets quotidiens ou lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas prendre en charge les appareils fonctionnant sur iOS 13 et Android 7 ou versions antérieures. En savoir plus sur l'utilisation de l'application.
Oui, vous pouvez accéder à Campagnes et Souvenirs de Maréchal de Logis Jean-Auguste Oyon par Maréchal de Logis Jean-Auguste Oyon en format PDF et/ou ePUB ainsi qu'à d'autres livres populaires dans History et British History. Nous disposons de plus d'un million d'ouvrages à découvrir dans notre catalogue.
Informations
Sujet
HistorySujet
British HistoryMA CAMPAGNE DE PORTUGAL EN 1807 ET 1808
A MES AMIS DE LAON
Comme j'ai toujours été fidèle à vous instruire de mes peines ou de mes plaisirs, vous aurez pensé qu'une année entière écoulée sans vous avoir rendu compte de mes aventures agréables ou périlleuses était une preuve de négligence ou d'oubli. Mais non l vous n'avez point cru cela ; la renommée vous a appris nos travaux, et les dangers qui nous ont accompagnés dans cette campagne à la fois glorieuse et désastreuse dont je vous dois le récit que je vais commencer, persuadé qu'avant de m'entendre vous m'avez excusé, et que vous me croyez incapable de rompre volontairement les liens d'une amitié qui doit être éternelle... Écoutez ! Plaignez et félicitez, tour à tour, celui qui voudrait, en vous faisant partager ses calamités, vous faire jouir aussi des moments heureux qui l'ont aidé à supporter ses peines.
CHAPITRE I — De Lorient A La Frontière De Portugal
C’est dans le courant de juillet 1807, après une grande revue sur les bords de la mer, à Lorient, qu’on nous annonça que, de corps d’observation des celtes de la Bretagne, nous devenions corps d’observation de la Gironde ; c’était assez nous dire que nous quittions une extrémité de la France pour aller occuper l’autre; on nous a fait faire du Bourbonnais ici, cent cinquante lieues pour prendre qualité; nous allons en faire deux cents pour en prendre une autre. Du moins, cette fois, je monte un bon cheval, j’ai abandonné depuis longtemps le sac et le fusil ; j’ai repris les éperons; il fait un temps superbe. Parcourir des pays enchanteurs, revoir les bords de la Loire, visiter ceux de la Garonne, traverser les sables brûlants des Landes, nous reposer un mois au pied des Pyrénées, tout cela en une seule action trop uniforme pour laisser aucun détail dans le souvenir : toujours de belles routes, toujours du beau temps. toujours bon accueil, il n’y a pas de peines à essuyer; le- plaisir est sans mélange, mais il est tous les jours le même.
En quittant la Bretagne, nous répétions, sous la forme d’une plaisanterie, le bruit répandu dans l’armée que nous marchions à la conquête du Portugal. Pouvions-nous croire ?... Pour atteindre les frontières de ce royaume, nous avions, par les routes militaires qui ne sont pas toujours directes, plus de sept cents lieues à faire et il fallait traverser toute l’Espagne. A quoi bon conquérir un petit coin de terre dont la France se trouve séparée par tant de pays ?... Ne serait-il pas beaucoup plus simple de désirer la possession de l’Espagne elle-même qui nous est voisine ? Oui, c’est fort bien raisonné, sans doute ; mais ce n’est pas de cela qu’il s’agit : un soldat raisonneur ne vaut pas grand’chose; ainsi, l’ami, pour peu que vous teniez à votre réputation militaire, si on vous envoie décidément en Portugal, prenez-en la route, et raisonnez chemin faisant, si cela vous amuse, sur la manière dont vous devrez parer les coups de sabre que ne manqueront pas de vous porter les défenseurs naturels de la puissance que vous allez envahir; mais ne raisonnez plus dorénavant sur les nécessités; laissez à messieurs les diplomates le soin d’en décider, et marchez !...
Soit ! Marchons !... Nous avons dépassé Bayonne et Saint-Jean-de-Luz, la Bidassoa est devant nous; c’est la seule barrière qui nous sépare des Espagnols. Ces derniers, loin de s’opposer à notre passage, doivent nous traiter en amis, et nous seconder dans notre entreprise. Ainsi nous allons voyager paisiblement sous la protection de la puissance alliée dont nous traverserons les États; nous n’aurons, jusqu’en Portugal, que bonne réception et plaisirs continuels.
Nous sommes à Irun, première ville d’Espagne. Je commence à penser que l’accueil et le plaisir ne répondront pas toujours à mon attente; en France, la population curieuse se pressait continuellement autour de nous, et se réjouissait de nous voir; ici nos fanfares font vainement retentir les échos d’alentour. Nous ne sommes escortés que par quelques misérables recouverts de haillons, qu’ils nomment orgueilleusement manteaux. Des persiennes grossières masquent toutes les croisées; à peine aperçoit-on à travers elles quelques hommes dont les regards inquiets semblent dire : Que venez-vous faire chez nous ?
Nos billets de logement à la main, c’est après avoir frappé dix fois aux portes, qu’enfin nous obtenons qu’elles soient ouvertes. Un être mouvant, enveloppé de l’indispensable manteau qui lui cache une moitié du visage, l’autre l’étant déjà par son chapeau (ce qui fait que l’on ne pourrait distinguer la place de la figure si deux yeux ardents ne perçaient à travers l’ouverture qui donne passage à l’air), vient de très mauvaise grâce demander ce que nous lui voulons ; il le sait bien, il a été prévenu d’avance. Le billet dont nous sommes porteurs le lui confirme encore ; pourtant il exige des explications; il discute, il dispute, et nous n’entrons qu’après avoir lâché le gros juron qui équivaut en France au « goddam » des Anglais. Par ce moyen, nous obtenons une chambre; nous le répétons sept ou huit fois si nous voulons obtenir un lit ou quelque chose de semblable.
Ce n’est pas seulement le particulier qui reçoit ainsi; les autorités locales, au mépris des ordres de leur gouvernement, tiennent à peu près la même conduite; à notre arrivée, les billets de logement n’étaient pas préparés, et l’alcade eût trouvé mauvais qu’on s’en fût plaint si notre « goddam» n’avait appuyé la plainte. Le soldat a besoin de nourriture, mais il faut attendre que le pain soit cuit, que les bœufs soient revenus des champs, et que la canaille employée à écosser les haricots, ait terminé sa besogne.
Heureusement nous avons de l’argent. Nous nous faisons indiquer une auberge; nous frappons à la porte de la posada, mais le possédé d’aubergiste ne répond encore que lorsqu’il voit la porte prête à s’enfoncer sous nos coups. Nous entendons glisser un verrou; nous faisons un pas pour entrer; nous avons tort; le verrou sert de fermeture à un petit guichet pratiqué au milieu de la porte. C’est par là qu’une mine rembrunie se fait apercevoir et qu’une voix brutale se fait entendre : Que voulez-vous ? — Nous voulons dîner. — Avez-vous des provisions ? — Parbleu ! Nous avons de l’argent; n’est-ce pas la même chose ? — Pas du tout ! Apportez de la viande ; on vous prêtera des ustensiles pour la faire cuire, et on vous fournira du vin. — Eh bien ! soit, mais donnez-nous du vin en attendant que nous ayons des provisions. — Combien vous en faut-il ? — Deux bouteilles ! — Donnez vingt sols ?
Nous avons passé la pièce de vingt sols par le guichet; nous payons avant même d’être introduits; sans doute on va nous ouvrir. Nouvelle erreur. Nous attendons encore cinq minutes, après quoi on nous passe, à travers le guichet, deux bouteilles que nous avons l’avantage de vider dans la rue, en buvant l’un après l’autre aux flacons. Notre hôte était vraiment bien confiant; il n’a pas paru craindre que nous les emportassions; c’est sans contredit un homme fort civil, il n’a pas voulu nous ouvrir sa maison !... Mais qu’y faire ?... C’est l’usage en Espagne, du moins à l’égard des Français. C’est ainsi que s’entendent les devoirs de l’hospitalité, même vis-à-vis de ceux qui la réclament en payant.
D’Irun à Vittoria, de Vittoria à Burgos, nous avons fait près de cent lieues; nous avons couché dans dix villes ou bourgs; partout nous recevons le même accueil.; partout des figures sombres, des gîtes incommodes, et quand des casernes ou des édifices inhabités se trouvent dans les lieux où rions devons coucher, les autorités s’empressent d’y fournir de la mauvaise paille afin d’y loger le soldat. Si celui-ci ne voit pas arriver tout de suite les vivres et le bois, il est sûr, au moins, de trouver à s’occuper utilement en les attendant. Afin de se procurer un sommeil paisible, il aura à détruire une foule de petits animaux de plusieurs espèces qui ornent la tête ou le pourpoint des indigènes, mais qui pour des Français sont un objet de répugnance et de honte.
Vous trouvez sans doute que je commence bien mal mon récit; c’est vrai ! mais il faut pourtant bien vous résigner à traverser l’Espagne, si vous voulez arriver en Portugal ; je vous ai promis de la peine et du plaisir ; ne vaut-il pas mieux se débarrasser de la peine d’abord pour jouir ensuite, avec sécurité, du plaisir s’il doit en venir ? Connaissez quelques-unes des mœurs de ces fiers
Espagnols dont on a si souvent vanté la noblesse et la grandeur d’âme. Ce que j’en ai appris en traversant leur pays n’est pas tout à leur avantage; mais encore une fois, qu’y faire ? Résignez-vous, armez-vous même de courage; ce que j’ai à vous dire est pis encore que ce que j’ai déjà dit.
Nous arrivons à Burgos, grande ville dont l’ensemble m’a paru fort triste. J’y suis logé chez un bon bourgeois à qui il ne manque que d’être poli pour être un homme ordinaire, et c’est déjà beaucoup pour un Espagnol…
Il est dix heures de la nuit ; je vais me coucher lorsqu’une vive altercation qui a lieu sous ma fenêtre m’engage à l’ouvrir. La voix d’un Français discutant avec chaleur, parvient à mon oreille; elle est la seule que j’entende ; mais à la faible clarté de la lune enveloppée de nuages, je distingue plusieurs hommes qui, sans proférer une parole, cherchent à entourer un militaire dont l’uniforme me paraît être celui du train de notre artillerie. Il reculait en gesticulant, afin qu’on ne l’approchât de trop près. Imprudemment, il est sans armes ; il se sert avec vivacité de ses pieds et de ses mains pour éloigner de lui ceux qui le pressent ; ils s’en écartent bien momentanément, à cause des coups qu’il porte au hasard, mais au moindre repos de sa part, ils le serrent de nouveau et ne tarderont pas à l’atteindre s’il n’est promptement secouru.
Indigné d’une attaque aussi lâche, je saute à mon sabre, à mes pistolets; en deux bonds je suis à la porte de la rue ; je tente de l’ouvrir : c’est en vain ; elle est fortement barricadée ; la clef de la serrure, celle du cadenas de la barre de fer, sont enlevées. Je crie comme un énergumène, je tremble de colère et d’impatience. Je frappe à la porte de la chambre de mon hôte ; je l’interpelle vivement, tantôt avec menaces, tantôt avec prières ; il me répond, mais sans m’ouvrir ; il est lui-même enfermé à double tour…
J’exige l’ouverture de la porte de la rue, et je ne puis seulement obtenir celle de son appartement. Il me supplie de me calmer : « Si je sors, dit-il, je serai assassiné sans pouvoir secourir le malheureux dont on attaque les jours» ; lui-même, tôt ou tard, se ressentirait d’avoir facilité mon dessein ; ce n’est pas impunément que l’on s’aviserait de troubler une expédition nocturne.
Sans moyens de sortir, je remonte précipitamment à ma chambre ; je cours à ma fenêtre, je ferai feu de mes pistolets, au risque de tuer mon compatriote, niais le bruit vient de cesser. Plusieurs hommes s’éloignent en silence, l’un d’eux chargé d’un fardeau !...D’une voix perçante je crie à l’assassin. Je veux attirer du monde dans la rue; les brigands, pour fuir, seraient forcés d’abandonner ce qu’ils emportent ; je crie inutilement, personne ne répond, personne ne paraît; le silence, lorsque je cesse, n’en est que plus grand ; le crime est consommé, les criminels resteront impunis.
Il faut se mettre à ma place pour bien se figurer tout ce que j’éprouve dans ce cruel moment. On assassine sous mes yeux ; je ne suis séparé du lieu où se passe cette scène affreuse que par une cloison ; ma présence pouvait sauver la victime, et mes efforts pour parvenir jusqu’à elle sont impuissants !...
Sachant à peine ce que je fais, pleurant de rage, je retourne à la chambre du patron. Je proteste que s’il n’ouvre à l’instant, je suis capable de mettre le feu à sa maison afin de me procurer une issue pour en sortir; je regrette même que cc moyen ne se soit pas présenté plus tôt à mon imagination; je l’assure qu’il n’a rien à craindre de moi.
Alors seulement, persuadé comme il l’est, que les assassins sont hors de ma portée, il consent à me laisser sortir. Il ouvre ; il se jette à mes genoux ; il tient un gros chapelet dans ses mains ; il est aussi peiné que moi… « Soyez bien persuadé, me ait-il, qu’au moindre mouvement de la porte, les bandits s’en seraient approchés ; ils sont très adroits ; ils vous eussent poignardé avant même que vous fussiez parvenu dehors, vous périssiez sans être d’aucun secours à celui contre lequel ils s’acharnaient. Nous sommes, hélas, trop accoutumés à des scènes de ce genre pour n’avoir pas depuis longtemps appris à nous conduire prudemment dans des circonstances pareilles. »
Je cours au poste de la place qui n’était qu’à deux cents pas au plus ; j’emmène une patrouille ; je la dirige du côté où j’ai vu se retirer les assassins; ils ont tourné le coin d’une rue peu éloignée de mon logis ; nous le tournons également, et un peu plus loin, nous nous trouvons en face d’une sentinelle espagnole qui soutient n’avoir rien vu ; pourtant le cortège infernal a dû passer contre elle ! !
Ennuyé de marcher sans but, je reconduis ma patrouille et reviens me coucher. Le matin encore, l’espoir de retrouver la piste par les traces de sang ne fait retourner à la place où s’était consommé le crime; elle n’était que faiblement tachée, et un peu plus loin il n’existait rien. Le corps du malheureux avait dû être enveloppé d’un tissu assez épais pour empêcher que l’effusion parût au dehors.
Un rapport à l’état-major fut la seule suite que put avoir cette affaire détestable.
Vous direz peut-être que c’est un crime ordinaire, un assassinat comme on en voit dans tous les pays connus; que ce qu’il a de plus affligeant que les autres, c’est que j’en ai été le témoin…Je vous répondrai que depuis Bayonne jusqu’à Lisbonne, soit dans les villes, soit dans les campagnes, sur vingt mille hommes environ qui composaient notre armée, plus de cinq cents périrent de cette manière; que, sur les routes, une cupidité féroce faisait, pour l’appât de quelques vêtements, perdre la vie aux hommes isolés, et quelquefois séparés seulement de deux cents pas de leur régiment ; que, dans les villes, on accusait jusqu’à la chirurgie de payer des expéditions de cette nature, pour obtenir des matériaux propres aux développements de cette science ! !
A deux journées de marche de Burgos, nous logeons à Palencia. Cette ville, au premier abord, nous parut immense, bien que pourtant sa population ne fût que de dix mille âmes ; mais une quantité de couvents l’agrandit de moitié. Quelques rues, occupées par le commerce et la bourgeoisie, en comprennent au plus un quart ; le reste se compose de quartiers sales et dégoûtants qui recèlent une population hideuse ne possédant que le manteau qu’elle tient de l’opulence des moines, et qui ne vit que des soupes qu’elle reçoit, deux fois par jour, sous les portiques des palais et des cloîtres. Proposez à un des membres de cette espèce de famille, de gagner un honnête salaire pour un léger travail, il vous injuriera ; mais si vous le lui proposez pour attendre la nuit une victime sous les arcades qui forment les côtés de chaque rue, il la poignardera !
L’air sauvage des habitants-de Palencia ne nous inspirait rien de flatteur. Plus de deux mille manteaux bruns, surmontés de chapeaux rabattus, sont sur la place où nous devons nous former en bataille. Nous obtenons difficilement qu’ils se- dérangent pour nous céder le terrain nécessaire à notre manœuvre; ils ne reculent, dans les enfoncements, qu’en proférant des injures grossières. et nous sommes obligés de souffrir autant d’insolence ! Nous commençons à nous faire à ces manières gracieuses ; elles prennent chaque jour un degré de plus d’amabilité. Ici pourtant, des conseillers charitables nous ont prévenus qu’il était dangereux pour nous de sortir le soir, et l’ordre fut communiqué dans les compagnies à chaque homme de ne le faire que muni de ses armes ; aussi, la plupart de nous prenaient-ils la précaution de ne marcher dans l’obscurité, que leur sabre nu à la main.
En même temps que la réception devient tous les jours de plus en plus maussade, le temps aussi s’est rembruni ; il nous fait une guerre dont les effets désastreux augmentent à chaque pas. Des pluies abondantes et des neiges fondues, tombant sans interruption, ne nous laissent pas un seul jour de relâche; les routes sont couvertes d’un pied d’eau, et chaque vallon offre un torrent qu’ont formé celles descendues des montagnes voisines ; il fallait traverser ces rivières de circonstance, et le malheureux qui heurtait du pied un caillou, chancelait, tombait, et roulait avec les eaux sans qu’il frit possible de le secourir.
C’est ainsi que nous arrivons aux frontières du Portugal, après avoir traversé depuis Burgos, plus de cent lieues de pays, laissant derrière nous un grand nombre de victimes du froid, de la faim, de la fatigue et des assassinats. Nous avons séjourné à Valladolid, à Salamanque, à Ciudad-Rodrigo ; nous entrons en Portugal sans nous en apercevoir. Les manières des habitants sont de plus en plus révoltantes ; nous ne communiquons avec eux qu’en les maltraitant ; ils ne cèdent qu’à la force ce qu’ils devaient à l’humanité et aux ordres de leur gouvernement ; leur conduite à notre égard nous a rendus méchants et exigeants ; nous ne demandons plus; nous prenons avec brutalité; la discipline est perdue ; elle ne pourra revenir que lorsque nous aurons repris la vie ordinaire.
CHAPITRE II — Nous Pénétrons En Portugal Par Les Montagnes De Béira
Ici nos souffrances redoublent; les assassinats se multiplient à l’infini; la faim et la fatigue augmentent considérablement nos pertes ; nous sommes exténués ! Dans les fonds, toujours des torrents à traverser; l’infanterie et la cavalerie y laissent leurs hommes et leurs chevaux; l’artillerie ne peut plus suivre, elle a perdu tout son équipage; nous gravissons à chaque instant des montagnes escarpées, par des sentiers que les chèvres seules fréquentent, et dont souvent la raideur pourrait être comparée aux trois quarts de la ligne perpendiculaire. Quand un cheval fait un faux pas, il roule avec so...
Table des matières
- Page titre
- Campagnes et Souvenirs militaires de Jean-Auguste Oyon (1783-1852)
- MES CAMPAGNES D’ULM ET D’AUSTERLITZ EN 1805
- MA CAMPAGNE DE PORTUGAL EN 1807 ET 1808
- RÉCIT DE LA BATAILLE DE LAON DES 9 ET 10 MARS 1814
- TABLE DES MATIÈRES