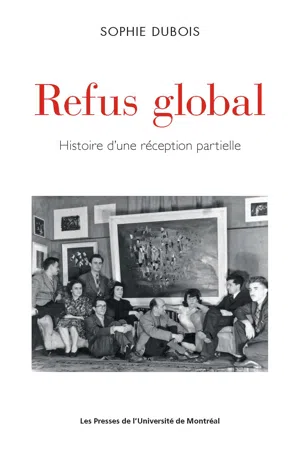![]()
De nouveaux obstacles
à la réception
![]()
CHAPITRE 8
Exister
L’édition représente donc un moment essentiel dans la constitution
de l’identité littéraire d’un texte: elle décide de son existence publique,
et fixe la norme sous laquelle il sera propagé, le format et le péritexte et le prix.
Il a beaucoup été question, dans les pages précédentes, de la critique en tant qu’instance de légitimation de l’œuvre littéraire. Or, pour que la critique puisse exercer ses fonctions normative et pédagogique, celle-ci doit avoir accès à l’œuvre. Cette tâche consistant à rendre l’œuvre disponible au jugement critique, ou à la lecture par le public, échoit à l’éditeur. De la même manière, lorsqu’une œuvre connaît un succès critique et commercial et qu’elle en vient à être épuisée, c’est à nouveau à l’éditeur qu’il incombe de la réimprimer ou de la rééditer. La réédition, comme mode d’appréhension d’une œuvre, participe pleinement à la réception de celle-ci. Elle apparaît également comme une des principales formes de légitimation et de consécration, consécration «qui, dans le discours préfaciel, prend parfois l’allure d’une réactualisation (ce texte reste lisible) ou d’une réhabilitation (ce texte avait été mal lu)».
On a vu en quoi la matérialité du recueil Refus global constituait un obstacle à sa survie en raison de la difficulté de lecture qu’elle occasionne. Or, elle nuit aussi à sa circulation: la rareté de l’objet et sa composition artisanale et hétérogène en font un ouvrage pouvant difficilement intégrer le marché commercial du livre. Les 400 exemplaires écoulés, celui-ci serait alors voué soit à l’oubli, soit à la rareté et à l’éphémère qui conviennent au genre du manifeste, et ce, bien que des copies tapuscrites aient vraisemblablement circulé au début des années 1950. Les premières rééditions ne correspondraient donc pas, en ce sens, à une redécouverte du texte ou à une volonté de le sauver de l’oubli (la réédition dans La revue socialiste en 1960 est d’ailleurs faite à «la demande de plusieurs […] lecteurs», signe que le texte demeure présent à la mémoire); elles résulteraient plutôt de la conjoncture entourant la mort de Borduas, laquelle amorce la tradition des rééditions du texte éponyme.
Au nombre de 36, ces rééditions révèlent l’importante circulation dont l’œuvre a bénéficié, qui lui a permis d’intégrer des lieux de discours divers et de jouir des lectures renouvelées qu’offre la modification du paratexte. C’est majoritairement le texte éponyme qui profite de cette diffusion. On en compte en effet 33 rééditions complètes ou partielles, alors que le recueil n’a fait l’objet que de trois rééditions. Il faut, du reste, noter que trois éditions des écrits de Borduas contiennent également «Commentaires sur des mots courants» et «En regard du surréalisme actuel», ce qui, sur le plan de la diffusion, donne à ces textes un statut particulier parmi les composantes marginales.
Postulant avec Dominique Garand qu’«à travers les diverses éditions d’un texte, il est possible de retracer l’histoire de sa lecture [et que] chaque nouvelle édition propose une interprétation», j’aborderai ici différentes rééditions du texte éponyme et du recueil afin d’examiner l’effet du paratexte sur la lecture de l’œuvre et, par le fait même, de comprendre ce qui, dans les circonstances et les lieux de discours des rééditions, conduit à favoriser une lecture du texte éponyme indépendamment de son premier contexte de parution en recueil.
Les éditions de référence
Parmi les types de relais qu’emprunte le discours critique sur une œuvre, les éditions forment certes un des plus communs et un des plus faciles à retracer. En effet, un auteur faisant référence à une œuvre doit, selon les normes admises dans les milieux savants, en fournir la source. Afin de déterminer quelles sont les éditions de «Refus global» les plus utilisées ont donc été répertoriées les éditions de référence mentionnées dans chacun des textes critiques. Toutefois, en raison de l’usage restreint fait de la référence dans le corpus critique (moins du quart des textes fournissent l’édition qui sert de source à leurs propos), ces résultats ne sont que partiellement représentatifs. Néanmoins, bien que l’écart ne soit pas très marqué, les textes critiques citant une composante marginale donnent plus souvent leur source que ceux ne citant que le texte éponyme, ce qui serait révélateur du statut acquis par «Refus global» dans la réception: celui-ci ne semble plus avoir besoin de référence, comme le suggère cette note de Jean Éthier-Blais dans son essai Autour de Borduas:
Le lecteur aura constaté que je ne cite qu’exceptionnellement un renvoi à Refus global; il en ira de même pour Projections libérantes. Ces deux textes sont courts et quiconque veut se reporter aux écrits de Borduas retrouvera facilement les citations que je propose.
Cette tendance qui consiste à mentionner davantage la source d’un texte marginal que celle d’un texte appartenant au fond culturel commun peut, par ailleurs, fournir une explication au fait que, parmi les références indiquées, les critiques renvoient presque aussi souvent à une des quatre éditions du recueil (y compris l’original) qu’à une des trente-trois éditions du texte éponyme. Alors qu’on aurait pu croire que les critiques avaient surtout travaillé à partir d’une des nombreuses éditions du texte éponyme (ce qui aurait dès lors empêché le contact avec les autres composantes et expliqué une part de leur occultation), il semble en être autrement – du moins chez ceux fournissant leur source. Il convient cependant d’envisager la possibilité que certaines des références au recueil original tiennent de la convention, sans que l’œuvre elle-même ait réellement été consultée; d’ailleurs, peu de textes critiques se référant à l’édition de 1948 fournissent une référence complète, voire un numéro de page pour leurs citations. Il demeure néanmoins que la réédition du recueil aux éditions Anatole Brochu en 1972 est proportionnellement (en tenant compte de l’année de parution) donnée comme source aussi souvent que le recueil paru chez Mithra-Mythe. Cette édition en arrive même à remplacer l’œuvre originale depuis longtemps épuisée et devient, à partir de 1972, l’édition de référence pour traiter de Refus global dans son ensemble ou d’une composante marginale. Quand il est question du texte éponyme, l’édition de référence la plus souvent citée est celle des Écrits de Borduas parue en 1987 aux Presses de l’Université de Montréal. La parution de cette édition critique marque d’ailleurs un tournant dans le mode de référence de l’œuvre: alors qu’avant 1988, la majorité des auteurs renvoyaient à une édition du recueil, après cette date, ce sont les éditions du texte – celle des PUM principalement – qui sont les plus citées. L’édition critique réussit donc, comme sa fonction le suppose, à faire autorité. Or, en remplaçant ainsi les autres éditions, elle efface, du même coup, la forme recueillistique originale et court-circuite la diffusion du recueil qui ne jouit plus du relais de l’édition pour survivre dans l’histoire.
Rééditions du texte éponyme
Le parcours éditorial du texte éponyme «Refus global» débute simultanément, à la suite du décès de son auteur, en France, dans la revue Aujourd’hui. Art et architecture et, au Québec, dans La revue socialiste. S’amorcent alors trois voies de rééditions parallèles: les anthologies, manuels et histoires de l’art ou de la littérature; les écrits de Borduas; et les ouvrages sur la société québécoise. Dans tous les cas, puisqu’elles relèvent soit des écrits d’un auteur, soit d’une historiographie disciplinaire (artistique ou sociale), ces rééditions offrent peu de possibilités de lecture à un recueil collectif et pluridisciplinaire.
«Refus global»
et Borduas au sommaire des anthologies
Chronologiquement, l’intérêt pour Borduas précède l’intérêt pour «Refus global». Aussi n’est-il pas surprenant que les premières rééditions du texte s’inscrivent dans des revues ou des ouvrages qui, sans être encore des recueils de ses écrits, portent sur le peintre. Outre la réédition partielle dans le dossier consacré à Borduas dans Aujourd’hui. Art et architecture en 1960, on compte des rééditions...