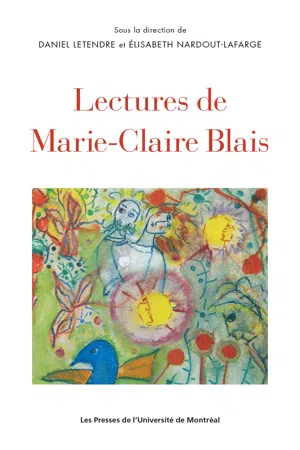![]()
1
Parcourir
![]()
Le bouleversement infini du monde
Michel Biron
En octobre 1959, Marie-Claire Blais écrit à Gilles Marcotte pour le remercier du compte rendu élogieux de La belle Bête qu’il vient de publier dans Le Devoir. Marcotte est déjà à l’époque un critique respecté et redouté, et c’est donc avec soulagement, on l’imagine, que la toute jeune romancière, qui fêtait ses vingt ans le 5 octobre, a dû accueillir une phrase comme celle-ci: «La belle Bête est le plus beau, le plus miraculeux des commencements». Soulagement, certes, gratitude, sûrement, mais il faut mal connaître Marie-Claire Blais pour croire que, même toute jeune, elle allait se plier au jeu de la déférence institutionnelle. Au fil de la lettre, on comprend que la romancière n’est pas seulement en train de remercier le critique pour son jugement bienveillant: elle est en train de le féliciter d’avoir bien fait son travail. C’est elle qui distribue les points, c’est elle qui juge le critique – et non pas l’inverse. À la fin de sa lettre, elle déclare: «Je suis très fière de vous.» Un critique, pour une fois, est à la hauteur des attentes d’un écrivain. Voici l’intégralité de cette lettre, de quatre petits feuillets, qui constitue une introduction parfaite à l’œuvre de Marie-Claire Blais:
Cher Monsieur et ami de mon œuvre,
Votre critique sur «La belle Bête» est un véritable petit chef-d’œuvre de douceur. Vous possédez l’enfance intérieure si cruelle et bonne pour avoir tant compris ces enfants de l’inhumain. Je sens que bien peu de grandes personnes sauront les accepter et les définir aussi merveilleusement, dans cet «état de grâce» que vous possédez. Car chaque romancier, chaque poète enfante à sa façon, il se donne comme il désire se donner, il est libre… il est seul, il risque seul et vient un moment de déchirure où l’œuvre ne lui appartient plus. Mais bien des critiques font partie d’une race éprise de destruction, une race de peur et le poète est sans défense devant cela puisque la bêtise laisse toujours sans défense. – Ah! Monsieur que je vous remercie d’avoir «racheté» avec tant de lucidité ces adultes pervers… Je vous remercie d’avoir «su rêver», d’avoir su me vivre à travers votre article.
Suivant la logique de l’éphémère, mes personnages glissent lentement vers la mort. Mais cette mort les sauve comme «l’acte de révolte» sauve Isabelle-Marie, toute nue dans sa blessure, toute dépouillée dans son propre sadisme. Et vous le dites aussi: «Comme si la vie devait se détruire pour se sauver et se nier dans les corps pour s’affirmer dans les âmes.» Vous «voyez» avec moi la lumière qui jaillit de ces cadavres. Car Isabelle-Marie a, malgré tout, l’étoile sanglante de l’espoir au fond du cœur. Peut-être que la monstruosité est belle sous son masque de ténèbres, sous son cœur en couteau. Et si la monstruosité est sans beauté dissimulée… vraiment l’homme n’a pas besoin de vivre.
Merci, cher ami, d’avoir senti mon monde poignardé par la passion avant d’être poignardé par le mal. Car ces êtres vivent en toute innocence. Je suis très fière de vous.
Sincèrement,
Marie-Claire Blais
L’écrivaine en herbe a de l’ambition, elle sait déjà pourquoi elle écrit, comment elle écrit et même comment elle veut être lue! Elle insiste sur ce qui sera au cœur de toute son œuvre, soit le salut par la révolte et le lien profond, nécessaire, entre la monstruosité de l’être et sa beauté, le passage obligé par le mal, par l’innocence du mal. On y voit aussi le pouvoir de rédemption qu’elle accorde à la littérature et à l’art en général, la quête de poésie étant une affaire du plus haut sérieux pour la jeune romancière, qui multiplie les figures d’écrivains et d’artistes dans ses livres. Elle est la plus romantique des écrivains de la Révolution tranquille, mais son romantisme est tout sauf mièvre, c’est un romantisme noir comme celui de l’écrivain Miguel, dans Les voyageurs sacrés (1966), qui finit suicidé dans la Seine, un romantisme que Margaret Atwood a récemment qualifié de «gothique» dans un numéro de Liberté célébrant Marie-Claire Blais comme «l’écrivaine de la marge».
Ce romantisme gothique va trouver sa forme privilégiée avec le réalisme sombre d’Une saison dans la vie d’Emmanuel, publié en 1965. La terrifiante Grand-Mère Antoinette a en effet quelque chose d’à la fois romantique et gothique. Son romantisme vient du fond des âges, symbole du passé canadien-français mais avec une profondeur qu’on dirait exotique tant on a l’impression d’être ailleurs, tant on n’a pas l’habitude d’entendre une grand-maman dire au dernier-né qu’elle déteste les nouveau-nés. Ce qui la sauve de la méchanceté et de la bêtise dans lesquelles baignent les autres adultes, en particulier les parents fantomatiques et le clergé hypocrite, c’est son improbable amour de la littérature, qu’elle projette dans la figure rimbaldienne de Jean Le Maigre, son préféré. Improbable, et pourtant on y croit tout à fait à cette grand-mère si peu orthodoxe, si libre, si entière, si entièrement naïve, pourrait-on dire, tant sa naïveté fait sa force, sa grandeur, son originalité. Le «génie» de Marie-Claire Blais, comme le disait à l’époque son mentor Edmund Wilson, c’est de mêler les cartes, de brouiller le système des valeurs, et de le faire sans la moindre hésitation, sans la moindre explication psychologique, au nom d’une sorte de réalité supérieure, qui n’est ni psychologique ni sociale, mais d’ordre poétique.
Dans une entrevue accordée au même Gilles Marcotte, mais beaucoup plus tard, en 1983, Marie-Claire Blais félicitera le critique (encore!) d’avoir si bien décrit, si bien compris la complexité de ce personnage pourtant simple de Grand-Mère Antoinette, le plus rigide mais aussi le plus généreux de ses personnages. Rien n’est plus précieux pour la romancière que cette vérité ambivalente de l’être: d’un côté, la dureté la plus extrême, l’autorité la plus rude, et, de l’autre, l’ouverture sans condition à la poésie la moins recevable, celle du voyou Jean Le Maigre. Il y a dans cette contradiction de l’être une vérité morale du personnage chez Marie-Claire Blais, qui aime non pas seulement les êtres marginaux, les victimes, mais aussi les criminels, les canailles, ceux que Lukács appelait les «exploités-prostitués» en parlant des personnages balzaciens. Seuls les individus portés par une violence intérieure, une violence parfois sans limites, seuls les personnages libérés de la peur des autres ont le pouvoir de transcender l’expérience du mal pour éprouver la beauté de l’être: «les gens vertueux me dégoûtent», dit Jean Le Maigre à son frère, le Septième, et on sent que le texte lui-même partage cette méfiance ou cette hostilité vis-à-vis des êtres satisfaits, des modérés habitant l’enfer dantesque des tièdes. Jean Le Maigre explique son sens de la hauteur à son frère complice: «Rappelle-toi que nous sommes supérieurs à tout le monde» (US, 45 et 72). Cette arrogance propre à l’artiste, Marie-Claire Blais se la reprochera plus tard, dans la même entrevue avec Gilles Marcotte, mais elle ne cessera jamais de croire au salut par l’art, qui a pour elle la force indiscutable d’une évidence.
La tentation du sublime traverse toute l’œuvre de Marie-Claire Blais, alors que la réalité dite romanesque, la réalité prosaïque, n’offre pour elle qu’un attrait tout relatif, malgré le succès d’Une saison, malgré les attentes de la critique qui espérait, un peu comme pour Gabrielle Roy après Bonheur d’occasion, une suite de la même encre. Et comme pour l’auteure de La Petite Poule d’eau, Marie-Claire Blais ne craint pas de décevoir les attentes de la critique, passant du registre parodique d’Une saison au registre grave de David Sterne (1967), puis au registre mémoriel de la trilogie des Manuscrits de Pauline Archange (1968-1970) avant de s’orienter vers des textes à caractère militant, comme Le loup en 1972. C’est comme si la jeune romancière cherchait à se déprendre du reflet immédiat d’une réalité qu’elle ne connaissait que trop, à l’instar de Jean Le Maigre se moquant de son quotidien, de sa famille, de sa religion, de sa maladie, de sa mort, de sa poésie elle-même. Elle explorera toutes sortes de formes, souvent avec ironie, mais c’est une ironie paradoxale, une ironie soumise elle-même au crible de l’ironie, selon l’heureuse formule de Nathalie Roy qui a consacré en 2007 une thèse de doctorat à la question de l’ironie chez Marie-Claire Blais. L’ironie est une arme à double tranchant, car à la longue elle interdit à la fois l’enchantement et le désenchantement: on ne peut pas être désenchanté si on ne consent pas d’abord à l’enchantement, explique Vladimir Jankélévitch pour qui l’ironiste pratique «l’art d’effleurer»: «L’ironiste ne veut pas être profond; l’ironiste ne veut pas adhérer, ni peser; mais il touche le pathos d’une tangence infiniment légère, et quasi impondérable.» On a l’impression que Jankélévitch parle ici de notre monde postmoderne même si son texte date de 1936. C’est encore plus vrai lorsqu’il décrit en une formule saisissante l’effet de la distance ironique: «Il y a dans le monde tout à la fois plus de variété et moins de ferveur.» De même lorsqu’il ajoute: «l’ironie, c’est la gaieté un peu mélancolique que nous inspire la découverte d’une pluralité».
Cette découverte de la pluralité s’impose de plus en plus au fur et à mesure qu’on avance dans l’œuvre de Marie-Claire Blais et elle s’accompagne d’une nouvelle conscience ironique, mais qui semble s’éloigner de ce qu’on a lu dans Une saison dans la vie d’Emmanuel. C’est ce changement d’écriture que je voudrais examiner ici. Ce n’est pas un changement de style ou de technique, comme on a pu le dire de façon rapide à propos de la dernière «manière» de Marie-Claire Blais, mais bien un changement de ton, en résonance avec le bouleversement infini du monde contemporain. Le pluralisme exacerbé qui se manifeste dans les romans choraux qui marquent cette nouvelle «manière» a peu à voir avec les romans antérieurs: le centre de gravité de l’œuvre a basculé, de sorte qu’on ne peut plus parler de Marie-Claire Blais seulement en faisant référence à l’époque de La belle Bête et d’Une saison. Son œuvre appartient aussi à l’époque contemporaine, aux années 2000. C’est même là ce qui la distingue parmi les œuvres les plus emblématiques de cette période. De tous les romanciers de la Révolution tranquille, je parle de ceux qui, à l’instar de l’auteure d’Une saison, ont été spontanément identifiés aux années 1960, les Gérard Bessette, Réjean Ducharme, Hubert Aquin, Jacques Godbout ou Jacques Ferron, mais aussi les André Major, Gilles Archambault, et même Victor-Lévy Beaulieu ou Jacques Poulin, qui commencent à publier à la fin de cette décennie, de tous ces romanciers qui participent à l’essor du roman québécois moderne, seule Marie-Claire Blais s’identifie avec autant de passion au monde d’aujourd’hui, seule Marie-Claire Blais semble notre exacte contemporaine.
Je ne veux pas dire par là qu’elle a rompu sciemment avec la manière d’écrire qui était la sienne à l’époque d’Une saison. Au contraire, je crois qu’il y a une réelle continuité du style et de la voix à travers toute son œuvre, même si tout semble opposer le réalisme bref d’Une saison et le lyrisme épique du cycle commencé en 1995 avec Soifs. Dès le premier paragraphe d’Une saison, la phrase veut prendre son élan, se ramifier par des parenthèses incongrues qui font dialoguer par exemple la voix de la romancière et celle du vieux discours canadien-français. Lorsque le lecteur découvre les pieds colossaux de Grand-Mère Antoinette à travers le regard innocent du bébé couché au sol, l’arrière-plan social surgit aussitôt, trouant le texte de parenthèses qui ont l’air d’apartés murmurés par un chœur dissimulé quelque part dans la maison: «des pieds nobles et pieux (n’allaient-ils pas à l’église chaque matin en hiver?) des pieds vivants qui gravaient pour toujours dans la mémoire de ceux qui les voyaient une seule fois – l’image sombre de l’autorité et de la patience» (US, 7). On retrouvera dans Soifs le même procédé dialogique, les mêmes fausses interrogations, cette sorte de style direct libre où se mêlent le point de vue du personnage singulier et le point de vue de la collectivité à laquelle il appartient. Mais dans Une saison, Marie-Claire Blais se retient, elle ne lâche pas la bride à l’écriture, elle s’interdit l’envolée lyrique, elle revient à des considérations factuelles, elle coupe court: «Né sans bruit un matin d’hiver, Emmanuel écoutait la voix de sa grand-mère» (US, 7). Elle a peut-être à l’esprit le conseil du critique Edmund Wilson, qui lui avait dit: «Il faut que ce soit plus serré. […] Resserrez davantage, le flot n’est pas assez dirigé.» Inutile de dire qu’elle ne respectera pas longtemps ce mot d’ordre: le cycle de Soifs compte aujourd’hui dix tomes et fait deux mille neuf cent trente et une pages! Toute cette œuvre vise au contraire à desserrer la phrase, à l’amplifier jusqu’à en faire un chant choral qui embrasse toutes les misères du monde.
À l’époque de Jean Le Maigre, nous n’en sommes pas encore là. Les personnages...