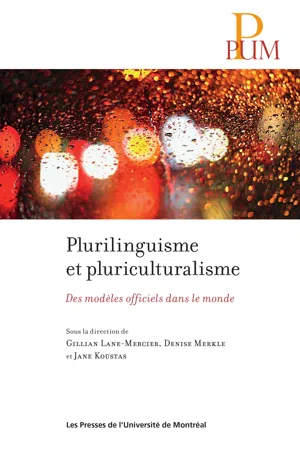![]()
1. Les politiques en matière
de traduction en Belgique
de 1830 à 1914
Lieven D’hulst, Marie Bourguignon, Koen Lemmens,
Bieke Nouws, Heleen Van Gerwen et Reine Meylaerts
Tout au long du XIXe siècle, les processus européens de démocratisation ont été accompagnés d’efforts de politisation de l’usage des langues et des relations entre celles-ci. L’action légale, politique et sociale des citoyens dépendait de ses ressources communicatives. Or celles-ci se cantonnaient à l’usage d’une langue partagée, dite nationale, qui assurait le relais entre les citoyens et les autorités et permettait aux citoyens d’exercer leur droit de contrôle sur les autorités. La maîtrise de la langue nationale donnait en outre accès aux documents officiels, et notamment aux textes de loi. De plus, cette langue était censée porter, voire enrichir des sentiments d’appartenance et d’identité nationales.
Comme d’autres formations géopolitiques, la Belgique a dès sa naissance officielle accrédité cette logique nationale, le français étant d’un seul tenant adopté comme langue officielle du nouvel État. Le premier gouvernement belge s’engagea fermement à supprimer graduellement le néerlandais. À cette fin, il s’est évertué à conférer tous les emplois civils et militaires à des francophones, voulant ainsi inciter les néerlandophones à apprendre le français. En d’autres mots, les autorités belges, au même titre que celles de bien d’autres États européens, ont rapidement pris conscience de l’importance des politiques linguistiques. Ces dernières peuvent être définies de plusieurs manières; selon Spolsky (2012), elles se composent de trois éléments: (1) les pratiques langagières, (2) les croyances ou idéologies langagières et (3) les régulations langagières, l’interrelation de ces trois éléments étant confirmée par le fait que l’effectivité de la régulation linguistique tient à son adéquation avec des pratiques parfois conflictuelles et avec des croyances quelquefois fluctuantes. Aussi la réussite de cette adéquation est-elle un enjeu crucial pour les autorités démocratiques, car elle conditionne la communication réciproque entre le centre politique et la communauté linguistique qui en dépend.
Pourtant, l’idéal démocratique d’une langue pour une communauté dans un État-nation était et continue d’être une utopie. La Belgique de 1830, en l’occurrence, donne à voir plusieurs communautés culturelles, qui sont au surplus multilingues. Face à des croyances langagières hétérogènes sinon opposées, ces communautés sollicitent des régulations langagières qui sont ajustées à leurs besoins ou à des attentes spécifiques et qui sont censées en particulier refléter, au sein de l’État, leur différence par rapport à d’autres groupes. Pour cette raison, les politiques linguistiques sont indissociables des questions de citoyenneté et notamment de la question d’une participation politique égale des différentes communautés linguistiques. En raison du fossé existant entre l’idéal monolingue des autorités et les réalités multilingues sur le terrain, les politiques linguistiques doivent nécessairement inclure des choix à propos de l’emploi (ou non) de procédures de médiation entre les langues, comme la traduction, à côté d’autres modalités de transfert interlingual. Ces choix engendrent des politiques de traduction spécifiques. Autrement dit, toute politique linguistique implique une politique de traduction.
Le concept de «traduction», s’il est utilisé sans autre explication, renvoie toujours tant à la traduction qu’à l’interprétation sous n’importe quelle forme, même si de toute évidence, la traduction ne concerne que des rapports écrits. Suivant le modèle de Spolsky, nous analysons les politiques de traduction sous trois angles: la régulation, les pratiques, et les croyances ou idéologies de la traduction. Le terme de «régulation» s’applique à l’ensemble des efforts légaux entrepris par les autorités pour initier, imposer ou interdire des pratiques de traduction et de transfert. Ces dernières comprennent l’ensemble des activités interlinguales assurant la communication entre les autorités et les citoyens. Quant aux croyances ou idéologies de la traduction, elles désignent les valeurs attribuées par les membres d’un groupe linguistique à la traduction et l’importance attachée à ces valeurs. À l’instar de ce que donnent à voir les politiques linguistiques, la relation dialectique entre les trois composantes conditionne l’effectivité des politiques de traduction: la régulation doit dès lors être en adéquation avec les pratiques et avec les croyances.
Par ailleurs, et à part quelques approches généralisatrices et quelques études de cas isolées, la théorie et l’histoire des politiques de traduction n’en sont qu’à leurs débuts. En effet, la vaste majorité des études historiques se concentrent sur la traduction littéraire, philosophique et religieuse, laissant de côté d’importants pans de la production traduite, en particulier la «littérature grise», c’est-à-dire la masse de textes qui échappent au contrôle des éditeurs commerciaux: il s’agit notamment des textes ordonnés, conçus, rédigés, traduits et diffusés à tous les échelons de gouvernance, tels les affiches, prospectus, rapports, instructions, notes. On peut qualifier ces traductions d’institutionnelles, car elles sont un vecteur essentiel des échanges discursifs entre les autorités et leurs audiences hétérolingues. Pourtant, malgré leurs fonctions sociales, culturelles et politiques, ces sortes de traductions n’ont guère encore retenu l’attention des chercheurs.
Parallèlement, on compte de nombreuses études théoriques et historiques s’intéressant aux idéologies langagières, parmi lesquelles on citera les travaux fondateurs de Blommaert (p. ex. Language Ideological Debates, 1999). Une fois encore, cependant, la traduction fait figure de parent pauvre lorsqu’il s’agit de rendre compte de la production et des modalités de reproduction historique des idéologies langagières.
Finalement, bien qu’il y ait une dimension politique sous-jacente à toute traduction – et que cette dimension soit prégnante dans des zones multilingues où les langues et les cultures ne coexistent jamais à l’état de partenaires égaux (Even-Zohar, 2005) –, l’histoire de cette dimension brosse certes des tableaux détaillés de la législation linguistique et des conflits entre les langues, mais elle s’attarde à peine à la traduction. En ce qui concerne la Belgique, force est de reconnaître que la lutte pour l’usage du néerlandais dans les affaires administratives et judiciaires a donné lieu à une série impressionnante de travaux savants écrits par des historiens du droit et des langues. Mais ces travaux portent en priorité sur l’emploi des langues dans la législation (voir Heirbaut et Baeteman, 2004; Van Dievoet, 2003; Clement, 2003) et dans l’administration judiciaire (voir Van Goethem, 1990). Manquent, en revanche, des études sur les procédés de médiation interlinguale nés de la confrontation entre la culture légale francophone dominante et les revendications en faveur d’un usage accru du néerlandais en matière légale et administrative. Pareil silence est d’autant plus étonnant que, depuis la naissance de la Belgique en 1830 et au long du XIXe siècle, les questionnements sur les politiques de traduction préoccupent constamment (ne serait-ce qu’implicitement) les autorités administratives et gouvernementales de tous niveaux. Les questions parlementaires, les pétitions et débats, la législation centrale, la réglementation provinciale et communale, les discussions des conseils (provinciaux) et les procès-verbaux de leurs réunions, les jugements, les documents issus d’administrations centrales et locales, forment un corpus d’une richesse insoupçonnée pour qui veut s’interroger sur la manière dont les autorités tentent d’engager un dialogue interlingual avec des groupes et citoyens multilingues.
Somme toute, de nombreuses interrogations concernant les trois principaux aspects des politiques de traduction en Belgique demeurent à ce jour sans réponse. Quant à la régulation de la traduction, c’est-à-dire des initiatives prises par les autorités en vue de la conception, de l’institutionnalisation et du contrôle de la traduction, souvent en intime corrélation avec la régulation linguistique, elle soulève les questions suivantes: quel est le statut légal de la traduction? Évolue-t-il? Existe-t-il des lois qui imposent la traduction ou faut-il plutôt poser l’hypothèse d’un cadre législatif implicite, d’un espace légal autorisant ou favorisant la création d’une communication interlinguale faite d’une variété de modalités de transfert (la traduction, mais également l’usage de résumés, de paraphrases, de commentaires, etc.)?
En second lieu, citons les questions suscitées par les pratiques de traduction et de transfert proprement dites qui peuvent résulter non seulement de la régulation en matière de traduction, mais aussi d’initiatives privées. Quels sont les documents belges officiels traduits et comment s’effectue cette traduction? Qu’en est-il de l’évolution des techniques de traduction? Dans quelle mesure la pratique en matière de traduction se rapporte-t-elle aux prescriptions légales? Dans quelles circonstances d’autres processus de transfert (résumé, paraphrase, explication) remplacent-ils la traduction proprement dite?
Enfin, les croyances ou les idéologies traductives adoptées par les groupes monolingues et multilingues en Belgique, ainsi que les liens entre ces croyances et les pratiques réelles de traduction et de transfert, suscitent à leur tour une série de questions. Dans quelle mesure les croyances s’adaptent-elles à l’évolution législative et aux pratiques de traduction? Quels sont les arguments et stéréotypes forgés au cours des discussions sur la traduction et le transfert, sur leurs formes et leur opportunité? Quelles informations ces discours nous fournissent-ils à propos de questions connexes liées à la démocratie, à la citoyenneté, à la construction de la nation et aux droits linguistiques et humains en général?
Nos recherches couvrent le long XIXe siècle, période allant de 1830 (la naissance de l’État-nation requérant un nouveau système légal) aux débuts de la Première Guerre mondiale (1914 étant du reste l’année où une loi autorisant l’emploi du néerlandais comme langue d’enseignement dans les écoles primaires est votée). Nous nous concentrons sur les domaines législatif, administratif et judiciaire (inférieur), domaines où la communication entre les autorités et les citoyens s’effectue couramment au moyen tant de la traduction que d’autres modes de transfert. Une telle approche permet non seulement de détailler les relations entre les trois aspects des politiques de traduction, mais elle dénoue également la complexité de chaque aspect et révèle les tensions et les compromis entre les espaces centraux et locaux des politiques de traduction. Finalement, nous cherchons à mieux comprendre le rôle joué par les politiques de traduction dans la construction d’une citoyenneté multilingue (ou dans l’échec de cette construction).
La régulation de la traduction
L’étude de la régulation des traductions s’attache à la conception légale et à l’institutionnalisation des traductions et des transferts interlinguistiques. Loin de se laisser réduire à un corps uniforme de règles claires, explicites et communément applicables, la régulation se décline en plusieurs éléments et adopte différentes formes, en fonction du type d’institution auquel elle se rapporte. Nous l’étudions d’un double point de vue: central et local.
Au niveau central, la régulation est principalement composée de quatre éléments. En premier lieu, elle s’applique aux instances politiques, légales et administratives qui conçoivent les règles. Il s’agit des politiciens, des juristes, des magistrats, c’est-à-dire de ceux qui dirigent le processus législatif en matière de traduction, qui établissent le statut légal des textes traduits, qui stipulent les conditions d’une traduction des textes officiels du français vers le néerlandais, qui définissent les textes légaux et administratifs requérant une traduction et qui désignent les publics visés en priorité par les traductions. Ainsi, il y a lieu de s’attendre à un recours à la traduction plus systématique en matière légale qu’en matière administrative, où le transfert de textes de moindre diffusion entre l’autorité centrale et les autorités locales s’accomplit à l’aide d’une langue unique, mais supposée partagée.
Ensuite, la régulation a trait aux traducteurs eux-mêmes, c’est-à-dire à leur recrutement, à leur statut administratif et à l’exercice de traduction (ainsi qu’à l’évaluation et au contrôle de celui-ci); elle concerne également les organisations professionnelles et les réseaux dont ils font partie. Il est essentiel de reconstruire le profil des traducteurs, même lorsque ceux-ci ne sont pas officiellement nommés comme tels, puisque ce profil exprime aussi l’attitude des autorités envers la traduction.
Troisièmement, il s’agit de reconstituer les règles légales proprement dites en matière de traduction, leur impact sur le statut de la traduction, ainsi que les régulations nées des débats parlementaires et des projets de loi concernant l’emploi des langues, plus particulièrement celui du néerlandais. Sur ce point, on citerait sans peine quelques dates importantes, telles les années 1874 (concernant l’emploi du néerlandais dans les procès pénaux), 1878 (marquant l’emploi du néerlandais dans les matières administratives), 1888 (date du premier discours en néerlandais à la Chambre) et 1891 (à propos de l’emploi du néerlandais à la cour d’appel). Cependant, de telles dates et faits certes majeurs de la seconde moitié du siècle ne doivent pas nous faire oublier la présence durable de régulations concernant la traduction proprement dite. Dès 1831, plusieurs dispositions légales autorisent la traduction de lois et de décrets dans les communes où le néerlandais est utilisé. Les débats parlementaires et les projets concernant ces dispositions rendent compte de la genèse, des formes concrètes et des idées sur les fonctions attachées aux traductions. En outre, ces documents éclairent la manière dont les questions linguistiques sont traitées dans les systèmes légaux de cultures voisines, plus particulièrement en France, et aident ainsi à comprendre les stratégies d’adoption ou d’adaptation de modèles étrangers en Belgique.
Enfin, les institutions légales qui rédigent les traductions (ou les rejettent), c’est-à-dire la Chambre, le Sénat et le ministère de la Justice, font également l’objet d’une régulation. Les administrations de ces organes appliquent probablement différentes procédures en matière de traduction légale (Gagnon, 2006), à l’instar des procédures relatives à l’usage des langues (Doms, 1965). Ces institutions se sentent-elles concernées par la valeur légale des traductions? D’autres formes de traductions, telles que des traductions privées ou des adaptations, sont-elles également utilisées, tolérées ou rejetées?
À l’échelle locale, nous analysons les réglementations appliquées par les administrations des conseils communaux et des juridictions inférieures. On peut avancer l’hypothèse que ces institutions adoptent les réglementations centrales en les adaptant à l’échelle locale. Étant plus proches des citoyens, elles se font l’écho de l’attitude et des attentes de ces derniers à l’égard de l’usage des langues et des traductions. Néanmoins, il est peu probable que ces réglementations nous informent sur l’identité des décideurs ou sur celle des traducteurs et qu’elles nous aident à répondre aux questions ayant trait aux actions concrètes prises pour encourager la traduction de documents d’un genre particulier ou s’adressant à des récepteurs spécifiques. Il ne fait nul doute que de telles questions sont rarement formulées à l’époque. Cela étant, même si les institutions locales dépendent de la réglementation centrale, elles ne cherchent pas moins à trouver des solutions pragmatiques aux sollicitations quelquefois urgentes qui leur sont adressées au quotidien. Par conséquent, les conclusions tirées de l’étude de ces réglementations devront nécessairement être confrontées par la suite aux pratiques discursives et donc à l’analyse des traductions proprement dites (voir infra).
Voyons de plus près les administrations: nous analysons plus particulièrement les débats et les décisions en matière de traduction et de transfert tels qu’ils ont cours dans les conseils municipaux de trois villes: Anvers (ville néerlandophone, qui se positionne historiquement à l’avant-plan de la lutte pour l’émancipation linguistique, bien qu’une élite francophone y réside), Liège (ville francophone, mais comptant une minorité de résidents flamands) et Landen (ville située sur la frontière linguistique). Ces trois entités représentent des configurations interlinguales typiques de la Belgique du XIXe siècle.
Au niveau des juridictions inférieures, nous privilégions les débats et décisions ayant trait à la traduction et au transfert au sein des justices de paix des trois villes citées. Le choix de ce type de juridiction se fonde pour l’essentiel sur deux raisons. Premièrement, la justice de paix est l’organe juridictionnel le plus proche du citoyen, mettant par conséquent en œuvre des procédures juridiques informelles. Ainsi, même si les procédures monolingues (en français) y sont de mise, les acteurs ont également recours à des traductions informelles et à d’autres modalités de transfert. Deuxièmement, les historiens ont à ce jour prêté peu d’attention à cette juridiction, préférant se pencher sur le fonctionnement et les travaux des cours supérieures (Nandrin, 1998).
La comparaison des régulations centrales et des régulations locales révélera un ensemble de courroies de transmission qui relaient le monolinguisme et le bilinguisme et qui comprennent donc des formes ou des étapes intermédiaires comme la t...