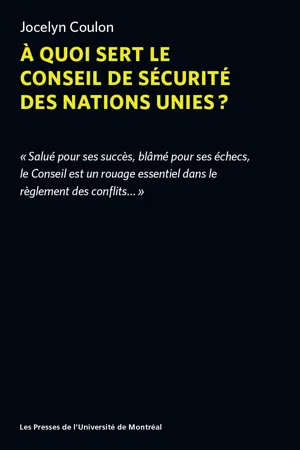![]()
Les Casques bleus
Les opérations de maintien de la paix (OMP), plus connues sous le vocable de missions de Casques bleus, sont devenues avec le temps la marque de commerce de l’ONU sur la scène internationale. Elles pallient l’incapacité de l’organisation à mettre en œuvre son mécanisme de sécurité collective prévu par la Charte avec la création d’une «armée» de l’ONU. Cette paralysie, essentiellement due au refus des grandes puissances de doter l’organisation d’un tel outil, a poussé les diplomates à faire preuve de créativité pour que s’accomplisse la mission principale de l’Organisation.
Une action conforme au «chapitre VI et demi»
Les OMP n’étant pas prévues par la Charte, l’ONU a dû innover en s’inspirant des dispositions contenues dans les chapitres VI et VII de la Charte pour créer un moyen nouveau et pragmatique de gestion des conflits, ainsi stipulé dans le virtuel «chapitre VI et demi». La première guerre israélo-arabe de 1948 a été l’une des premières crises que l’ONU a dû affronter. Pour la première fois, les membres de l’organisation mettaient à la disposition de cette dernière un personnel non armé pour tenir le rôle d’observateur sur place après la signature d’un cessez-le-feu entre les belligérants. Cette mission d’observation, qui se poursuit encore aujourd’hui dans cinq pays du Proche-Orient, est considérée comme la première opération de maintien de la paix. Une autre suivra en 1949, qui surveillera le cessez-le-feu entre l’Inde et le Pakistan à la suite d’un affrontement au sujet du Cachemire. Elle aussi demeure en cours.
À quelques exceptions près, toutes les OMP ont été créées par le Conseil de sécurité en vertu de ses pouvoirs et conformément à sa responsabilité principale en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales. Paradoxalement, c’est l’Assemblée générale qui, en 1956, va créer la première force d’interposition entre belligérants lors de la crise de Suez. À l’époque, le Conseil était paralysé par le veto de la France et du Royaume-Uni eux-mêmes directement engagés dans la crise. Les membres de l’ONU ont alors utilisé la résolution Union pour le maintien de la paix et transféré la question à l’Assemblée. C’est à cette occasion que le Canadien Lester B. Pearson a proposé le déploiement de Casques bleus, militaires armés, afin de les distinguer des bérets bleus non armés des forces d’observation.
La crise de Suez a été l’occasion pour l’ONU d’établir les règles présidant à la constitution, au déploiement et au fonctionnement d’une OMP sur un théâtre d’opérations. Une OMP n’est pas une mission menée par les États membres pour le compte de l’ONU, comme ce fut le cas en 1991 en Irak. Sous commandement de l’ONU, elle relève directement du secrétaire général et du Conseil. L’OMP est déployée avec le consentement des parties, elle implique une stricte impartialité dans les rapports avec les belligérants et le recours à la force n’est autorisé qu’en cas de légitime défense. Même si, au cours des années, il y a eu des exceptions dans l’application de ces trois principes, ceux-ci n’en constituent pas moins le socle sur lequel s’est bâtie toute la politique de maintien de la paix de l’ONU.
Après Suez, le Conseil a rapidement repris la main: ce sont ses membres qui pilotent les OMP onusiennes, de la première à la dernière étape. Lorsqu’une crise éclate, le Conseil est saisi de la question et ses membres débattent de la situation. Ce sont eux qui décident d’y voir ou non une menace à la paix et à la sécurité internationales. Advenant le cas, ils examinent les moyens pour y faire face et l’OMP est un de ces moyens. La création d’une OMP suit un chemin bien balisé, calibré depuis plus de soixante ans. Les membres du Conseil ont pour tâche de rédiger la résolution qui créera l’opération et la dotera d’un mandat. Ce processus fait l’objet de longues négociations qui s’avèrent parfois difficiles. Les rédacteurs de la résolution, souvent les grandes puissances occidentales, ont tendance à vouloir y insérer des éléments qui favorisent leurs intérêts. Il faut alors toute la finesse et la vivacité d’esprit des autres membres, particulièrement les non permanents, pour éviter les écueils et protéger les grands principes au cœur des OMP. Si les petits États membres, sans moyens diplomatiques et matériels, se montrent très discrets, il revient aux membres non permanents d’importance moyenne, comme le Canada, l’Allemagne ou la Turquie, de jouer du coude et de contrer, parfois avec succès, les ambitions des plus forts.
Le projet de résolution est aussi discuté avec le secrétariat et le Département des opérations de maintien de la paix. Le Conseil sollicite leurs idées et leur expertise. Les contributeurs de troupes recrutés parmi les membres de l’ONU sont également consultés dans la perspective d’une participation. Ces étapes franchies, le Conseil passe au vote pour l’adoption de la résolution, et c’est ainsi qu’est créée l’opération. Elle doit ensuite être dotée d’une équipe dirigeante, habituellement composée d’un représentant spécial du secrétaire général, qui dirige l’ensemble de l’OMP, d’un commandant de la force militaire dont l’autorité s’étend à tous les contingents prêtés par les États, d’un commissaire de police, et, parfois, d’adjoints au représentant spécial. Là aussi, sans avoir l’air d’y toucher, le Conseil agit.
Le Conseil reste maître de l’opération en la prolongeant, en y mettant fin ou en modifiant à sa guise son mandat. Son appui doit être constant et permanent pour assurer le succès de l’entreprise. Mais les membres du Conseil se montrent parfois capricieux et cruels. Ainsi, en 1999, la Chine a empêché le renouvellement de l’opération de paix en Macédoine parce que ce pays avait décidé de nouer des liens diplomatiques avec Taïwan. Quelques mois plus tard, la violence a éclaté dans le pays et c’est finalement une intervention de l’OTAN qui a rétabli la paix.
Compte tenu de la complexité croissante de chaque situation, les membres du Conseil prennent un soin particulier à définir avec le plus de précision possible les mandats des OMP. Il y a trente ans, ces descriptions tenaient sur une page ou deux. Depuis la création d’opérations de paix multidimensionnelles, le Conseil produit des résolutions de quinze à vingt pages au contenu très détaillé. C’est que l’environnement international a changé depuis la fin de la guerre froide. Par le passé, les OMP, à quelques exceptions près, étaient des missions militaires dans le cadre desquelles les Casques bleus déployés avaient pour mandat de faire respecter un cessez-le-feu et de patrouiller dans une zone tampon. À cela pouvaient s’ajouter des activités ancrées dans le contexte local, comme construire des écoles ou des ponts, protéger des réfugiés et, plus rarement, surveiller le déroulement d’une consultation électorale.
Depuis la fin de la guerre froide, et devant la volonté affichée de la communauté internationale d’intervenir pour stopper un conflit, reconstruire un État ou sauver un peuple menacé d’extermination, le mandat des OMP n’a cessé de s’étoffer. Aux tâches traditionnelles de surveillance des accords de paix et de patrouilles militaires, le Conseil a ajouté des volets de reconstruction politique, sociale, économique, culturelle et étatique. Si de telles actions à grande échelle sont entreprises sur un territoire, c’est pour la simple raison que les conflits d’aujourd’hui découlent souvent de l’effondrement partiel ou total des structures étatiques. Les OMP actuellement déployées au Mali, au Congo démocratique, au Soudan du Sud et en République centrafricaine ne mobilisent plus comme avant 1000 Casques bleus, mais plutôt entre 10 000 et 25 000 militaires et policiers civils, en plus d’un vaste personnel civil qui prend part à diverses activités allant de la mise sur pied d’une banque centrale, de services de police et d’institutions liées à l’État de droit à la création de médias démocratiques et à la tenue d’élections. Certaines opérations accueillent même des forces spéciales destinées à entreprendre des missions de sécurité à haut risque. Enfin, à l’instar de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL), d’autres opérations mobilisent un armement lourd (chars de combat, missiles antiaériens, composante navale…) et se déroulent selon des règles d’engagement renforcées, qui n’ont plus rien à voir avec les premières opérations dites classiques de l’ONU.
Pour alléger la charge de plus en plus lourde imposée à cette dernière, les organisations régionales et sous-régionales s’impliquent dans le maintien de la paix. Elles lancent des opérations ou prennent le relais lorsque l’ONU se retire. Il arrive aussi qu’elles travaillent en complémentarité avec les Casques bleus. Le chapitre VIII de la Charte autorise ces organisations à entreprendre des OMP avec l’aval du Conseil. Depuis le début des années quatre-vingt-dix, l’OTAN, l’Union européenne, l’Union africaine et une dizaine d’autres organisations se sont engagées dans ce type d’opérations. Elles en tirent des bénéfices politiques et une légitimité accrue auprès de leurs membres. Et leur présence est de plus en plus i...