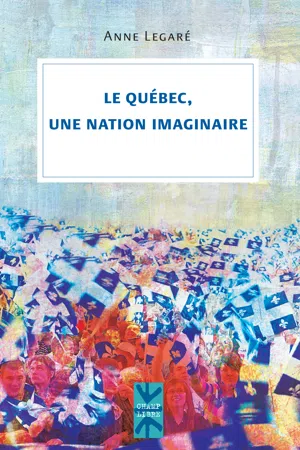![]()
PREMIÈRE PARTIE
LES CONDITIONS
STRUCTURELLES
DE L’IDENTITÉ
![]()
CHAPITRE 1
Le fédéralisme et la Nation
Dans l’inconscient d’un grand nombre de Québécois sommeille le sentiment de ne pas être pleinement à sa place. Cette impression de refoulement, de tassement sur une parcelle immense, envahie par la logique adverse est, bien sûr, ressentie par cette partie des Québécois qui sont d’ascendance canadienne-française. Les Québécois arrivés ici au cours des cinq dernières décennies ne peuvent avoir, eux, ce sentiment de déplacement, puisqu’ils éprouvent celui de leurs origines propres et qu’on les incite à croire que ce nouveau pays, que ce soit le Québec ou le Canada, sera le leur, et que ses habitants partageront avec eux des valeurs d’égalité et d’unité. Mais les Québécois d’ascendance canadienne-française, noyau dur de la nouvelle identité, je les appellerai aussi les Québécois (et non pas les Canadiens français, la «majorité historique» ou les «de souche»), tout simplement parce qu’avec les autres ils forment ce tout, cet ensemble, ce vouloir-vivre-ensemble qui devrait définir toute la nation.
![]()
Ne pas se sentir chez soi
À la base du raisonnement que j’expose ici, il y a une formation historique issue du long terme, les Québécois d’origine, et qui, pour cette raison, résiste depuis longtemps à toute assimilation à une province ou à une région canadienne comme les autres. Les Québécois ont l’impression de ne pas être pleinement chez eux, et ce, depuis la Conquête. Ils se sont constamment battus pour corriger ce sentiment, mais sans trop de succès. Ils sont en fait dépossédés d’une représentation d’eux-mêmes comme dépositaires du sens que devrait leur donner leur propre histoire. Or, leur territoire est investi par un quadrillage institutionnel, étatique, qui leur est venu d’ailleurs. Toute l’histoire du peuple fondateur de souche française est celle d’un peuple démis. Ce peuple, vivant sur le territoire qu’il défrichait, dans la langue qui était sienne et dans la culture qu’il fabriquait, voyait sous ses yeux le conquérant prendre sa place ou lui rendre difficile, sinon impossible, de la prendre pleinement. Les institutions, qui auraient dû être les siennes d’abord, parlementaires, militaires, commerciales, soit les règles du jeu collectif, furent brimées par l’empire et l’emprise de l’Anglais, puis par celle du Canadian. Lorsque l’Anglais se dit Québécois, il le dit de manière canadienne. Le Canadien français de l’époque, le Québécois d’aujourd’hui, ne se sent pas pleinement chez lui dans ce pays conquis. Il est encore moins chez lui dans un Canada faussement bilingue.
Tout est là: le fondement de ses appréhensions, de ses doutes sur lui-même, de ses malaises, de ses rebuffades comme de ses élans pour en sortir: le Québécois n’est chez lui sur son propre territoire que dans une lointaine réminiscence. Certains, on dirait même la plupart, essaient de s’en accommoder alors que d’autres, plus déterminés, armés de la même combativité que leurs ancêtres les patriotes, tentent d’y construire une société nouvelle que leur propre peuple définirait à la fois par un socle commun de résidence, un peuple à la fois de souche et de commune adhésion.
Mais d’autres encore tentent de faire leur le Canada, comme s’ils croyaient arriver, enfin, à faire ployer le nombre et la puissance de l’autre afin d’être traités différemment, tout en adhérant à une commune identité, canadienne. Ils sont en même temps Québécois par leur lieu de résidence et le partage d’une culture et d’une langue régionales, et Canadiens par leur adhésion à un double régime politique. C’est le cas des réformistes, des fédéralistes, des croyants au «beau risque», de ceux qui sont restés indemnes, extérieurs au combat acharné et intérieur de leurs compatriotes. Car il y a bien une position d’extériorité dans celle de ceux qui, frayant avec l’adversaire (car l’Anglais ne leur a jamais fait de concession amicale), croient dans le projet d’une fédération (d’une confédération) conviviale qui combinerait dans une juste égalité leur part et celles des autres, leur quart avec les trois autres. Une extériorité par rapport à un mal refoulé, un oubli de soi.
L’appartenance est une question délicate. Elle a fait couler beaucoup d’encre. Chacun définit son nid comme il l’entend mais un trait commun demeure: il y a toujours dans l’histoire humaine une forme d’appartenance. La philosophe Barbara Cassin, citant Ulysse, le dit bien: «le héros homérique est enfin “chez lui” [et retrouve] son lit enraciné, creusé de ses mains dans un olivier autour duquel il a construit sa maison». C’est là que se noue et se dénoue le mystère qui présidera à tous les choix politiques. Je tenterai d’approfondir les processus par lesquels une partie des Québécois se laisse prendre dans une identité clivée, c’est-à-dire une identité qui confirme sa dépossession en lui substituant un sentiment d’appropriation du Canada, alors qu’une autre partie est éprise du combat qui la rendrait maîtresse chez elle.
Une double appartenance
À quels socles d’appartenance les Québécois se rattachent-ils? L’histoire des habitants de Nouvelle-France a fait qu’un noyau dur, des colons d’origine française, a adhéré à l’identité du sol et de la race, au territoire de colonisation par l’Anglais et d’origine que j’appellerai la souche canadienne-française. Puis vint la Conquête: un groupe s’élargissant a alors adhéré au mélange des identités, à une binationalité qui s’est affirmée peu à peu. Louis-Hippolyte Lafontaine en a donné le ton en 1840 avec l’Acte pour unir les Provinces du Haut et du Bas-Canada et pour le Gouvernement du Canada, du nom donné par le Parlement de Londres pour désigner l’Acte d’Union. Reconnaissant qu’il y avait eu conquête et imposition du plus fort, il se soumettait à la recherche d’un compromis, d’un pis-aller qui ferait une meilleure place à la colonie dans un effort d’union à deux têtes. La voie du compromis était tracée, inévitable alors, qui ralliait une majorité de conquis, lesquels selon certains le resteraient sous des formes améliorées. Suivi des Wilfrid Laurier ou des Louis St-Laurent, Lafontaine — avec Étienne Parent et d’autres — a tracé une voie dans laquelle plusieurs (une majorité?) se sont engouffrés par la suite. Chez eux, le sentiment de dépossession a fait place à l’effort (à l’illusion?) d’appropriation du Canada. Le Canada a ainsi pénétré dans les consciences. Le Québec est devenu à la fois un réservoir d’enracinés habités par un sentiment de perte, de dépossession, et un espace de mitigation où le conquis cherche encore sa place grâce aux habiletés de plus fort que lui. Le Québécois ne possède pas son pays («mon pays c’est l’hiver»). Mais comme objectait ma mère: «J’en ai un pays, c’est le Canada!» Chez plusieurs, cet espace s’est substitué au premier.
On peut prendre ce processus par plusieurs côtés. J’ai nommé le Canadien français, le colon de souche française, dépossédé dans son âme, nostalgique du pays qu’il n’a jamais eu, lui qui court les campagnes québécoises et y cherche encore son lieu propre, que ce soit au nom d’un conservatisme local ou national ou d’une rengaine réparatrice. À côté, il y a celui qui s’obstine à trouver sa place dans une autoconquête, une refondation de son espace propre, une affirmation de souveraineté devenue celle du peuple avant d’être celle d’un État neuf. Puis il y a enfin celui qui se moule à un Canada à deux paliers, à deux appartenances, au dédoublement continu. Celui-là, il vote deux fois, une fois pour lui-même et une fois pour l’autre. C’est l’État qui constitue ce qu’il est par consentement.
Cette appartenance à la marge, à une marge qui étreint, dans une tentative d’appropriation du vaste Canada, est devenue une seconde nature vécue dans l’oubli de soi et dans l’oubli de l’autre, le binational, le Canadien, tant sa formule réussit à se calquer sur le double — double Parlement, double État, double identité, double de soi-même. Dans la logique des trois lieux d’appartenance où se forme l’identité québécoise, le premier et le second — le Québec, qui se donne comme dépossession d’un côté et désir de refondation de l’autre —, parfois se recoupent. En effet, ceux qui partagent un fort sentiment de dépossession peuvent adhérer à un désir de refonder en un nouveau pays le lieu d’appartenance. Il arrive aussi que le premier s’illusionne en fusionnant par moments avec le tiers. Dans ce cas, toujours la marque du double étend ses doigts habiles et fractionne l’identité en double appartenance, sentiment de dépossession à la base et désir d’appropriation comme soulagement de la blessure. L’inconscience caractérise cette lente habitude de se voir unis dans le Canada, comme d’éternels visiteurs d’un lieu qui ne nous appartient pas, mais dont la désertion est compensée par l’immersion dans un soi électoral, une reprise en mains par un discours aux apparences de passion sur une identité parcellaire.
Le jour où l’Anglais s’est mis en tête de nous aider, de nous attirer dans son giron mi-britannique mi-canadien, de faire de nous ses affidés, nous nous engagions sur ce chemin qui menait à la perte de nous-mêmes. Il est encore temps. Nous ne sommes pas tout à fait conquis. Il suffit d’acquérir une connaissance plus grande de soi-même pour atteindre la pleine conscience de soi.
Je me suis crue canadienne
Comme je l’ai déjà dit, je suis née dans une famille d’adhésion fédérale. De cette adhésion selon laquelle le Canadien français est minorisé. Comme mon père, je me suis même crue Canadienne. Ce fut l’identité de mes vingt ans que j’ai gardée jusqu’à l’époque de la Commission Bélanger-Campeau, vers 1989, du noble nom de Commission sur l’avenir politique et constitutionnel du Québec. Les débats qui ont entouré cette commission, jusqu’en 1991, m’ont ouvert les yeux. J’avais alors publié mon troisième ouvrage, La société distincte de l’État. Québec-Canada, 1930-1980 (en collaboration avec Nicole Morf et paru chez l’éditeur Hurtubise HMH en 1989).
Mon père se disait et se sentait canadien. Je me souviens de l’avoir entendu dire un jour: «la politique provinciale, c’est de la petite politique». Il avait créé la Chambre de commerce des jeunes de Rimouski et en tant que son président, puis comme président de l’Association des hebdomadaires de langue française, il parcourait le Canada, qui était encore son pays de référence. À cette époque, qui précédait la Révolution tranquille, l’identification à une province pas comme les autres n’était pas encore le principal thème du jour. Mon père acceptait de dire que les Canadiens français étaient dominés au sein du Canada. Justement, il allait au Parlement fédéral pour y faire entendre la voix de ceux qui ne voulaient pas s’en satisfaire. Noble intention. Auprès de Louis St-Laurent puis de Lester B. Pearson, il croyait au Canada des «deux nations fondatrices» qui finiraient par être vraiment égalitaires. Comme Lafontaine, il croyait à la nécessité de réformer le Canada pour que l’allégeance des Canadiens français y soit reconnue. Il n’y avait pas d’autre choix; le Canada a toujours suscité pour les Québécois, depuis la Conquête, une tentative d’appropriation.
Toute l’histoire des Québécois depuis la Conquête est marquée par ce surmoi qui croit obtenir mieux à Ottawa et y rendre justice à sa différence. Oui, l’adhésion se donne aussi comme une affaire de conscience. Je ne souhaite pas juger celle de ceux qui assument cette croyance ou qui l’ont jusqu’ici défendue. De la bonne foi il y a, de la peur aussi d’assumer un destin que l’Histoire a trahi. La vérité n’est pas toujours facile à regarder. On préfère espérer des lendemains meilleurs.
Une double identité
Et pourtant, mon chemin comme celui de beaucoup d’autres a été différent. J’ai d’abord cru au Canada et je l’ai analysé. Ce fut le parti pris de mes quinze premières années de chercheure et d’analyste. Puis ces analyses m’ont amenée à effectuer plusieurs constats. Tout d’abord, j’en suis venue à y lire un fait inattendu pour moi: le fédéralisme a pour effet (et pour fin, pour ceux qui l’ont décrété) de faire oublier l’histoire. Le fédéralisme gomme, estompe les traces d’une mémoire fondatrice, tente d’harmoniser les conflits, les désaccords, les écarts de pouvoir. Le fédéralisme existe en soi et pour soi. Il est un réel complet, il jouxte réel et raison tant sa cohérence est réalisable. Le fédéralisme occulte un pouvoir inégal en le sectionnant. Il fabrique de l’illusion et cette illusion est la croyance en un système parfait, toujours capable de s’adapter et qui se suffirait à lui-même. Les divisions qu’établit le fédéralisme seraient équitables: elles visent à rendre pleine justice aux inégalités qui pourraient en être c...