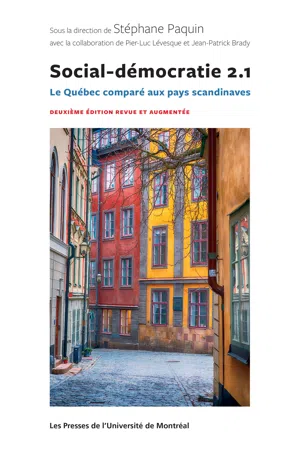![]()
CHAPITRE 1
La social-démocratie en crise?
Quelle crise?
Bo Rothstein et Sven Steinmo
Dans le cadre de ce chapitre, nous nous poserons la question suivante: est-ce que l’affaiblissement du projet politique social-démocrate en Europe s’explique par la faible performance du modèle social- démocrate? En d’autres termes, est-ce que les insuccès politiques récents des partis sociaux-démocrates sont le résultat d’un rejet rationnel de ce modèle par les électeurs? Il convient néanmoins de rappeler que le projet social-démocrate se distingue passablement des programmes utopiques et anarchistes qui ont été conçus par certains courants de pensée plus radicaux. Les succès macroéconomiques et sociaux du modèle social-démocrate parlent d’eux-mêmes. À la différence des groupes anarchistes et communistes qui échouèrent à créer des sociétés utopiques, la social-démocratie réussit à développer un modèle socioéconomique efficace et performant parce que ses partisans surent adhérer aux principes du pragmatisme et du réalisme.
Nous estimons donc que la meilleure façon de juger le modèle social-démocrate est de le comparer aux autres «macro-modèles». Dans une perspective européenne, nous considérerons ici les régimes de la «démocratie-chrétienne» centriste ainsi que le modèle néolibéral. Les questions auxquelles nous nous attarderons seront évidemment les suivantes: sur quelles bases devrait-on juger le succès de ces «macro-modèles» et quels pays semblent le mieux correspondre au modèle type de la social-démocratie? Nous commencerons par cette dernière question.
À n’en point douter, lorsque l’on souhaite discuter de la situation actuelle de la social-démocratie, il est essentiel de définir le sujet lui-même. L’étiquette «social-démocrate» tend effectivement à rassembler un large éventail d’idées, de politiques publiques et de partis présents sur la scène nationale de différents pays. À notre avis, cela peut mener à une mécompréhension du système social-démocrate dans la pratique. Bien sûr, nous utilisons le terme social-démocratie pour dépeindre une certaine forme de modèle social et économique qui est fondé sur l’idéologie sociale-démocrate. Assez simplement, l’économie politique sociale-démocrate est donc fondée sur les idées universelles de solidarité sociale, de modernité et sur la conviction que la société peut être changée grâce à des «politiques éclairées».
Le modèle social-démocrate, comme nous le définissons, tient essentiellement trois types d’engagements. D’abord, tous les individus qui composent le peuple ou la société, quelles que soient leurs origines, doivent avoir accès à un ensemble de droits sociaux, à certains types de services et à un support économique. Ces programmes ne sont donc pas destinés uniquement aux populations vulnérables et aux minorités, mais à toutes les sphères de la société (Rothstein et Uslaner, 2005). Les programmes universels classiques comme le système de santé public, les allocations universelles aux enfants, l’éducation publique gratuite, les soins destinés aux personnes âgées et un régime fiscal où presque tous sont appelés à contribuer sont des exemples de cette approche. Il est important de comprendre que ces politiques universelles sont très différentes des politiques sociales et des systèmes fiscaux «ciblés» que l’on peut observer dans des pays tels que le Royaume-Uni et les États-Unis. Dans une assez large mesure, le modèle social-démocrate est également très différent du système d’assurance sociale, qui est sans doute l’un des traits distinctifs de plusieurs États-providence européens. Ces politiques universalistes sont donc basées sur l’idée que tous doivent payer et que tous peuvent bénéficier des mêmes programmes, ce qui les distingue des régimes où l’on compense les perdants et où l’on punit les gagnants. D’une certaine manière, les idées sociales-démocrates sont donc alignées avec celles des plus influents philosophes libéraux, même si les fondements idéologiques et historiques des États-providence sociaux-démocrates se trouvent ailleurs. Par exemple, le lauréat du prix Nobel Amartya Sen n’hésitait pas à déclarer que la justice sociale exige que tous les citoyens disposent de certaines «capacités» (capabilities) de base. John Rawls a également soutenu que tous les individus devaient avoir accès à certains «biens primaires» similaires à ceux qui sont effectivement offerts par les politiques sociales universelles de la social-démocratie.
Ensuite, le modèle social-démocrate s’engage à limiter les effets négatifs de l’économie de marché sans la remplacer ou sans tenter de la contrôler. En fait, les États-providence sociaux-démocrates sont remarquablement «pro-marché». Ils combinent donc une attitude positive à l’égard du libre-échange et de la libre entreprise avec le constat qu’une économie de marché efficace doit également être encadrée par certaines régulations publiques pour fonctionner adéquatement. Les objectifs de la social-démocratie sont dont très différents de ceux du socialisme d’État ou du communisme. Les politiques sociales-démocrates se distinguent aussi des politiques populistes/gauchistes que l’on a pu observer au XXe siècle et qui sont motivées par un désir de redistribuer le revenu directement d’une classe à une autre. Depuis leurs débuts, les régulations sociales-démocrates se sont surtout concentrées sur le marché du travail (journées de travail de huit heures, régime de pension, assurance-emploi, sécurité du travail, lois sur le travail des enfants, droits des syndicats) et furent plus tard étendues à d’autres secteurs tels que la protection de l’environnement, l’égalité des genres ou la régulation des marchés financiers. Les politiques publiques sociales-démocrates impliquent donc un rejet du postulat néolibéral voulant que les marchés aient la capacité de servir le «bien public» lorsqu’ils sont déréglementés. Contrairement au populisme, la social-démocratie n’entreprend pas de redistribuer la richesse en la prélevant directement des riches pour la donner aux pauvres. Même s’il est inexact d’affirmer que la social-démocratie n’établit aucune forme d’aide ciblée, il reste que les pays sociaux-démocrates dépensent relativement moins que les autres États-providence avancés en matière d’aide directe aux pauvres. Le graphique de la page suivante offre un excellent exemple de cette réalité. Là, on peut observer les dépenses publiques sociales pour les familles dans différents pays de l’OCDE. On remarque que les pays sociaux-démocrates figurent parmi les plus dépensiers pour ce type de dépenses, mais que le niveau des transferts directs aux familles est plus bas en Suède, au Danemark et en Norvège, même si les politiques sociales de ces pays prévoient des allocations pour toutes les familles avec enfants. En revanche, ils dépensent beaucoup plus que les autres en matière de services de garde et d’éducation préscolaire.
Le plus important demeure toutefois de comprendre que la social-démocratie n’est pas un mouvement populiste. Les partis sociaux-démocrates ont bâti de larges États-providence en taxant souvent lourdement leurs propres électeurs. Également, ils n’ont pas tenté de financer leurs politiques sociales en implantant un impôt confiscatoire ou en finançant l’État en lui permettant de s’approprier la richesse des particuliers ou des entreprises.
La logique derrière cette prestation universelle des services n’est pas seulement que cela assurera des succès électoraux aux sociaux-démocrates. Plutôt, comme l’a montré Sheri Berman (Berman, 2006: 206), «la social-démocratie équivaut à une certaine forme de communautarisme, qui met l’accent sur la solidarité sociale et qui reposait sur des politiques renforçant l’unité sociale et la solidarité». Par conséquent, cette idée fait en sorte que même les classes les plus aisées de la société doivent bénéficier des programmes sociaux. La solidarité sociale en arriva ainsi à signifier solidarité de l’ensemble du peuple et non seulement de la classe ouvrière.
Enfin, la social-démocratie s’est engagée à adopter des politiques sociales progressives. Cela veut dire qu’on ne tente pas de maintenir les sociétés dans un état d’équilibre idéal ou de stabilité. Au contraire, les politiques sociales-démocrates ont toujours été implantées avec l’intention explicite de faire évoluer les sociétés. Que ce soit en matière de droits des femmes, de droits des travailleurs ou de droits des enfants, les États sociaux-démocrates se distinguent des autres modèles d’États-providence par le fait que l’État est un agent de changement social explicite. Dans plusieurs secteurs différents, ces États ont par exemple tenté d’influencer pour le mieux les choix de vie des citoyens sans que leurs origines sociales et ethniques ou leur genre ne constituent des facteurs d’exclusion. Les États sociaux-démocrates ont plutôt tenté d’améliorer les choix de vie des personnes, ce qui contribue à les classer parmi les États les plus libéraux du monde.
État-providence et social-démocratie:
deux réalités différentes
Nous soutenons donc que le modèle social-démocrate se distingue des autres modèles par sa structure plus que par le niveau relatif des dépenses publiques. Certains des États-providence les plus dépensiers ne sont pas des social-démocraties. En fait, au XXIe siècle, il est sans doute plus juste de qualifier plusieurs des plus gros États-providence «d’États-pensions». C’est une réalité bien connue que les États-providence sociaux-démocrates du nord de l’Europe s’accompagnent d’une fiscalité assez lourde et de dépenses publiques imposantes. Néanmoins, on suppose parfois à tort que c’est une fiscalité très progressive et des dépenses publiques dirigées vers les pauvres qui rendent l’égalité économique et sociale de ces pays possibles. Au contraire, le modèle social-démocrate a développé un régime d’imposition et de taxes relativement «plat» ou uniforme d’une catégorie de revenus à l’autre (Steinmo, 1993). Pareillement, lorsque l’on compare le modèle social-démocrate avec les États-providence des États-Unis ou du Royaume-Uni, on peut remarquer la rareté des programmes d’aide ciblée conçus pour permettre aux plus pauvres d’améliorer leur situation (Steinmo, 2010).
Où peut-on trouver cet État-providence social-démocrate dans le monde contemporain? Clairement, de nombreux partis se sont réclamés de l’idéologie sociale-démocrate en Europe dans les dernières décennies. Néanmoins, lorsqu’on se demande quels pays ont réussi à implanter des politiques publiques sociales-démocrates, il faut constater que seuls les quatre pays scandinaves (Suède, Danemark, Finlande et Norvège) peuvent ainsi être qualifiés de véritables social-démocraties. Nous ne voulons pas suggérer que les idées sociales-démocrates circulent uniquement dans les pays scandinaves ni que les partis de gauche qui s’y trouvent ont toujours poursuivi des objectifs purement sociaux-démocrates. Il nous semble plutôt qu’un très petit nombre de politiques très uniques ont permis de façonner l’État-providence social-démocrate. Même si plusieurs éléments de l’idéologie sociale-démocrate se retrouvent dans les politiques de nombreux autres États-providence – incluant les États-Unis pendant le New Deal - elles ont véritablement façonné un système d’État-providence cohérent dans très peu de pays. Ces quatre pays ont donc construit un amalgame de politiques publiques unique qui constitue un modèle social distinct. Si nous comparons les politiques de ces quatre pays avec celles des autres démocraties avancées, les traits particuliers du modèle social-démocrate commencent à apparaître. Comme les graphiques qui suivent l’indiquent, ces pays conservent un haut niveau de taxation; un haut niveau de dépenses sociales – à l’intérieur desquelles un haut pourcentage des dépenses va aux familles et aux jeunes, plutôt que seulement aux retraités et aux pensionnés; un bas niveau des dettes publiques et de faibles déficits budgétaires; de fortes dépenses en éducation et en soins de santé; un haut niveau d’égalité sociale; un haut niveau d’égalité des sexes; un haut niveau d’investissement privé; des citoyens très éduqués; un meilleur niveau de confiance interpersonnelle; une corruption faible ou absente; des populations en meilleure santé, ainsi que des individus qui se disent en moyenne plus heureux.
Ainsi, certains pourraient prétendre que si seuls quelques petits pays ont réussi à créer des États-providence sociaux-démocrates, alors la question de la «crise de la social-démocratie» dans l’ensemble du monde occidental ne se pose pas vraiment. Nous ne pensons pas. Premièrement, comme nous le montrons ici, le modèle social-démocrate n’est pas un échec. En fait, ce régime s’en sort remarquablement bien à l’ère de la compétition internationale. Ce n’est pas la social-démocratie qui échoue, mais bien les politiques populistes offertes par l’ex...