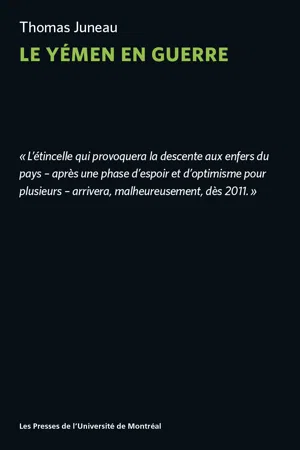![]()
Le Yémen jusqu’en 2010
La guerre qui fait rage au Yémen est, initialement, un conflit intérieur entre le mouvement houthiste et le gouvernement central, conflit qui s’internationalise en 2015 lorsque l’Arabie saoudite et ses partenaires interviennent en soutien au gouvernement central afin de contrer les houthistes, eux-mêmes proches de l’Iran. Ces événements suivent un schème historique: le Yémen a été, tout au long de son histoire, la cible d’interventions par des puissances extérieures qui ont exacerbé des tensions locales préexistantes. Ce serait toutefois une erreur, ou à tout le moins une simplification réductrice, de décrire le pays comme un acteur passif, le récipiendaire plus ou moins inerte des actions d’acteurs plus puissants. Même dans ses grands moments de faiblesse, le Yémen – comme État unitaire, ou comme la somme des acteurs locaux qui, ensemble, représentent le pays sur la scène internationale – a toujours eu ses propres intérêts et bénéficié d’une certaine autonomie.
Tout au long de l’histoire du pays, en effet, les Ottomans, les Britanniques et d’autres interviennent au Yémen, contribuant chacun à façonner le pays que l’on connaît aujourd’hui – ses frontières, ses habitants, son évolution politique. Entre 1962 et 1970, par exemple, un conflit entre forces républicaines et royalistes s’est internationalisé lorsque, dans un contexte de guerre froide arabe, l’Arabie saoudite soutient l’imam zaydite renversé en 1962 par les républicains, eux-mêmes soutenus par l’Égypte de Gamal Abdel Nasser. Puis, en novembre 1990, le Yémen nouvellement unifié s’oppose à la résolution 678 du Conseil de sécurité de l’ONU, qui autorise le recours à la force par la coalition menée par les États-Unis contre l’Iraq après son invasion du Koweït. Motivée par l’affinité de Saleh envers Saddam Husayn ainsi que par l’opinion publique yéménite largement opposée à la perspective d’une intervention américaine, cette décision coûte cher: environ un million de travailleurs yéménites sont expulsés des riches pétromonarchies voisines, principalement d’Arabie saoudite. La perte de la rente que représentaient leurs salaires, combinée au choc de l’unification, fait saigner l’économie déjà fragile du pays.
Le contexte est différent aujourd’hui, bien entendu, mais il est possible de tracer certains parallèles historiques. Des puissances internationales profitent de l’espace créé par un conflit intérieur au Yémen pour tenter d’étendre leur influence et exercer une pression sur leurs adversaires. Il s’agit certes d’une description juste des actions de Riyad, Abou Dhabi, Téhéran et Washington aujourd’hui. Cela dit, toute description de la guerre depuis 2015 – ou de celle des années 1960 – comme un conflit par procuration (proxy war) au sein duquel les grandes puissances manipulent de petits acteurs locaux est, au mieux, incomplète. En effet, les acteurs yéménites n’hésitent pas à requérir ce soutien étranger ni à manipuler leurs donateurs dans la poursuite de leurs propres objectifs intérieurs – même lorsqu’ils divergent de ceux des puissances extérieures qui les soutiennent.
En plus du cliché du Yémen en tant qu’acteur passif, un second mythe commun est celui du conflit sectaire. La guerre au Yémen présente certes une dimension sectaire: les houthistes sont des chiites zaydites, et plusieurs de leurs adversaires sont non seulement sunnites, mais aussi islamistes. Il est également vrai que les puissances extérieures qui interviennent au Yémen n’hésitent pas à mobiliser des identités sectaires locales dans la poursuite de leurs intérêts. Malgré cette réalité, il est, encore une fois, incomplet de réduire la guerre au Yémen à une simple dynamique sunnite-chiite, ce que plusieurs journalistes et politiciens font fréquemment en assimilant les houthistes et l’Iran à des «chiites» et le gouvernement central et ses partenaires étrangers à des «sunnites».
La guerre au Yémen est, d’abord et avant tout, née d’une dynamique locale: une compétition entre acteurs yéménites qui cherchent à maximiser leur part des ressources limitées d’un pays appauvri. Ces acteurs ont ensuite progressivement mobilisé le soutien de puissances extérieures qui partagent leurs intérêts, même si cet alignement n’est souvent que partiel. Les différentes factions au sein de l’écosystème politique yéménite manipulent donc, à leur façon, les jeux d’influence déjà engagés entre l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Iran et les États-Unis. Afin de mieux comprendre les conditions qui ont mené à l’explosion puis à l’internationalisation de la violence au Yémen au cours des dernières années, commençons toutefois par un bref survol de l’histoire du pays.
Le contexte historique
Le nord du Yémen est gouverné, de 890 jusqu’en 1962, par une succession presque continue d’imamats zaydites, à la puissance et aux frontières fluctuantes. Les zaydites représentent une petite minorité au sein de la famille chiite, elle-même minoritaire au sein du monde musulman. La très grande majorité des chiites sont en effet duodécimains, puisqu’ils reconnaissent une lignée de douze imams issus de l’union entre Ali, cousin du Prophète Mohammad, et Fatima, fille du Prophète. Le douzième imam – le mahdi, ou messie – a été, selon les duodécimains, occulté par Dieu et reviendra à la fin des temps établir le règne de la justice sur terre.
Le chiisme zaydite, quant à lui, est né d’une dispute au sujet de la succession du quatrième imam: la majorité des chiites prête allégeance à l’un de ses fils, alors qu’une petite minorité demeure loyale à un autre fils, Zayd ibn Ali. La révolte qu’il attise est brutalement réprimée, et Zayd y trouve la mort. Ses disciples, les zaydites, ont néanmoins perduré et se concentrent aujourd’hui presque exclusivement au Yémen.
Les zaydites forment la majorité des populations des régions montagneuses du nord-ouest du Yémen et environ 40% de la population totale du pays; le reste adhère à l’école chaféite de la branche sunnite. Les zaydites se distinguent par leur croyance selon laquelle seules les familles de descendants du Prophète – les sada – ont la légitimité nécessaire pour gouverner les fidèles. Le pouvoir – l’imamat – doit aussi revenir à celui qui est le plus apte à mener la lutte armée contre l’injustice. La société zaydite est ainsi fortement stratifiée, avec une caste historiquement supérieure, les sada, dont fait partie la famille al-Houthi. Ce sera d’ailleurs un fort sentiment de marginalisation chez les sada, soumis aux autorités républicaines, qui va mener à l’émergence des houthistes à partir des années 1990.
Les interventions étrangères au Yémen précèdent le 20e siècle. Les Ottomans occuperont ainsi le pays à deux reprises, d’abord entre 1538 et 1634, puis entre 1872 et 1918. Il s’agit, dans les deux cas, d’une présence difficile, lors de laquelle l’occupant ne parvient pas à étendre sa domination sur l’ensemble du territoire qui constitue le Yémen d’aujourd’hui, se limitant principalement à quelques villes du nord. Alors que l’Empire est au bord de l’effondrement à la fin de la Première Guerre mondiale, l’imam Yahia aura finalement raison de cette seconde tutelle ottomane.
L’Empire britannique, quant à lui, saisit Aden, métropole du sud, en 1839, un peu plus de trois siècles après que les Portugais eurent échoué à faire de même. Un port naturel au carrefour de l’Europe, de l’Afrique et de l’Asie, Aden présente alors un intérêt stratégique majeur pour Londres. Les terres intérieures autour d’Aden, par contre, demeurent marginales aux yeux des Britanniques: leur seul intérêt est d’assurer la sécurité du port. Ces derniers ont donc peu d’interactions avec le nord, puisqu’un grand nombre de sultans, de cheikhs et d’émirs plus ou moins auto-nomes assurent un tampon entre Aden et Sanaa. La présence britannique au sud-ouest de la péninsule arabique dure près de 130 ans et demeure largement centrée sur Aden, qui est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale le deuxième port en importance au monde après celui de New York.
Au cours des années 1940 et 1950, les sentiments nationalistes et républicains bouillonnent en opposition à l’imamat – de son nom officiel, le Royaume mutawakkilite hachémite du Yémen. La monarchie demeure étouffante et autarcique, malgré les timides efforts de réforme sous l’imam Ahmad, qui succède à son père Yahia en 1948. En 1962, de jeunes officiers soutenus par l’Égypte républicaine de Nasser réussissent à renverser l’imam Badr, qui venait tout juste de succéder à son père Ahmad, puis proclament la naissance de la République arabe du Yémen.
L’Arabie saoudite, une monarchie conservatrice proaméricaine inquiète des ambitions panarabes de Nasser, décide alors de soute...