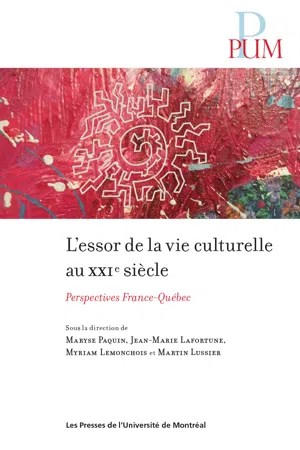La partie qui suit aborde ces deux volets. Le texte de Gilles Pronovost retrace l’origine et les besoins nouveaux en matière de recherche sur les politiques et la participation culturelles. Développé à compter de la seconde moitié du XXe siècle, ce type de recherche bénéficie déjà d’un certain recul fondé sur une analyse détaillée des pratiques et des enjeux. De l’avis de l’auteur, les méthodologies en usage sont éprouvées et leurs limites clairement identifiées, tandis que la prégnance des grands facteurs sociodémographiques est largement étayée. Les dynamiques en jeu dans la participation culturelle, croisant les rapports intergénérationnels et les modalités d’appropriation, font l’objet de nombreuses études. Les défis qui accompagnent l’avènement du numérique, sur les plans épistémologique, théorique et méthodologique, appellent toutefois leur renouvellement. Alors que la politique culturelle du Québec de 1992 est fondée sur le soutien et la démocratisation des arts et la professionnalisation du milieu culturel, l’Agenda 21 de la culture, adopté par le gouvernement en 2011, décloisonne le secteur culturel en recherchant la complémentarité et le soutien mutuel entre les différents objectifs du développement: environnemental, social, économique et culturel. Pour Gaëlle Lemasson, cette nouvelle orientation de l’intervention gouvernementale pose trois questions essentielles lorsqu’on l’analyse sous l’angle de la théorie de la valeur publique: s’inscrit-elle en continuité ou en rupture avec les énoncés de politiques culturelles précédents? Quelle en est la portée réelle? Quelles en sont les limites?
Pour un analyste des faits politiques comme Phillipe Teillet, la promotion des droits culturels comme nouveau cadre de référence en matière de politiques culturelles soulève plus de passion que d’effets concrets. Sujet de divergences entre spécialistes et acteurs, les droits culturels font l’objet de débats au Parlement, puis sont inscrits dans la loi. Or, loin de considérer que la judiciarisation des politiques culturelles est advenue, l’auteur s’attache plutôt à montrer à quel point ce changement de politiques s’explique moins par la mise en conformité des politiques nationales avec les engagements internationaux de la France que comme le résultat de controverses et de luttes qui ne s’épuisent pas avec la législation récente. Le contexte dans lequel les politiques culturelles doivent aujourd’hui se déployer semble ainsi plus favorable au statu quo qu’à la mise en œuvre de réformes profondes.
La construction du champ de pratiques et d’analyses de la médiation culturelle, paradigme dominant de l’intervention socioculturelle actuelle tant au Québec qu’en France, est contemporaine de la montée du néolibéralisme, défini comme la rationalisation technocommerciale du mode de production, de diffusion et de consommation de la culture comme des autres biens. Soutenant que l’élévation du taux de participation à la culture et la concrétisation d’un idéal délibératif visées par les tenants de cette approche, notamment au sein des institutions culturelles, sont systématiquement neutralisées par la mise en œuvre des politiques néolibérales, Jean-Marie Lafortune en conclut que le combat contre les inégalités et pour les bienfaits de l’art doit s’étendre hors du secteur culturel.
CHAPITRE 13
Les politiques face
aux mutations du champ culturel
Gilles Pronovost
On ne compte plus les ouvrages qui traitent des nouveaux enjeux des politiques culturelles, en soulignent les défis ou encore n’hésitent pas à en déclarer soit la mort annoncée, soit la fin prochaine. Dijan (2005) parle de «la fin d’un mythe». Benhamou (2015) se demande si un «Nouveau Monde» ne commande pas une «nouvelle politique». Grandmont (2009) évoque déjà «les enjeux et les défis des politiques culturelles publiques» face à l’essor du numérique, à la marchandisation croissante de la culture, à la remise en question des identités culturelles nationales. Il conclut: «Les États ne peuvent plus déterminer seuls les politiques culturelles, influencées qu’elles sont aussi bien par des facteurs exogènes qu’endogènes» (p. 34). Saint-Pierre (2010) à son tour énumère une série de défis auxquels est confrontée la politique culturelle québécoise au XXIe siècle, dont «l’élaboration d’une vision à long terme, réaliste, de la politique culturelle» (p. 310).
Si on semble s’accorder sur le diagnostic général, «les mots pour le dire» varient grandement. Dans un premier temps, on fait état de grands bouleversements, qui font appel tant à des facteurs démographiques qu’à des changements technologiques. Parmi les facteurs démographiques, on retient, par exemple, les changements de population, les dynamiques intergénérationnelles, l’élévation du niveau de vie, les progrès de la scolarisation. On évoque parfois des changements de valeurs, telle l’individualité caractéristique de certaines pratiques culturelles. Pour ce qui est des changements technologiques, la référence incontournable fait presque exclusivement appel au numérique et à ses conséquences économiques disruptives. Il est aussi souvent question de la puissance des grandes industries culturelles de masse. Bref, un bilan qui fait appel à un diagnostic global généralement partagé par la communauté des chercheurs et des analystes politiques. Dans un deuxième temps, on revient généralement sur les politiques culturelles mises en place au siècle dernier, leurs caractéristiques, leurs ambitions, leur déploiement en programmes, structures et financements, pour souligner qu’elles ne sont plus adaptées aux situations nouvelles provoquées par les changements que l’on rappelle. On fait habituellement une distinction dans les politiques culturelles entre une «politique de l’offre» (soutien aux artistes et aux institutions) et la «démocratisation de la culture». La politique culturelle de l’offre est relativement facile à mesurer, puisque de nombreux indicateurs sont disponibles: crédits publics, investissements dans les infrastructures, aides publiques aux institutions et aux artistes, etc. La mesure des avancées de la démocratisation, pour sa part, s’appuie essentiellement sur les enquêtes de participation culturelle menées à intervalles réguliers dans de nombreux pays.
Déjà ici, on peut noter que les fondements empiriques sur lesquels s’appuient les analyses peuvent être fragiles en certains points, et que le «surdimensionnement» du numérique dans ces approches n’échappe pas toujours à un certain déterminisme technologique qui donne «une âme» aux objets techniques et leur confère un pouvoir démesuré. De plus, les liens de causalité entre les politiques culturelles et l’évolution de la participation à la culture ne peuvent bien entendu pas être établis; on mesure plutôt une certaine concomitance entre les deux avec de nombreuses nuances qui généralement mènent au constat d’un relatif échec de la démocratisation, mais sans qu’on puisse l’imputer à l’échec des politiques culturelles elles-mêmes, car on oublie trop souvent que les politiques culturelles sont essentiellement des «politiques de l’offre» culturelle, mais que la «demande» ou l’évolution des «publics» lui échappent en très large partie.
Pour faire un véritable bilan des politiques culturelles, de leur mise en place à leurs conséquences mesurables, il faut procéder à une analyse des politiques, dans la durée, ce qui constitue un redoutable défi pour la science politique et nécessite des moyens considérables, sans compter le fait qu’il s’agit toujours d’une démarche de longue haleine. Trop souvent, on se sert d’un cadre général de changements sociaux, culturels et technologiques pour conclure à la désuétude des politiques culturelles mises en place il y a quelques décennies. Or, comment en arriver à «inférer» que des politiques culturelles sont désuètes, en raison des changements sociaux qui se produisent inévitablement? Les politiques culturelles n’ont-elles pas elles-mêmes des effets sur de tels changements ou bien ne sont-elles qu’à leur merci? Et comment évaluer ce qui se serait passé s’il n’y avait pas eu de politiques culturelles? Je veux montrer par là que la recherche sur les politiques culturelles est tributaire de la notion même de la culture utilisée dans ce domaine des études politiques et du fait qu’elle fait face à des défis liés aux cadres de connaissance implicites ou explicites qui sont convoqués. Elle est également tributaire des conséquences qui en résultent sur le plan de la recherche empirique.
La notion de culture aux origines des politiques culturelles
Au départ, être «cultivé» signifie être «éduqué, poli, policé», mais aussi «connaître les œuvres de l’esprit». La civilisation, pour sa part, est associée aux progrès collectifs dans l’affinement des mœurs. Elle désigne le processus qui arrache l’humanité à l’ignorance et à l’irrationalité. On y sous-tend un «processus civilisateur», par les progrès de la connaissance, l’usage de la «raison» et le développement des «bonnes mœurs».
On doit à l’anthropologue britannique Charles Tylor une première tentative de définition du concept de culture, publiée dans un ouvrage dont le titre n’est pas anodin et indique bien les tentations évolutionnistes d’alors. Dans Primitive Culture, publié en 1871, il écrit: «Culture ou civilisation, pris dans son sens ethnologique le plus étendu, est ce tout complexe qui comprend la connaissance, les croyances, l’art, la morale, le droit, les coutumes et les autres capacités ou habitudes acquises par l’homme en tant que membre de la société» (Tylor, 1871, cité dans Cuche, 2004, p. 16). On note l’hésitation significative entre le terme de «culture» et celui de «civilisation». On note également l’évolutionnisme latent sous-jacent à cette définition. Enfin, la notion renvoie à un ensemble très large de phénomènes recouvrant pratiquement toutes les activités humaines; approche qui n’a jamais été démentie dans les publications ultérieures en anthropologie. Ce trait caractéristique est à l’origine de l’ambiguïté de toute «politique culturelle», encore plus de toute politique de «développement culturel». Notons que la notion de culture est relativement absente de la sociologie française. Durkheim et Mauss, par exemple, se méfient de ses relents évolutionnistes et lui préfèrent la notion de «société», trop associée à celle de civilisation. Le concept de culture est ignoré au profit du rappel de la priorité des cadres sociaux. C’est ainsi que s’explique, chez Durkheim, l’appel à des notions telles que «conscience collective», «solidarité organique». Halbwachs utilise, quant à lui, la notion de «mémoire collective». Enfin, pour Bourdieu, il est question d’habitus. Mais déjà, au début du XXe siècle, les termes du débat sont posés. Un concept anthropologique de la culture devient l’approche obligée pour toute étude un tant soit peu globale des modes de vie d’un groupe, d’une société, voire d’une civilisation, et ce, à l’aide d’outils privilégiant la recherche empirique. La perspective se veut très large et tient compte tant d’aspects matériels (habitat, objets techniques ou rituels, par exemple) que d’éléments relevant des croyances, des modes de vie, du langage et des coutumes.
De la culture aux sous-cultures
Quoi qu’il en soit, la notion de culture connaît, par la suite, d’importants développements. Concept trop large pour permettre de bien appréhender les dynamismes culturels, dichotomie latente entre culture, art et science, on se met progressivement à en complexifier l’analyse, autour des notions de «traits culturels» (caractéristiques typiques de certaines cultures), de «modèles culturels» (ensembles structurés des mécanismes par lesquels une culture s’adapte à son environnement). Cette notion anthropologique de la culture est aussi reprise pour l’étude des communautés culturelles, des immigrants, des cultures urbaines, tout particulièrement dans la sociologie américaine du début du XXe siècle.
Dans la foulée de ces études de communautés, les travaux de Hoggart (1957) sur le style de vie des classes ouvrières britanniques, tout en considérant toujours la notion de culture au sens large, s’intéressent tout particulièrement à celles-ci pour tenter d’y repérer comment la culture d’un groupe est à la fois acceptation de l’ordre politique établi et contestation de celui-ci, voire résistance à l’ordre industriel dominant. Chez Hoggart et bien d’autres, on peut parler d’un véritable éclatement de la notion anthropologique de la culture, au profit de la considération de multiples «sous-cultures», mettant l’accent sur les hiérarchies et les strates sociales, et menant à la fragmentation même de cette notion: cultures dominantes, cultures dominées, culture ouvrière, culture bourgeoise, cultures de classes, cultures populaires, culture savante, culture jeune, etc..
De la culture aux industries culturelles
Un autre courant plus tardif ayant marqué le champ des études culturelles est celui des travaux portant sur les médias et les industries culturelles. Dès les années 1930 et 1940, on s’attache à mesurer empiriquement l’audience de la radio (avec les travaux pionniers de Paul Lazarsfeld), et on procède à des analyses qualitatives et quantitatives du contenu médiatique. On tente également de mesurer les «effets des médias» , puis d’en faire la théorie (avec la célèbre théorie de la communication: «Qui dit quoi? Par quel canal? À qui? Avec quels effets?). Théories de la communication, certes, mais aussi des médias de masse et du «divertissement». Une forte tradition empirique de mesures d’audience en est issue, avec les analyses proprement économiques qu’elle commande. Adorno et ce qui est appelé «l’école de Francfort» reprennent ces travaux en mettant l’accent sur certains aspects des cultures contemporaines, tout particulièrement la culture de masse, la standardisation et l’uniformité, dans une perspective critique moralisante. C’est la naissance des études sur «les industries culturelles», lesquelles s’intéressent moins aux valeurs du plus grand nombre qu’aux «modalités d’organisation d’un système industriel en mesure de livrer des produits culturels taillés ou calibrés en fonction d’une consommation de masse» (Fleury, 2006, p. 20). Le rôle-clé des médias, aussi désignés mass media, s’invite ainsi dans la notion de culture et est repris autant en sociologie de la culture que dans les sciences de la communication. C’est pourquoi les ministères publics chargés des «affaires culturelles» deviennent rapidement des ministères également chargés des communications. Dans la même veine, les nombreux travaux sur la «culture de masse», oscillant entre l’étude de la consommation des médias et celle du loisir moderne, présentent la plupart du temps une image très négative des classes moyennes. On y dépeint souvent le stéréotype du consommateur passif, manifestant un fort engouement pour des produits standardisés.
De la culture aux politiques culturelles
Tel est le contexte historique et épistémologique général dans lequel baignent les chercheurs en sociologie et en anthropologie au moment de la naissance des premières réflexions politiques sur la culture, au cours de la deuxième moitié du XXe siècle: une notion globalisante de la culture, une approche de plus en plus fragmentée des sous-cultures.
À cela s’ajoutent des jugements latents ou explicites sur la qualité de certains types de consommation culturelle, fortement inspirés des travaux sur la culture de masse, tant aux États-Unis qu’en Europe. Par exemple, comme le montre Ritaine (1983), un certain militantisme est déjà à l’œuvre, tout particulièrement autour des politiques éducatives; l’accès universel à l’éducation est perçu comme un moyen de «révéler le peuple à lui-même», dans le souci d’en faire un bon citoyen qui participe aux institutions politiques et s’intéresse aux grandes questions sociales, à la science et aux arts: c’est la tâche des pédagogues, des militants et des animateurs. D’autant plus que l’image du consommateur passif est depuis longtemps associée à une certaine idée du citoyen ordinaire, peu enclin aux arts et aux lettres, plutôt friand de banalités, sinon de vulgarités. Il faut donc «l’éduquer».
Démocratiser l’accès à l’éducation, c’est rendre le peuple apte à s’approprier les valeurs d’égalité et de justice sociale, de participation citoyenne et de coopération. C’est aussi donner accès à une «culture générale» et à des moyens d’expression populaire, sans oublier la nécessaire affirmation nationale.
On sait que l’entré...