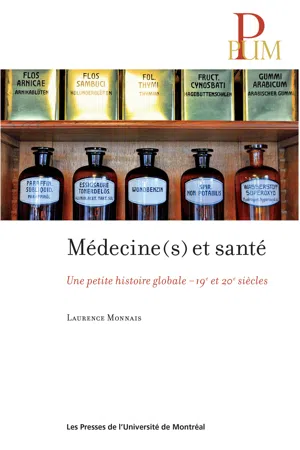![]()
CHAPITRE 1
L’acte de naissance d’une science
La médecine moderne n’est évidemment pas née du jour au lendemain. On voudra en cerner les bases sur une période élastique qui a vu la cristallisation d’un ensemble de caractéristiques associées à l’idée de médecine scientifique qui déterminent encore aujourd’hui la façon dont nous affrontons […] les questions de santé», écrit l’historien des sciences Jean-Paul Gaudillière: «organisation professionnelle, spécialisation par pathologie ou par organe, exercice et enseignement à l’hôpital, association entre sciences de la vie et analyse des processus pathologiques, recours à la modélisation expérimentale, constitution d’une expertise étatique de la santé des populations*.
Les fondements épistémologiques de ce modèle médical sont d’abord à dénicher dans une accumulation de découvertes et de réflexions à partir de la Renaissance, alors que s’impose doucement mais sûrement l’idée de lois universelles que l’esprit humain peut formuler, comprendre et vérifier, préfigurant une conviction que l’homme est capable de contrôler la nature. En parallèle, l’importance d’une démarche scientifique expérimentale, et non plus simplement empirique, allie observation répétée du corps humain – externe et interne, sain et malade – et formulation d’hypothèses mises à l’épreuve.
Prémices intellectuelles
À l’orée du 16e siècle, le décollage de l’imprimerie mène à une consultation diffuse de l’immense œuvre du médecin grec Galien (v.129-v.216), inspirée par Hippocrate et Aristote. La dissection didactique est autorisée par le pape Clément VII – le vol de cadavres est une pratique qui perdurera toutefois jusqu’à la fin du 19e siècle, en réponse à des lois restrictives qui permettent de n’utiliser que des cadavres de prisonniers de droit commun dans certains pays. La voie est grande ouverte pour une remise en cause des textes classiques et la mise en forme de nouveaux canons anatomiques. Andries van Wesel (André Vésale, 1514-1564), de l’École de Padoue, rédige le De humani corporis fabrica libri septem (1543). Ses émules font rapidement avancer la connaissance obstétrique, du système veineux et du cerveau ou encore de la structure interne de plusieurs organes, annonçant l’histologie* et une compréhension aiguisée de la physiologie circulatoire, un domaine dans lequel le touche-à-tout qu’est Léonard de Vinci s’est lui-même exercé. En quelques décennies, la quasi-totalité du savoir anatomique est ainsi constituée, donnant une impulsion remarquée à l’art chirurgical, marqué par l’iconique figure d’Ambroise Paré (1510-1590) dont la grande maîtrise de la traumatologie a été acquise sur les champs de bataille. On doit souligner d’emblée, et le lien pourra être assurément fait pour des périodes ultérieures, l’impact des guerres sur l’avancée des connaissances médicales et d’abord chirurgicales. Nombre de conflits et de massacres mettront sinon en avant l’urgence d’une prise en charge collective de la maladie et de la santé vue, à terme, comme un devoir national.
Les 17e et 18e siècles, de la première révolution scientifique aux Lumières, constituent un terreau particulièrement fertile à une révision des connaissances physiologiques* cette fois, en particulier autour de la circulation du sang dont la compréhension culmine avec les travaux de William Harvey (1578-1657). Ce dernier, tenant à une observation sur des animaux vivants, sans cesse répétée, dépossède définitivement le foie de sa fonction hémato-formatrice. Par un décret royal de Louis XIV en 1675, la théorie des «circulateurs» fait même son entrée dans l’enseignement universitaire. En parallèle, la poursuite d’intenses activités de dissection amène à penser les variations anatomiques comme des manifestations pathologiques, identifiant tumeurs, kystes, parasites. Le travail continu d’exploration annonce la naissance de l’anatomopathologie* et surtout l’abandon d’une vision holiste de la maladie propre à la doctrine galénique, au profit de la primauté de la lésion organique. Cette résiliation d’une vision globalisante du sain et du malsain va évidemment se nourrir du dualisme cartésien qui fonderait l’Europe moderne. Les théories humorales, d’équilibre des humeurs comme gage de santé, perdent forcément du terrain au profit d’une conception mécaniste du corps. Une fracture s’annonce ici: la vie n’est plus ce qui coule, mais ce qui fonctionne, à l’exemple des pompes et des orgues. Alors que Thomas Willis (1621-1675), père du terme «neurologie» et dissecteur infatigable, élaborait l’idée de réflexe, les nerfs justement apparaissent comme pouvant s’irriter, s’user, voire céder. Mais ce sera là une rupture épistémologique lente, non dénuée d’aspérités.
Corps-machine ne veut pas dire «malades interchangeables», surtout au vu des connaissances récemment accumulées dans les domaines connexes que sont l’anatomie et la physiologie. De fait, le 17e siècle est aussi le siècle de l’hippocratisme de Thomas Sydenham (1624-1689) qui retient de la pensée du «père de la médecine» l’importance de privilégier l’observation du malade (on parlera bientôt de clinique), l’identification de signes, ou séméiologie, et de symptômes qui permettent d’affiner la description d’une maladie. Sydenham joue ainsi la carte de la diversité dans l’unité, celle de catégories pathologiques cohérentes dont l’expression varie selon le malade, en fonction de sa constitution*, de données sociodémographiques ou encore de son espace de vie. Pour lui, la maladie constitue un phénomène à la fois individuel et global pour la gestion duquel on doit d’abord faire confiance à la vis natura medicatrix*, au pouvoir guérisseur de la nature. Il faut dire que si l’heure est aux premiers pas de la chimie moderne, la thérapeutique est loin d’être à la hauteur des observations de la mécanique corporelle – le franc succès que connaîtra le laudanum du médecin anglais, à base de teinture d’opium, repose sur ses usages populaires comme simple analgésique et antitussif. Dans le sillage de Sydenham, plusieurs courants néo-hippocratiques* donnent une large place à des observations minutieuses et à des raisonnements stricts, défendant une véritable science de la nature au même titre que la zoologie ou la botanique. En même temps, le corps-machine peut, sans contradiction, être doublé d’un principe vital immatériel, unificateur et organisateur des mouvements de la vie, ce que défend en particulier le vitalisme* de l’École de médecine de Montpellier. À la lumière des travaux de Théophile de Bordeu (1722-1776) qui annoncent l’endocrinologie*, on argue que l’activité sécrétoire des glandes, universelle dans le corps et étroitement liée à l’action de la force nerveuse, traduit l’existence dans la matière vivante d’un tel principe au confluent de l’âme et de la physico-chimie.
Science naturelle donc, la médecine européenne de l’époque se repaît aussi d’autres sciences en plein épanouissement; elle se construit assurément dans la pluridisciplinarité, dans un nécessaire faisceau croisé d’expertises. Si les travaux de Harvey manifestaient les débuts d’une mathématisation de la nature utilisant des calculs savants pour prouver que le sang circule selon un mouvement perpétuel, l’usage des premières statistiques approvisionne une taxinomie plus précise et systématique des maladies, ou nosologie*, au même titre que celle des espèces vivantes. Pour la petite histoire, Carl Von Linné (1707-1778), père de la classification dite «binaire» qui distingue le genre et l’espèce fondée sur des critères de ressemblances de différents traits anatomiques (qui ancrera à terme la théorie de l’évolution), était lui-même médecin en plus d’être naturaliste. Il avait pour ami très cher un autre médecin, François Boissier de Sauvages (1706-1767), avec lequel il entretint une correspondance soutenue sur plusieurs décennies, alimentant la confection du fameux Nosologia (1763). La production nosographique va participer à unifier les repères scientifiques et, bien sûr, à faciliter et à amplifier les échanges entre chercheurs, jusqu’à ce qu’une première Classification des causes de décès internationale, future Classification internationale des maladies (CIM), soit proposée en 1893. De nouvelles techniques sont désormais à la portée du médecin et vont encore ouvrir de nouveaux horizons, en particulier en ce qui a trait au corps interne. L'apparition du microscope (le mot daterait de 1625) confirme le rôle grandissant des loupes de Zacharias Jansen (1585-1632) et de Robert Hooke (1635-1703). Grâce à ces dernières, on observe les tissus, animaux comme humains; on met l’accent sur les fibres, première unité anatomique et de mouvement; on découvre les vaisseaux capillaires qui entérinent la théorie harveyienne. Le Hollandais Antoni Van Leeuwenhoek (1632-1723), autre exemple de savant autodidacte doublé d’un observateur infatigable, identifie pour sa part les globules sanguins, les cellules en bâtonnets de la rétine dans les années 1670 et même les spermatozoïdes et les premières bactéries qu’il nomme animalcules.
Les notions d’infection et de contagion* ont alors déjà été épurées, même si dans ce domaine aussi les théories abondent, se contredisent et s’alimentent mutuellement. Une nouvelle pathocénose*, pour reprendre le concept éclairant de Mirko Gmerk, s’est vraisemblablement mise en place avec la fin du 15e siècle. Elle est marquée par des poussées de typhus exanthématique, de grippe, de «suette anglaise» (la maladie, dont on ne connaît toujours pas l’étiologie*, se caractérise par une hypersudation) et surtout de syphilis qui entraîne pas moins de 5 millions de morts en Europe en quelques années seulement. Les historiens ne s’entendent toujours pas ni sur les origines de la «grosse vérole» ni sur son mode de diffusion. La théorie d’Alfred Crosby qui veut que la maladie ait été importée d’Amérique en Europe par Christophe Colomb recueille toutefois encore la faveur de la majorité – les conquérants ont, eux, fort probablement apporté dans leurs bagages la variole, le typhus et la grippe qui auraient décimé les populations autochtones du Nouveau Monde, tout en diffusant à l’échelle du continent américain la malaria et la fièvre jaune, du fait d’un recours massif à une main-d’œuvre africaine esclave.
Dès 1546, le philosophe, mathématicien et médecin italien Girolamo Fracastoro (Fracastor, 1478-1553) publiait un volume intitulé De contagione, formulant l’hypothèse d’une contamination interpersonnelle dans le cas de la syphilis. Fracastor ne reniait pas complètement le schéma galénien qui décrétait que les miasmes*, poisons engendrés dans un milieu «pollué» (saleté, eau stagnante, brouillard, température trop élevée, air vicié et malodorant), corrompaient les humeurs du corps qui, pour les éliminer, produisaient pustules et bubons. Reste que, pour lui, le facteur contaminant, ou «germe primordial», invisible, était doté d’une vie en propre qui permettait le passage d’un malade à un autre. Quant à la dimension vénérienne de la maladie, elle s’est imposée assez vite au vu de la localisation des ulcérations, ou chancres, qu’elle provoque, entraînant réprobation collective, mesures de contrôle parfois drastiques à l’endroit des prostituées ou des étrangers, et stigmatisations (chapitre 6). La maladie est longtemps connue comme le «mal de Naples» ou «mal français», des dénominations qui, tout en révélant l’ignorance de son cours historique et de son épidémiologie, marquent une volonté de rejeter la faute du fléau et de sa dissémination sur l’autre. Hygiénisme* et infectiologie trouveront ensemble, dans cette expérience mondiale difficile, leurs assises.
Grâce au microscope, aux statistiques de morbidité* syphilitique, à la reconnaissance de lésions organiques «type», on peut aisément imaginer qu’à la fin du 18e siècle déjà la voie était frayée pour la réfutation de la théorie de la génération spontanée*. On doit toutefois se garder de considérer que ces avancées sont alors connues et acceptées de tous. Ce que l’on veut souligner ici, c’est que dans tous ces domaines et branches qui constituent autant de soubassements de la médecine d’aujourd’hui, le cheminement entre une découverte (au sein généralement de petits cénacles étanches de savants-chercheurs), son acceptation, puis son utilisation fut souvent long, parfois chaotique. Les découvertes de Harvey allaient susciter longtemps un tollé du côté des «anti-circulateurs»; les miasmes continueraient d’émailler les discours de certains médecins œuvrant sous les tropiques au tournant du 20e siècle. Les grandes écoles de médecine, de Montpellier ou de Padoue, s’avèrent en fait assez résistantes au changement et à la réforme des principes et doctrines professées avec assurance depuis des décennies. Le journalisme médical, s’épanouissant justement avec le 18e siècle, va certes permettre de diffuser plus rapidement de nouvelles découvertes et de canaliser plus facilement certains débats au sein de sociétés savantes; la Société royale de médecine, fondée en 1778 et chargée d’enquêter sur la morbidité des villes et des campagnes françaises, dispose d’emblée de nombreux correspondants locaux et étrangers. Mais le commun des médecins reste à l’écart des discussions, sans occasion de formation continue et d’abord préoccupé par les symptômes dont lui font part ses patients. Et ces symptômes ont généralement peu à voir à ses yeux avec une anatomie normale ou pathologique (si tant est qu’il ait pu s’en assurer). Il va devoir les prendre en charge au cas par cas et avec les (maigres) moyens thérapeutiques dont il dispose.
Les retombées de toutes les connaissances accumulées, de cette scientifisation du corps interne, mettraient en somme du temps à se concrétiser au chevet du malade et, par là même, à avoir un effet global sur le «bien-être» individuel et l’espérance de vie des populations. Vers 1750, le Français vit en moyenne 28 ans, son homologue anglais 37. Il va falloir attendre, pour espérer agir plus efficacement sur la morbidité comme sur la mortalité, que se construise le modèle hospitalo-universitaire.
De la naissance de la clinique
à la révolution pastorienne
Il est fréquent de voir les histoires modernes de la médecine commencer avec un chapitre sur la médecine clinique, prenant pour point d’appui l’ouvrage phare d’Erwin Ackerknecht consacré à la médecine hospitalière parisienne. L’École de Paris fit effectivement des émules jusqu’en Amérique du Nord, grossissant les rangs des candidats à l’émigration estudiantine. Comme Michel Foucault le soulignait en 1963, la clinique allait y relever précocement, dans un cadre institutionnalisé, tout autant d’une façon de savoir que d’une manière de voir. Le regard clinique cherche des signes qui peuvent témoigner de la localisation et de la nature des lésions organiques pour établir un diagnostic par l’inspection, la palpation, la percussion et l’auscultation. Ces signes sont notés, analysés, en prenant en considération comme points de référence les autres cas étudiés dans l’espace hospitalier afin d’affûter des protocoles d’intervention. C’est là que les façons de faire de la médecine hippocratique, et en particulier l’attention portée à des symptômes individuels relevant d’une trajectoire personnelle de maladie et identifiés par l’explicitation d’une douleur ou la couleur de l’urine recueillie, prennent le pas. La médecine moderne se façonne, s’y apprend et s’y pratique au chevet du malade – clinique vient du grec klinê signifiant «lit». La clinique deviendra, par extension, une institution moderne, lieu délimité de savoirs aux potentialités quasi illimitées reléguant aux oubliettes les hospices-mouroirs tenus par les ordres religieux. La culture populaire manifeste la prégnance de cette vision: dans les films et les séries télévisées, c’est à l’hôpital que se trouvent les vrais malades, les vrais défis, les vrais experts et les moyens technologiques.
Avec le tournant du 19e siècle, l’hôpital français, parisien pour être plus juste, est devenu l’hôte du laboratoire d’anatomie pathologique qui permet de travailler les lésions au moyen de la dissection et de l’autopsie (le taux de mortalité y étant estimé aux alentours de 13% en 1805, ou 4216 décès sur 26 126 entrées, les cadavres sont disponibles en nombre). Ce laboratoire intra-muros fait avancer les connaissances diagnostiques; il fixe de nouvelles disciplines dont l’histologie, portée par Xavier Bichat (1771-1802), qui décrète que les maladies n’affectent pas un organe, mais les tissus qui le composent. Bichat affirme surtout la valeur de la répétition ad nauseam d’une même démarche d’identification de la lésion. L’hôpital non seulement devient le lieu de production du savoir médical, mais il façonne aussi l’expertise d’une élite scientifique. C’est d’ailleurs dès 1802 que les médecins français doivent y faire leur internat, obtenu sur concours. C’est encore dans ce cadre que l’on va prendre conscience de l’importance que revêt l’hygiène des lieux où l’on soigne. La pratique du nettoyage des plaies au moyen de phénol, ou antisepsie*, promue par le chirurgien anglais Joseph Lister (1827-1912) dans les années 1860, y préfigure l’avènement de l’asepsie* à l’heure de l’acceptation des théories bactériologiques. Alors qu’il troque, non sans résistance, son habit de ville pour un sarrau blanc et surtout stérile dans les années 1890, le chirurgien reconnaît qu’il s’agit là de techniques de contrôle opératoire fort utiles. La plaie septique n’est plus une fatalité. Quant à l’anesthésie générale, à l’éther puis surtout au chloroforme, plus maniable et à l’effet plus rapide et plus durable, elle sert à maintenir le patient tranquille. De nouveaux instruments et technologies se sont entre-temps ajoutés à l’arsenal du médecin hospitalier dont les usages vont se codifier, voire se ritualiser, ouvrant la voie à la standardisation de nouvelles procédures cliniques. Le thermomètre autorise l’objectivation du problème pathologique par la mesure, régulièrement prise, interprétée, réévaluée, de la température corporelle; le stéthoscope fait écho à la primauté de l’identification d’une lésion interne pour comprendre la maladie, en l’occurrence des pathologies pulmonaires, domaine de spécialisation de son «inventeur», René Théophile Laënnec (1781-1826). Figure archétypale de l’enseignement clinique, ce dernier succombera lui-même, dans la fleur de l’âge, à la tuberculose: devenu machine médicale, l’hôpital mettrait encore du temps à se muer en véritable machine à guérir.
À l’époque du passage de la connaissance anatomique à l’étude anatomopathologique, l’hôpital est en outre devenu le lieu de l’essor de la physiologie expérimentale. La physiologie a déjà absorbé les connaissances accumulées sur la circulation, bien sûr, ainsi que sur les mécanismes de la digestion – un processus devenu chimique grâce, entre autres, aux travaux de François Magendie (1783-1855) –, de la reproduction ou encore de la respiration et de la fonction neuromusculaire. Considéré comme le fondateur de la médecine physiologique, François Broussais (1772-1838) certifie en 1821 que «toutes les maladies sont locales dans leur principe», essentiellement des «cris d’organes souffrants». Sa gastro-entérite, inflammation conjointe des membranes internes de l’estomac et de l’intestin grêle, ne rencontre pas l’adhésion de ses pairs, mais porte un coup supplémentaire à une approche holiste du mal. À sa suite, Claude Bernard (1813-1878) enracine une idée déterministe de la causalité pathologique et affirme qu’il n’y a pas de différence qualitative entre les fonctions normales et pathologiques: les maladies sont des fonctions physiologiques exagérées ou, à l’inverse, disparues. Pour lui, la physiologie, base de la médecine scientifique, puisque le normal est à maîtriser pour aborder le pathologique, mérite par conséquent d’être détachée de l’hôpital où l’investigation clinique peut certes localiser des lésions, mais reste incapable d’accéder aux fonctions fondamentales du corps vivant et de produi...