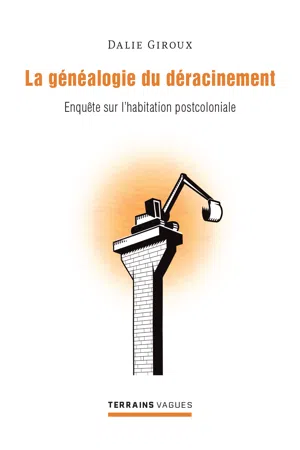![]()
II. L’ARCHITECTURE
DE LA CAPTIVITÉ
![]()
5. La phénoménologie de la prise de terre
L’Allemagne de l’entre-deux-guerres, en développant un point de vue de «perdant» sur la consolidation de l’hémisphère occidental, a en quelque sorte expérimenté ante une certaine actualité politique de notre temps. Sur le plan international, cette époque est caractérisée par la prépondérance politique d’une Amérique triomphante (engendrant un certain ressentiment envers cette dernière). Elle est également caractérisée par l’existence d’un droit international complaisant, voire flou, par une pratique soutenue d’ingérence militaire et économique de l’hémisphère occidental dans le reste du monde avec en tête de cette alliance intrusive les États-Unis et la Grande-Bretagne. L’impression que le visage universaliste des institutions internationales camouflait des intérêts privés était monnaie courante en Allemagne, et on connaissait en Europe de l’Ouest et aux États-Unis l’existence d’un ennemi international non étatique, le communisme. Sur le plan de la politique intérieure, la république de Weimar a été marquée par l’éclatement du continuum politique, par l’instabilité des gouvernements, et a vu apparaître un cynisme croissant envers les institutions démocratiques. Dans la pensée et dans l’art, s’est développée une fascination pour la guerre et pour la technique, mais aussi une croyance de plus en plus forte en l’idée que la civilisation occidentale était sur son déclin.
Une philosophie de l’espace a émergé dans ce contexte en Allemagne au début des années 1930 et celle-ci, par la particularité du contexte politique et historique de son élaboration, semble échapper au clivage usuel en histoire des idées qui distingue les penseurs de l’exil et les philosophes qui se sont compromis avec le régime nazi. Eu égard à ce contexte, et au fait qu’elle traverse le spectre politique et idéologique de la pensée de l’époque, la réflexion weimarienne sur l’espace nous semble contenir quelques germes philosophiques pour une caractérisation contemporaine de l’usage politique de l’espace en Occident.
Nous procédons ici à une reprise critique de certains aspects de la question de l’espace telle qu’elle s’est posée en Allemagne dans l’entre-deux-guerres. On se penchera dans un premier temps sur les méditations des années 1929-1930 de Heidegger sur l’espace. Nous ferons ensuite une incursion dans la pensée de l’espace de Husserl, que l’on retrouve dans une série de notes des années 1930 et que nous avons abordée dans le chapitre précédent. Nous proposerons enfin une discussion des notions de «prise de terre» et de nomos développées par Schmitt dans Der Nomos der Erde, ouvrage élaboré dans les années 1930 et 1940. Loin d’être idiosyncrasique, la spatialité humaine qui s’est posée dans la pensée allemande de la première moitié du XXe siècle offre une forme de phénoménologie de la prise de terre qui éclaire et explicite la dimension impériale de la pensée spatiale euro-américaine.
Le monde selon Heidegger
Alors que la figure de Heidegger est associée à une phénoménologie qui porte sur la relation constitutive entre l’être et le temps, tout un pan du travail intellectuel du philosophe de Fribourg a en fait consisté en une méditation sur la relation constitutive entre l’être et l’espace. Il écrit:
Il y a la terre et la mer, des montagnes et des forêts, et dans tout cela il y a des animaux et des plantes, des êtres humains et des œuvres humaines, et là-dedans il y a aussi nous-mêmes. Ce caractère de l’étant en tant qu’il se trouve être là au sens le plus large ne pourra jamais être indiqué avec assez d’insistance: c’est en effet un caractère essentiel de l’étant, qui prend toute son ampleur dans notre quotidienneté – ampleur de ce qui se trouve être-là, en laquelle nous-mêmes sommes englobés. […] Ce sont là des caractères du Dasein quotidien que la philosophie a jusqu’à présent négligés: ces choses trop évidentes sont ce qu’il y a de plus puissant dans notre Dasein, et ce qu’il y a de plus puissant est l’ennemi mortel de la philosophie (Heidegger 1992 [1929]: 399).
Cette dimension «ontospatiale», constante dans l’œuvre, se trouve essentiellement associée aux différentes tentatives de définitions par Heidegger de l’idée de monde et de l’homme comme configurateur de monde, notamment dans son séminaire de 1929-1930. Une première définition de cette idée de monde est offerte en ce sens en 1946:
Le monde désigne de prime abord la somme de l’étant accessible, que ce soit pour l’animal ou que ce soit pour l’homme, en mesure variable selon le périmètre et selon la profondeur de pénétration (1992: 288-289).
Évoquant à la fois la mesure (idée d’étendue) et la pénétration (idée de subjectivité), évoquant donc une relation entre l’espace objectif et la perception de celui-ci, cette définition va permettre à Heidegger d’élaborer une distinction entre les différentes formes d’ontospatialité: la matière présente une absence de monde, l’animal présente une pauvreté en monde (qui se rapporte au monde par «accaparement» et «encerclement»), alors que l’homme est configurateur de monde. Dépassant ici l’aperception naturelle de la relation entre l’humain et le monde (les forêts, les animaux et nous dedans), Heidegger élabore l’idée que l’homme est, en son essence, configurateur du monde: «C’est le Dasein en l’homme qui est configurateur du monde» (1992 [1929]: 413). Le Dasein, «être-dans-le-monde», fait être le monde en le produisant, il donne au monde une figure, il le constitue. «Le Dasein est ce qui encadre, ce qui enveloppe» 1992 [1929]: 414). C’est cette intimité de l’être et de l’espace qui doit nous guider ici vers une première élucidation de l’esprit spatial de Weimar.
La constitution du monde par le Dasein, explique Heidegger dans son mouvement de pensée caractéristique, est le fait d’un événement primordial qui fait partie de cette configuration du monde. Le caractère unitaire de cet événement fondamental, coconstitutif de l’être et du monde, ajoute plus loin le philosophe, doit être conçu comme projection. Il s’agit d’un événement qui rend possible, de fond en comble, tout fait de projeter connu dans la conduite quotidienne. La projection «est monde», et le terme s’applique à ce geste qui comprend tous les autres. En d’autres mots, pour Heidegger, le fait de l’humain est la «projection même» – et c’est cela qui fait (configure) le monde. Peter Sloterdijk (2000) reprend cette idée de la projection comme geste humanisant par excellence, l’associant plus précisément à la découverte de la technique: la projection d’une pierre – technique – réalise la première inscription consciente de la limite du monde.
Husserl et la Terre
On trouve une démarche analogue à l’ontospatialité heideggerienne dans ce que l’on pourrait appeler la technique de la chair chez le philosophe Edmund Husserl:
Je ne suis pas en déplacement; que je me tienne tranquille ou que je marche, ma chair est le centre et les corps en repos et mobiles sont tout autour de moi, et j’ai un sol sans mobilité. Ma chair possède de l’extension, etc., mais n’a pas de changement ou de non-changement local, au sens où un corps extérieur se donne comme en mouvement, se rapprochant, s’éloignant, ou comme immobile, proche, lointain. Cependant, le sol sur lequel ma chair va, ou non, n’est pas expérimenté comme un corps, à déplacer ou non intégralement (Husserl 1989 [1934], p. 18).
Dans sa série de notes de recherche rédigées dans les années 1930 et publiées de manière posthume, Husserl tente de jeter les bases d’une «doctrine phénoménologique de l’origine de la spatialité, de la corporéité de la nature au sens des sciences de la nature» (1989 [1934]: 11). Le point de départ est celui d’un geste d’ouverture au paysage qui, par déduction, à partir de l’universalité de cette expérience fragmentaire – infinité intellectuellement posée –, s’offre une cognition primordiale de l’espace-terre:
Je n’ai ni parcouru ni appris à connaître ce qui se trouve dans l’horizon, mais je sais que d’autres ont appris à en connaître un fragment, d’autres à nouveau un fragment encore – représentation d’une synthèse des champs d’expérience actuelle qui donne, médiatement productible, la représentation de l’Allemagne, de l’Allemagne dans le cadre de l’Europe, et de cette dernière elle-même, etc. – finalement, la Terre (1989 [1934]: 11).
Une fois l’espace-terre posé comme synthèse imaginée des expériences spatiales individuelles, Husserl explique que, pour nous coperniciens pour qui la Terre est une des étoiles de l’espace infini de l’univers, c’est-à-dire un «corps», elle n’en est pas moins expérimentée d’abord comme sol, «sol d’expérience de tous les corps» (1989 [1934]: 12). «Ce “sol” n’est pas d’abord expérimenté comme corps, il devient corps-sol à un niveau supérieur de la constitution du monde à partir de l’expérience et cela annule sa forme originaire de sol» (ibid.). La terre, même comme corps, a ainsi une valeur constitutive de l’expérience en ceci qu’elle est le corps à partir duquel nous expérimentons tous les corps. Cette expérience des autres corps est médiatisée par le mouvement: «C’est sur la Terre, à même la Terre, à partir d’elle et en s’en éloignant, que le mouvement a lieu» (ibid.).
C’est évidemment dans le mouvement que s’expérimente sur le plan de la conscience la relativité de l’espace. Alors que le corps-sol se meut en relation avec les autres corps-sol que sont les étoiles, et qu’en cela il est perpétuellement en mouvement, le corps-sol Terre apparaît plutôt au repos lorsque la traversent des corps-sols relatifs, par exemple un train. Puis le paysage se remet en mouvement si mon mouvement même se confond avec celui du train. Mais toujours, dans ce jeu du mouvement et du repos, la Terre immobile est l’expérience originaire qui permet de faire l’expérience de la relativité:
Aussi longtemps que je ne possède pas de représentation d’un nouveau sol en tant que tel, à partir d’où la Terre dans sa course enchaînée et circulaire peut avoir un sens en tant que corps compact en mouvement et en repos, aussi longtemps encore que je n’acquiers pas une représentation d’un échange des sols et ainsi une représentation du devenir corps de deux sols, aussi longtemps la Terre elle-même est bien un sol et non un corps. La Terre ne se meut pas… (Husserl 1989 [1934]: 16)
Heidegger rejoint ainsi Husserl dans l’énoncé selon lequel «ce qui appartient à la constitution, cela est et est seul l’absolue et ultime nécessité, et c’est d’abord à partir de là que toutes les possibilités inimaginables d’un monde constitué sont finalement à imaginer» (Husserl 1989 [1934]: 28). Par ailleurs, c’est ce que nous verrons à présent, le mouvement de relativisation aporétique de la Terre que trouve Husserl dans la vision copernicienne d’un corps-sol relatif, Carl Schmitt en trouve la trace dans l’évolution du droit international des États européens.
La nomologique chez Schmitt
Carl Schmitt poursuit dans Der Nomos der Erde le développement d’une phénoménologie de la spatialité, interrogeant le rapport médiatique des humains à l’horizon, au milieu, à la planète Terre. La particularité de son apport tient en ce qu’il construira sa théorie sous la forme d’une généalogie du droit international dont la thèse principale veut que les transformations du régime juridique soient organisées autour de ruptures historiques entre localisation et ordre (Landnahmen et Seenahmen). Si le récit qu’offre Schmitt participe plus d’une certaine mythologie des relations internationales que de leur analyse effective, il peut encore être mis à contribution, notamment avec les notions de prise de terre et de nomos.
Schmitt part de l’axiome selon lequel la terre, depuis les origines mythologiques de l’institution juridique, est le fondement (la «mère») de tout droit. Cette association s’illustre de différentes manières qui répondent aux réalités impératives de la vie des peuples sédentaires: «La terre est […] triplement liée au droit. Elle le porte en elle, comme rétribution du travail; elle le montre à sa surface, comme limite établie; et elle le porte sur elle, comme signe public de l’ordre. Le droit est terrien et se rapporte à la terre» (Schmitt 2001 [1950]: 48). Les prises de terre, fondations de cités et fondations de colonies sont les «grands actes fondateurs du droit»:
Les prises de terre et les fondations de cités entraînent toujours une première mensuration et une première répartition du sol utilisable. Ainsi apparaît une première mesure qui contient en elle toutes les mesures ultérieures. Elle reste visible tant que la constitution reste visiblement la même. Tous les rapports juridiques ultérieurs avec le sol du pays divisé par la tribu ou le peuple qui le prend, toutes les institutions d’une ville protégée par un rempart ou d’une nouvelle colonie sont déterminés par cette mesure originelle, et tout jugement autonome, conforme à ce qui est, procède du sol (2001: 50).
Ainsi, plutôt que la mesure objective, la mesure fondatrice est celle de l’établissement humain. La prise de terre fonde le droit dans deux directions: vers l’intérieur, définissant la possession et la propriété (droit privé), et vers l’extérieur, en face des autres puissances, et selon le type d’appropriation engagé par la prise de terre (droit public):
Dans tous les cas, la prise de terre est, tant vers l’extérieur que vers l’intérieur, le titre juridique originel, celui qui fonde tout le droit ultérieur. Le droit territorial [Landrecht] et le devoir de servir des habitants du territoire [Landfolge], la défense du territoire [Landwehr] et la levée en masse des habitants du territoire [Landsturm] présupposent la prise de terre. C’est tout bonnement elle qui crée les conditions de cette distinction. Dans cette mesure, la prise de terre a, du point de vue juridique, pour ainsi dire un caractère catégoriel (2001: 51).
Cette définition du droit met non seulement en marche une épistémologie fondée sur l’aperception spatiale telle qu’on l’a identifiée chez Husserl, mais elle offre également une définition de l’action humaine sur la Terre comme action de configuration. La configuration se réalise comme projection qui co-institue (par des opérateurs: formes de pouvoir, propriété, voisinage) le monde (haies, clôtures, bornes, murs, bâtiments) et l’humain (famille, clan, tribu, État). Tous les grands philosophes du droit (Kant, Locke, Vico), suggère Schmitt, ont compris cette coïncidence fondamentale entre espace et droit. Les ordres préglobaux (les empires antiques et chrétiens), qui se fondaient sur une notion de l’espace-terre comme étendue finie, étaient des ordres terriens.
Or, explique Schmitt, ces ordres auraient été rendus caducs par la découverte du Nouveau Monde, «lorsque la terre [articulée à l’idée de la mer comme espace libre] fut pour la première fois saisie et mesurée par la conscience globale des peuples européens» (2001: 54), et par la Révolution industrielle, «au cours de laquelle la terre fut de nouveau saisie et mesurée à nouveau» (ibid.). Ce mouvement indique le passage d’une image mythique de la Terre à une connaissance scientifique de celle-ci, qui fournit une représentation de la «planète saisie en termes de mensuration et de localisation humaines, commune à tous les hommes et à tous les peuples», c’est-à-dire une connaissance véritablement globale. La terre est ici projection comme est projection le fondement du logos dans l’analyse de Heidegger, et elle est objet saisi par l’humanité comme l’est le corps-sol de la phénoménologie de Husserl. Chez les trois auteurs, l’origine comme les résultats d’une phénoménologie de la spatialité ont à voir avec le développement de la science occidentale (logique chez Heidegger, astrophysique chez Husserl, géographie chez Schmitt). C’est le mouvement de pensée d’une civilisation qui se manifeste ici de manière spectrale.
C’est seulement à partir de cette connaissance globale que ce que Schmitt appelle un nomos de la Terre s’avère possible. Entre les signifiés grecs de nomos (distribuer, partager, administrer, souverain, loi) et ses signifiés latins (appeler par le nom, nommer, nominal, nominalisme), on peut apercevoir les couches superposées de sens dans le geste cosmographique évoqué par Mircea Eliade:
Toutes ces régions sauvages, incultes, etc. sont assimilées au Chaos; elles participent encore de la modalité indifférenciée, informe, d’avant la Création. C’est pourquoi, lorsqu’on prend possession d’un tel territoire, c’est-à-dire quand on ...