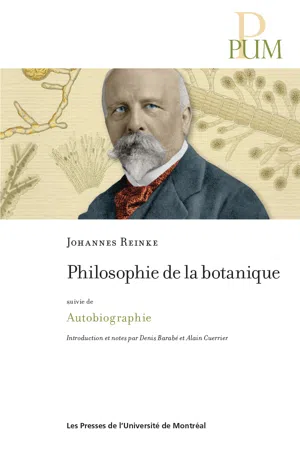![]()
PHILOSOPHIE DE LA BOTANIQUE
Johannes Reinke
Titre original: Philosophie der Botanik, von Dr. J. Reinke. Leipzig, 1905, Verlag von Johann Ambrosius Barth.
![]()
Préface
Le 16 septembre 1750, Linné écrivait la préface de sa Philosophia Botanica. Ce livre est essentiellement une organographie, une terminologie, une systématique. Linné était tellement impressionné par la diversité des formes de plantes que cela mettait en arrière-plan les considérations intégratives; elles ne sont toutefois pas absentes de son livre. Certaines des citations les plus intéressantes de Linné, à la vue desquelles il se révèle être un artiste inégalé de l’expression, ont été rassemblées en annexe.
Depuis 155 ans, aucun livre du même titre n’a été publié. Tandis que la philosophie de la botanique de Linné rassemble les éléments les plus spécifiques et les plus positifs de sa science, le livre qui suit propose de discuter les notions générales de la botanique actuelle. Il s’agit de notions auxquelles je me suis moi-même intéressé au cours des dernières années et qui reviennent dans les différents chapitres sous divers éclairages. Par manque d’espace, il fallait de toute façon me restreindre à mon propre domaine. Pour la même raison, il a fallu renoncer aux références détaillées; les sources ne sont citées que si un paragraphe a été transcrit textuellement. Je prie le lecteur de suivre mes réflexions sans parti pris; les divergences d’opinions ne manqueront pas.
Peut-être me reprochera-t-on mes points de vue qui aujourd’hui ne concordent pas toujours intégralement avec ceux exprimés antérieurement, par exemple ceux concernant la notion de forces psychiques. Je trouverais une certaine louange dans un tel blâme, car loin de moi l’idée de montrer avec fierté que je persiste «inébranlablement» dans des positions prises il y a des années. Je prends plutôt soin de retravailler sans cesse mes points de vue, de les faire progresser et de les améliorer.
Si quelqu’un est tenté de demander comment le présent écrit se positionne face à mon «Introduction à la biologie théorique», alors je préciserai que les deux livres se complètent.
Kiel, 16 novembre 1904
J. Reinke
![]()
1 Les tâches
Aucune science ne peut s’arroger le droit de poser les limites d’une autre. La philosophie le peut encore moins; puisqu’elle touche intimement aux sciences particulières et, en tant que science universelle, y puise du matériel et y intègre ses méthodes, les deux devraient entretenir un lien bienveillant. D’un autre côté, il n’existe aucune science sans contenu philosophique; reconnaître ce contenu, ou une partie de celui-ci, est la tâche d’un spécialiste tel que le philosophe.
Une philosophie de la botanique qui paraît de nos jours a comme tâche essentielle la critique. En premier lieu, elle sera une théorie des principes; l’objet de ses recherches sera l’étude des prémisses établies en science, des moyens explicatifs utilisés ainsi que des symboles disponibles.
Depuis la renaissance de la philosophie de la nature au XIXe siècle par Charles Darwin, le centre d’intérêt de celle-ci s’est déplacé vers la biologie. Au sein d’un organisme, nous avons affaire à la nature dans son ensemble. Le biologiste s’intéresse non seulement aux processus énergétiques de toutes sortes – comme la pression et la tension des masses, l’affinité chimique, la transformation quantitative d’un type d’énergie en un autre ou la compensation de différences d’intensité – mais aussi à la capacité psychique de l’instinct de la fourmi et à la sensation, à l’imagination et à la volonté de l’humain pensant. Le vaste domaine de la logique revêt un aspect biologique dans la mesure où il est dépendant du développement du cerveau dès les premières divisions des cellules embryonnaires. Le biologiste ne doit pas se laisser interdire de discuter lui aussi des fondements des lois de l’intelligence.
Parmi les tâches des biologistes, l’étude des problèmes plus simples incombe au botaniste. Le domaine du mental ne le concerne pas, à moins qu’il ne succombe à la fantaisie d’attribuer une âme aux plantes. Reste la question de savoir si notre intelligence a une obligation quelconque d’attribuer l’existence du monde végétal à des forces spirituelles; cette question, à laquelle les sciences naturelles ne pourront répondre, devrait unanimement être renvoyée à la philosophie de la nature.
Si la physiologie s’applique à l’analyse et à la connaissance des processus vitaux, la philosophie de la nature possède les fondements et les moyens nécessaires pour examiner une telle connaissance. Elle se fonde pour cela sur les principes de la logique.
En science naturelle, nous entendons par connaissance la juste analyse de la perception, conformément à notre capacité humaine de discernement. Depuis le temps de Protagoras, plus personne ne doute que l’humain est la mesure de toute chose. Pour une analyse erronée, la langue a créé le mot méconnaissance.
La tâche des sciences naturelles est la connaissance de la relation entre les corps naturels et les forces. La question logique fondamentale est celle-ci: que pouvons-nous savoir de la nature?
Toute connaissance est directe ou indirecte. Cette dernière peut aussi être appelée connaissance hypothétique, connaissance par déduction ou connaissance dotée d’un degré de probabilité plus ou moins élevé. Nous parlons aussi de méthode inductive de la connaissance.
Nos perceptions sont donc l’objet de la connaissance. Les perceptions sont conditionnées par les variations du contenu de notre conscience. Elles forment des idées qui peuvent se fixer en souvenirs ou se volatiliser rapidement. Tant que la connaissance se limite à ce contenu de la conscience, elle est directe.
Si nous pouvons ramener la perception et les idées à des changements du contenu de notre conscience, alors ces changements peuvent être causés soit par un déplacement à l’intérieur du contenu de la conscience (comme c’est le cas lors de la réflexion), soit par des influences externes qui affectent («affizieren», pour utiliser l’expression de Kant) le contenu de la conscience ou notre «capacité de connaissance».
La formulation de ces deux possibilités constitue en soi une hypothèse. En même temps, c’est ici que se séparent les deux conceptions fondamentales de la théorie de la connaissance: celle de l’idéalisme et celle du réalisme, entre lesquelles la théorie de Kant adopte une position médiane quoiqu’il l’ait lui-même désignée d’idéalisme «critique».
L’idéalisme, dont les représentants historiques sont Berkeley et Fichte, affirme (et cette affirmation est déjà selon moi une hypothèse) qu’il n’existe aucune autre connaissance que la connaissance directe, ou plutôt qu’il n’existe aucune raison de supposer que des changements de conscience puissent être causés par une influence externe, alors que Kant supposait un monde des «choses en soi» qui provoquent de tels changements par leurs actions; évidemment, ces «choses en soi» sont inaccessibles à la connaissance directe. Tandis que Fichte déclarait comme superflue l’hypothèse des «choses en soi», il déplaçait le monde au complet dans le contenu de la conscience humaine; au sens strict, cela ne peut concerner que la conscience individuelle puisque chaque conscience étrangère fait partie du monde extérieur et est donc une «chose en soi».
Le réalisme, que même Kant a retenu en grande partie, ne voit dans la conscience individuelle qu’un fragment infime du monde réel. L’idéalisme, au contraire, la reconnaît comme le monde au complet. La question portant sur la raison de la stimulation de la conscience reste sans réponse, ou encore il est admis que le principe de causalité n’est valide qu’à l’intérieur de la sphère de la conscience, ce qui est manifestement une hypothèse. Pour l’idéalisme, les idées sont le monde réel; pour le réalisme, elles sont – pour reprendre l’expression d’E. v. Hartmann – les représentations que la conscience produit à partir du monde réel. Cette dernière conception conclut, à partir des stimulations de la conscience, à l’existence de causes externes à celle-ci. Ainsi, nous attribuons au principe de causalité un effet au-delà de la sphère subjective. Si nous voulons déclarer comme hypothèse même un réalisme aussi prudent que celui de Kant, qui suppose un monde des «choses en soi», alors le choix entre l’idéalisme et le réalisme ne sera rien d’autre qu’un choix entre deux hypothèses. En me ralliant moi-même au réalisme, je fais de cette dernière hypothèse (parce que je la considère comme fondée, c’est-à-dire que je lui accorde un haut degré de probabilité) le fondement de ma pensée philosophique, comme le chimiste fonde ses spéculations sur l’hypothèse des atomes et des molécules. Je pourrais aussi formuler mon point de vue ainsi: parce que je considère un monde de choses en soi comme probable, j’y crois.
Quand l’étude de la nature franchit ce pas, elle renonce à la connaissance directe du monde en dehors de nous-mêmes et se contente d’une connaissance indirecte. Cependant, la nature humaine nous conduit vers une connaissance indirecte. Nous ne pouvons nous soustraire à ce point de vue qu’en faisant violence à la logique et en niant la possibilité d’un monde en dehors de nous. Jusqu’où le réaliste veut, à partir des relations et de la constitution de ses idées, tirer des conclusions sur les relations et la constitution du monde extérieur dépend d’une autre extension de l’hypothèse réaliste dont on ne tiendra pas compte ici; le fait que Kant enseignait l’impossibilité de connaître les «choses en soi» peut sans doute être considéré comme largement connu.
Une fois que le naturaliste a reconnu le fait que toute connaissance indirecte est par principe hypothétique, il pourra disposer à sa guise du monde de ses idées, comme si elles étaient des représentations – pour ne pas dire des copies conformes – des choses en soi. L’expérience générale montre que, d’un point de vue scientifique, cela ne le mettrait pas dans l’embarras.
C’est pourquoi ces questions fondamentales, qui découlent de la théorie de la connaissance et qui concernent l’idéalisme et le réalisme, n’ont besoin d’influencer d’aucune manière les réflexions scientifiques, ni en sciences naturelles ni en philosophie de la nature; il vaudrait même mieux ne pas s’en préoccuper du tout. Cependant, au cas où nous prendrions parti pour le réalisme, comme je l’ai fait, il faut considérer ce qui suit: comme nous nous contentons de la méthode d’observation indirecte par le microscope en tirant des conclusions sur les relations entre les composantes d’un organisme à partir des relations entre les images microscopiques, le monde tel qu’il nous apparaît constitue l’objet direct de l’observation scientifique. Par le simple fait que nous supposons que ce monde visible est créé par l’influence d’un monde extérieur sur notre faculté de connaissance, nous pouvons déduire que l’étude du monde visible constitue une méthode indirecte d’étude du monde extérieur. De mon côté, je crois que la nature ment à l’humain aussi peu que n’importe laquelle de ses autres créations, car si c’était le cas, aucun organisme ne serait viable. Je crois plutôt que la plus merveilleuse des adaptations que la nature ait créées est notre propre faculté de connaissance, laquelle se divise en organes sensoriels, en intelligence et en jugement. Je crois qu’il s’agit d’un outil qui nous a été donné pour que nous puissions nous orienter dans le monde extérieur et réfléchir sur celui-ci. Cette conviction est renforcée par le fait que nous sommes égarés et dans la noirceur dès que nos organes sensoriels sont détruits ou que notre intelligence est troublée.
De ce point de vue, toute notre conception de la nature, y compris la conception d’une personne sans aucune formation, est une conclusion inductive venant du contenu de la conscience concernant les changements dans le monde extérieur et les relations de ses parties entre elles. L’ensemble de notre connaissance scientifique repose sur d’innombrables conclusions inductives individuelles, car il est rare que la vision directe suffise pour l’acquérir. À titre d’exemple, je mentionnerai le caractère sphérique de la Terre ou la ferme conviction que la roche que je laisse tomber cent fois des airs sur le sol le fera toujours. Dans les deux cas, nous pouvons considérer la probabilité acquise par induction comme maximale, et ainsi la nommer certitude. Dans d’autres cas, le degré de probabilité est moindre, par exemple dans le cas des formules de constitution des composés chimiques. Même dans ce dernier cas, nous sommes convaincus que les formules de structure représentent symboliquement les relations entre les composantes de base au sein d’un composé et nous n’avons pas besoin d’en savoir plus. Les atomes et les groupes d’atomes sont des termes symboliques que nous utilisons pour décrire des faits, tout comme les longueurs d’onde, les fréquences, les notes, les couleurs, etc. Ici aussi, une observation approfondie nous montre que notre jugement sait distinguer, par exemple, les formules de structure erronées de celles qui sont exactes, e...