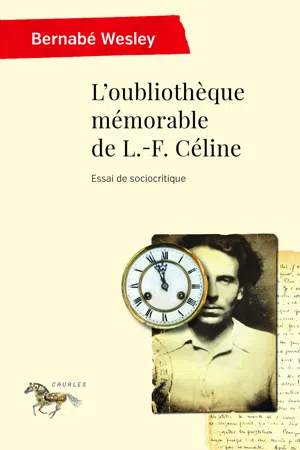![]()
PREMIÈRE PARTIE
La Seconde Guerre
mondiale
au prisme d’un paradigme
du passé
![]()
Chapitre 1
L’oubli collectif
et la saisie littéraire du passé
L’oubli est le parent pauvre des travaux consacrés à la saisie littéraire du passé. Parmi le florilège d’ouvrages contemporains qui se penchent sur la représentation littéraire de la mémoire collective ou de l’histoire, les analyses privilégient à l’ordinaire l’un ou l’autre aspect formel de ce qu’elles désignent comme la vocation mémorielle du roman. Cet oubli de l’oubli dans les études littéraires est d’autant plus surprenant que, dans le prolongement du tournant «mémoriel» évoqué par les historiens de la mémoire, la question de la saisie littéraire du passé a pris une expansion considérable depuis quarante ans. Une telle présence du passé fluctue au gré des figures de victimes dont la voix parle au nom de l’une et l’autre des communautés qui ont fait les frais de l’histoire collective. Les analyses de «fictions de mémoires» se déclinent selon les genres sexuels et les spécificités d’itinéraires marginaux. Elles montrent comment des œuvres à vocation mémorielle sont affectées par les massacres de masse et les violences du xxe siècle et engagent une réflexion sur la Shoah ou sur les particularités historiques des passés coloniaux et néocoloniaux. Parallèlement, d’autres chercheurs se sont intéressés à la façon dont ces mémoires fictionnelles varient en fonction des formes et des genres littéraires, de topiques mémorielles et de formes narratives particulières comme le récit de filiation, lequel revêt une importance singulière dans les romans et les récits contemporains.
Une première catégorie de ces recherches regroupe des travaux qui posent la question de la saisie littéraire du passé en des termes qui relèvent de la narratologie et de l’énonciation. Les innombrables articles et monographies qui portent sur la poétique de la mémoire dans l’œuvre de Proust, de Cohen, de Simon, de Duras et de bien d’autres auteurs en disent long sur la prolifération des interrogations relatives à la mémoire dans la littérature. Ces travaux, de factures théoriques diverses et portant sur des corpus très variés, ont en commun de considérer l’acte de remémoration opéré par la fiction comme la matrice de bouleversements formels qui affectent la poétique romanesque des œuvres. L’exploration de l’ars memoriæ du roman moderne confine souvent à la mise en lumière de formes propres à la modernité comme la fragmentation, l’hétérochronie ou la multigénéricité. Elle s’intéresse à l’entremêlement libre des mémoires familiales, intertextuelles ou encyclopédiques. Elle met au jour l’importance du matériau mémoriel que les œuvres intègrent par l’entremise de listes, de photographies et de traces en tous genres – dans un livre sur [l]e futur antérieur de l’archive, Nathalie Piégay-Gros s’est par exemple intéressée à «la manière dont l’archive s’implante dans la fiction». Ces études portent essentiellement sur la littérature contemporaine et s’interrogent sur les obstacles que rencontre la transmission mémorielle. Les problèmes qu’elle soulève sont envisagés dans des œuvres qualifiées de «romans de l’après coup» ou de «romans de la rémanence», c’est-à-dire des récits marqués par un décalage générationnel et qui, au lieu de faire une représentation directe du passé, en suivent la persistance après sa disparition. De ces derniers, la critique examine par exemple la question de l’indicibilité et de sa mise en texte dans une voix qui, n’étant pas assignée à un sujet ou à un lieu identifiable, forme elle-même une absence. D’autres travaux se penchent sur les dysfonctionnements du deuil et du témoignage en concentrant leur attention sur les figures de l’héritier. Ces remémorations ne vont pas de soi et cherchent à révéler les secrets d’un passé dont les fantômes affectent la fiction et l’écriture d’une vive spectralité.
Lorsqu’ils posent la question de l’oubli, ces travaux ne l’envisagent que comme l’élément contraire de la mémoire. À cette menace d’effacement, le roman opposerait un refus d’oublier, passion dénégatrice qui investirait le genre romanesque d’un besoin anthropologique de conjurer l’oubli. Les rares travaux qui portent sur cette question en littérature l’assimilent généralement à la perte du passé et à des disparitions dont ils analysent les motifs, les figures et les procédés narratifs ou énonciatifs au gré des textes et en fonction des notions et des outils d’analyse mobilisés, mais toujours en considérant l’oubli comme une lacune et une atteinte à la fiabilité de la mémoire. Isabelle Daunais estime par exemple que ce sont ces disparitions qui font du roman un «art de la mémoire» plutôt qu’un «art du présent et de la nouveauté». Pour un certain nombre d’entre elles, ces études font du récit l’élément essentiel de la mise en forme du temps. Prenant appui sur la théorie de la narrativité élaborée par Paul Ricœur, elles délaissent l’examen rebattu de la récusation de l’intrigue traditionnelle à laquelle le roman moderne se livre afin de décrire les «syncopes temporelles» qui perturbent les formes d’expression usuelles de la mise en récit du temps. Elles mettent également en évidence de nouvelles formes de narrativité et des régimes énonciatifs singuliers, notamment ceux de la répétition ou du ressassement. À titre d’exemple, l’essai de Jean-François Hamel, paru en 2006, propose une exploration des poétiques de la répétition qui traversent la modernité littéraire et philosophique en s’appuyant sur la théorie de la narration de Ricœur et sur les régimes d’historicité de François Hartog. Il analyse la résurgence conjointe d’une poétique, celle de la répétition, et d’une thématique, celle du revenant, dans différentes écritures de l’histoire issues de la philosophie, de la littérature et de l’historiographie.
Une large part de ces approches narratologiques rattachent la question de la saisie littéraire du passé à la notion d’intertextualité définie par les travaux relatifs à ce concept de Julia Kristeva, de Michael Riffaterre ou de Gérard Genette. S’appuyant parfois sur des concepts plus récents comme celui, issu de la stylistique, de «récriture» [sic] conçu par Anne-Claire Gignoux, ou celui d’interdiscours tel que l’a conçu Dominique Maingueneau, ces ouvrages analysent parallèlement la mise en texte de la mémoire et, selon l’expression de Tiphaine Samoyault, «la mémoire que la littérature a d’elle-même» ou encore ce que Judith Schlanger appelle «[l]a mémoire des œuvres». De l’évidence d’une intertextualité inhérente aux textes littéraires découlent nombre d’analyses des réécritures, des allusions, des citations, des reprises parodiques ou sérieuses et des phénomènes différents qui composent les palimpsestes par lesquels un texte entretient différentes formes de dialogue avec le patrimoine littéraire et avec les écrits du passé ou du présent que chaque livre s’est choisis.
Sans être clairement séparée de la précédente, une autre catégorie d’analyses s’en distingue parce qu’elle considère la littérature et en particulier le roman comme un espace de reconfiguration de la mémoire collective. À l’instar de l’analyse de Pierre Bayard et d’Alain Brossat, ces travaux s’attachent à montrer comment les textes gagnent leur originalité sur les représentations collectives du passé qu’ils reformulent. Le recueil d’articles réunis par Nelly Wolf sur la spécificité des amnésies françaises à l’ère gaullienne (1958-1981) suggère de la sorte que «seul l’imaginaire narratif est en mesure de donner des contours et une présence à ce qui, par essence, n’est pas, ne se manifeste pas, ne fait pas trace: l’oubli». Certains ouvrages sont attentifs à la manière dont les textes réinventent les représentations et les médiations propres à des paradigmes culturels qui modèlent le rapport au passé d’une société et d’une époque. Ils privilégient les interactions des textes avec des phénomènes culturels comme le recyclage du passé ou des modifications propres à la culture de la mémoire en régime moderne. À la croisée de la sociocritique et des études sur l’intermédialité, les recherches de Djemaa Maazouzi examinent par exemple la scénographie mémorielle des récits de retour dans la littérature et le cinéma algériens. Dans un essai intitulé La culture de la mémoire ou comment se débarrasser du passé?, Éric Méchoulan cherche à saisir, à partir de certains exemples littéraires, ce que devient la mémoire dans le dispositif général de la culture. La perte des usages sociaux qui faisaient du passé une culture de la mémoire laisse désormais place à une mémoire elle-même cultivée, mais coupée de son lien immédiat à la tradition. Selon l’auteur, ce changement culturel majeur – nous sommes passés d’une culture de la mémoire à une mémoire cultivée – caractérise la modernité. Celle-ci est marquée par un rapport au passé qui se joue dans la disjonction, ce qui revient à dire qu’il est inexorablement coupé du présent en même temps qu’il fait l’objet d’un surinvestissement mémoriel. Ce passé, considéré hors de portée, donne lieu à des fictions mémorielles disphoriques qui affrontent lucidement l’impossibilité de restitution du passé et se disent elles-mêmes affectées par un oubli qui s’inscrit en creux dans les formes que prend l’écriture mémorielle des œuvres.
La saisie littéraire de l’oubli
Des travaux spécifiques à l’oubli considèrent celui-ci comme le complément de la mémoire, et non son contraire. Dans Léthé. Art et critique de l’oubli, Harald Weinrich a proposé d’examiner les œuvres et les formes les plus notables que revêt l’oubli au fil de l’histoire culturelle. Dans une démarche qui rappelle les protocoles théoriques de la philologie romane et qui mêle analyse littéraire, connaissances linguistiques, angle de vue culturaliste et érudition historique, l’ouvrage échafaude une histoire synchronique de l’oubli dans la culture européenne occidentale. L’exploration des formes littéraires et philosophiques de l’oubli se concentre sur des œuvres canoniques de la littérature et de la philosophie européennes allant de l’Antiquité à la période contemporaine. Elle s’appuie sur l’idée que la modernité ouvre l’ars memoriæ antique et la rhétorique sur laquelle il repose à une mise en texte de l’oubli. L’ouvrage s’ouvre sur un chapitre dédié au «[l]angage de l’oubli» qui fait état de l’étymologie du verbe «oublier», issu du latin oblivisci, «ne plus penser à quelque chose, perdre de vue», et de son évolution historique, analyse lexicale qui est suivie d’une revue des métaphores traditionnelles qui accompagnent le mot. L’étude de Weinrich rend justice à la variété et à la richesse de la mise en texte de l’oubli dans les œuvres littéraires. Cervantes, Huarte, Dante, Casanova, Goethe, Descartes, Lessing, Kant, Locke, Voltaire, Rousseau, Casanova, Frederick le Grand sont convoqués dans une réflexion sur l’oubli prémoderne qui institue certains thèmes récurrents comme le culte des morts, la métaphore des tablettes d’écriture ou la figure du fantôme. Cette réflexion s’arrête sur des penseurs de la fin du XIXe siècle comme Freud, Bergson et Nietzsche, qui accordent tous trois une importance considérable à l’oubli en le rattachant à l’histoire, à la mémoire ou au refoulé. Ce large panorama de l’oubli comme objet culturel de pensée et d’écriture à travers les siècles a le mérite de montrer l’importance de c...