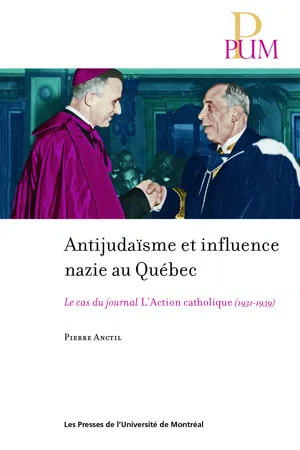![]()
CHAPITRE 1
Le spectre de l’immigration internationale
Parmi les enjeux qui touchent de près à l’altérité culturelle dans L’Action catholique, le plus prévisible et le plus constant a trait au refus d’accueillir au sein du Canada français une immigration d’origine internationale. Systématiquement et sur de longues périodes, les rédacteurs du journal transmettent une opinion négative et souvent alarmiste au sujet des mouvements de population qui pourraient se diriger vers le Canada. Ils jugent avec la même sévérité les personnes immigrantes en général, les nouveaux venus au pays et les réfugiés en quête d’accueil, peu importe leur attitude ou leur nationalité de départ. Sur les 69 éditoriaux qui abordent cette question entre l’été 1931 et le mois de septembre 1939, 62 reproduisent des propos négatifs ou véhiculent des condamnations sans appel (voir l’annexe 1). Cela représente un taux d’opposition de près de 90%, c’est-à-dire le plus fort niveau d’hostilité au cours de cette décennie parmi tous les sujets que traite L’Action catholique. Cette perception atteint son sommet en 1933, au plus fort de la crise économique mondiale, alors que 17 éditoriaux sur 18 pourfendent l’idée que le Canada puisse recevoir de nouveaux apports démographiques de l’étranger. L’Action catholique résiste en effet de toutes ses forces à tout projet d’ouvrir les portes du Canada à de nouveaux courants migratoires, ou aux tentatives qui se font jour ici et là au pays de présenter sous un jour favorable la contribution économique des nouveaux citoyens. Thomas Poulin résume bien la position du quotidien lorsqu’il écrit en 1933:
La campagne se continue en faveur d’une reprise de la politique d’immigration. Nous avons déjà signalé plusieurs de ces indices, mais un nouveau mouvement nous arrive avec une franchise inconnue jusqu’ici.
Il s’agit du Financial Post de Toronto. Ce journal fut d’ailleurs toujours en faveur de la politique d’immigration. Il était convaincu, et il l’est encore, que plus nous augmenterons rapidement le chiffre de notre population, plus nous précipiterons notre marche vers le progrès. […]
Si nous n’avions pas l’expérience des dernières années pour nous renseigner, nous pourrions nous laisser prendre à de tels raisonnements, mais nous savons que la plupart des supposés immigrants agricoles nous venant d’Angleterre vont aboutir dans les villes. […]
Il est un peu cynique de venir prêcher l’immigration dans le but de peupler nos districts agricoles, quand nous avons dans nos campagnes des foules de jeunes agriculteurs désireux, mais incapables, de s’établir sur la terre; quand nous avons dans nos villes d’anciennes familles d’agriculteurs implorant qu’on leur aide à retourner à la culture du sol.
Si la situation économique désastreuse des années trente joue un rôle important dans le positionnement de L’Action catholique au sujet de l’immigration internationale, d’autres enjeux plus politiques composent la trame de fond du refus péremptoire opposé par le journal. Le principal argument évoqué par les éditorialistes pour repousser les courants migratoires tient à la minorisation qui en résulterait à plus long terme pour les Canadiens français au sein de l’ensemble fédéral. Puisque les nouveaux venus se joignent dans l’ensemble à la masse anglophone du pays, ils affaiblissent d’autant la proportion de locuteurs français que compte le Canada. Une fois ce chiffre entamé, c’est l’ensemble du poids politique du Canada francophone qui s’affaisse et avec lui sa représentation à la Chambre des communes à Ottawa. À terme, pense l’équipe éditoriale, cela pourrait carrément signifier la marginalisation du projet national canadien-français et l’affaiblissement de ses valeurs catholiques fondamentales. La charge peut être particulièrement insistante si elle est associée à d’autres grands thèmes traditionnels abordés fréquemment par L’Action catholique, comme l’impuissance économique des francophones et leur asservissement à l’impérialisme britannique. Au cours des années trente, c’est rien de moins que la menace d’une assimilation des francophones canadiens à la langue anglaise qui se profile derrière l’immigration internationale, accompagnée d’une réduction radicale du poids démographique du Canada français. À ce sujet, Louis-Philippe Roy y va en 1936 d’un éditorial au titre évocateur, «Nous étouffer!»:
Nous étouffer! Tel semble être l’objectif principal de ces apôtres de l’immigration dont les appels saugrenus éclaboussent la presse canadienne et le microphone, depuis deux mois. […]
Certes, l’Angleterre se débarrasserait ainsi de milliers de familles actuellement à sa charge. Les compagnies maritimes et ferroviaires transporteraient plus de passagers. Mais, ni l’impérialisme ni l’intérêt ne peuvent expliquer cette propagande intensive et échevelée. Effrayés de la poussée nationaliste qui s’accentue chez la jeunesse [francophone], ces froussards impérialisants ont surtout un désir et un espoir: étouffer sous le nombre l’élément minoritaire français! […]
Envisagée sous l’angle national canadien-français, la reprise d’une politique d’immigration équivaudrait à une tentative de suicide.
L’Action catholique envisage ainsi l’immigration comme un mal sournois qui viendrait s’abattre sur le Canada français et face auquel il n’existe pas de contreparties efficaces à court comme à moyen terme. Au cours de ces années, le journal s’inquiète particulièrement d’une réapparition des niveaux d’immigration qui avaient cours avant la Première Guerre mondiale et qui avaient permis à près de deux millions d’Européens d’entrer au pays. Cette époque de migration de masse a laissé un souvenir très amer dans les pages du quotidien, et plusieurs éditorialistes font référence aux politiques fédérales qui y ont présidé comme à une stratégie antifrancophone délibérée et poursuivie avec beaucoup de vigueur. Plusieurs rumeurs de nouvelles arrivées et de projets d’immigration sont ainsi combattues avec la dernière énergie dans L’Action catholique, entre autres des plans plutôt imprécis prévoyant en 1932 et 1933 l’immigration d’ouvriers britanniques au chômage ou de fermiers désœuvrés en provenance du Royaume-Uni. Pour justifier ces projets, le brigadier-général Edmund Phipps-Hornby, le sénateur Andrew Haydon et Edward Beatty, le président du chemin de fer Canadien Pacifique, y vont de plaidoyers en faveur de la solidarité impériale et d’une meilleure redistribution de la population au sein de l’Empire. Cela donne toute latitude à Thomas Poulin, qui tient la plupart du temps la plume dans le journal à ce sujet, d’affirmer dans un éditorial d’août 1933:
Recommencer une immigration considérable serait sans doute un excellent moyen d’aider aux compagnies de transport, mais n’aiderait pas au Canada. Nos municipalités de ville sont incapables de recevoir d’autres chômeurs. Elles tâchent plutôt de diminuer le nombre de leurs misérables en encourageant un certain retour à la terre.
De grâce, que l’on ne nous parle plus d’immigration massive d’ici bien des années. Il va falloir du temps, beaucoup de temps pour que nous réussissions à mettre de l’ordre dans notre maison.
D’autres facteurs accentuent la méfiance de L’Action catholique quant à la venue de nouveaux immigrants, dont le fait que l’Europe est supposément le théâtre d’une lutte idéologique sans précédent entre révolutionnaires d’allégeance soviétique et forces de l’ordre établi. Si le Canada appuie à nouveau une politique d’ouverture sans limites, pense le journal de la rue Sainte-Anne, il risque d’en faire les frais, et de connaître un afflux inégalé de militants communistes aguerris qui ne tarderont pas à semer la discorde au pays. L’appel à la prudence est lancé dès juillet 1931 quand L’Action catholique conseille de repousser les «propagandistes de la révolution», puis il est repris plusieurs fois au cours de la décennie sous différentes formes. La pression en faveur de l’immigration d’agriculteurs anglais devient par ailleurs si insistante, rapporte un journaliste de L’Action catholique, que le conseil municipal de Québec vote en janvier 1936 une résolution unanime condamnant toute augmentation des flux de population vers le Canada, particulièrement des fermiers cherchant à s’établir sur de nouvelles terres.
En fait, si l’on se fie au recensement canadien, la moyenne annuelle pour le nombre d’immigrants entrés au pays au cours des années trente se situe à environ 15 000 personnes par an. En 1935, seulement 11 300 nouveaux venus avaient été admis aux frontières canadiennes. Il faut remonter à 1867 pour découvrir un bilan migratoire plus bas, soit 10 700 individus, et ce, à une période de l’histoire où la population totale du Canada n’était que de 3,5 millions de personnes. Les protestations et récriminations de L’Action catholique à l’encontre des politiques d’immigration se poursuivent avec la même intensité jusqu’à la fin des années trente en dépit du fait que les arrivées depuis l’étranger sont réduites à leur plus simple expression, et alors que le gouvernement fédéral ne donne aucun signe concret de vouloir rehausser le volume de l’immigration internationale. Derrière ces craintes et méfiances, il y a bien sûr la détresse économique vécue par une grande partie de la population, et l’impression plusieurs fois confirmée que la gestion de l’immigration est faite par des fonctionnaires fédéraux anglophones peu sensibles aux attentes des milieux de langue française au pays.
Les reportages et les opinions qui paraissent dans L’Action catholique révèlent aussi à contre-jour une autre facette de cette problématique complexe, à savoir que la société francophone ne possède pas à cette époque les mécanismes sociaux les plus élémentaires qui lui auraient permis d’accueillir de nouvelles populations venues de l’étranger. En fait, à quelques exceptions près, un ensemble de perceptions très ancrées éloigne les Canadiens français d’une possible convergence avec les immigrants venus au moment de la grande vague migratoire et les pousse au repli sur eux-mêmes. Pour l’essentiel, au cours des années trente, le Canada d’expression française propose une définition de lui-même qui est fondée sur une lecture passéiste de l’histoire et sur une conception très limitative de la francophonie. Ne peuvent appartenir au peuple canadien-français que les descendants des colons de la période française, c’est-à-dire ceux qui arrivèrent en Amérique sous la France de l’Ancien Régime, puis qui furent plus tard engagés dans la création de fronts pionniers agricoles sur le continent. Les Canadiens français sont de surcroît associés depuis plusieurs siècles à une mission providentielle d’évangélisation des Autochtones et de diffusion de la foi catholique. Étant donné ces circonstances historiques relatives à l’origine des Canadiens francophones, tout mouvement d’ouverture à l’égard de l’immigration semble particulièrement ardu de la part du journal. Certes, le chômage très élevé des années trente et le désarroi des citoyens face à la crise économique ont des répercussions sur l’idée que le plus grand nombre se fait de l’immigration. Plus encore cependant, l’étanchéité de la frontière culturelle entre le Canada français et les nouveaux venus prive la société canadienne-française des moyens d’ouverture les plus élémentaires face à l’immigration, ce que reflètent bien certains articles de L’Action catholique. En 1932, alors que se discute une possible, mais bien improbable, résurgence du courant migratoire, Thomas Poulin s’écrie: «Au lieu de nous occuper des nôtres, nous faisons venir des étrangers. Nous avons donc même oublié dans notre aberration que charité bien ordonnée commence par soi-même, ce que les vieux traduisaient vulgairement ainsi: on est plus attaché à sa peau qu’à sa chemise.»
Le regard tourné vers l’époque héroïque de la Nouvelle-France et issu d’un nombre très limité de colons arrivés en Amérique principalement dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, le Canada français est porté à considérer que la période où sa croissance démographique dépendait d’apports extérieurs s’est close en 1763 avec le traité de Paris...