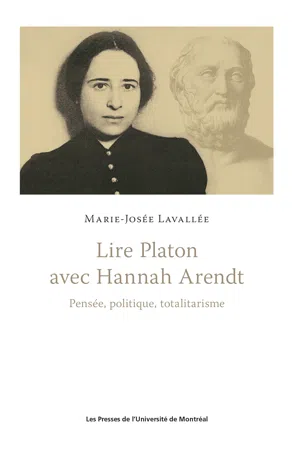![]()
Chapitre 1
Introduction à une lecture
Hannah Arendt figure au nombre des intellectuels de Weimar qui ont trouvé refuge aux États-Unis au temps du nazisme. Évoquant tout à la fois l’esprit novateur de la culture weimarienne et le naufrage de ses institutions parlementaires, ces intellectuels ont exercé une véritable fascination outremer. Porteurs de diverses traditions européennes, ils ont fait souffler un vent de renouveau sur les milieux académiques américains. Ces philosophes et théoriciens politiques ont contribué à y faire connaître la pensée allemande depuis l’idéalisme, mais ils y ont aussi disséminé des traditions philosophiques et littéraires plus anciennes, celles de l’Antiquité.
Les intellectuels allemands de cette génération ont baigné dès leur jeunesse dans la culture classique, lors de leur passage au Gymnasium, un type d’institution d’éducation secondaire dont les curricula comportaient une sérieuse initiation aux langues et cultures de l’Antiquité. La fréquentation de ces écoles, au tournant du XXe siècle, demeurait un marqueur de statut social pour les jeunes gens issus des milieux bourgeois et de la classe moyenne éduquée, et la voie privilégiée pour accéder à des postes étatiques, et ce, bien que ce modèle d’éducation ait déjà amorcé son déclin. Les jeunes Allemands éduqués au Gymnasium assimilaient très tôt tout un répertoire de références issues de la philosophie et de la littérature classiques, auquel plusieurs allaient puiser plus tard, à l’instar d’Arendt. Cette éducation a pu éveiller un amour précoce pour l’Antiquité, encore cultivé par la poursuite d’études supérieures en philosophie ou en théologie. L’éducation et la culture américaines ont aussi connu un «moment classique» entre la fin du XVIIIe siècle et le tournant du XXe siècle, mais celui-ci n’a aucune commune mesure avec l’engouement allemand pour la Grèce antique. Le vocabulaire grec et latin, de même que les motifs empruntés à l’Antiquité sont omniprésents chez l’intelligentsia allemande durant les premières décennies du XXe siècle, et ce, pas uniquement chez les philosophes: ils sont bien attestés dans les sciences sociales et la psychanalyse, par exemple. Hannah Arendt et certains de ses collègues émigrés aux États-Unis, tels Eric Voegelin et Leo Strauss, réputés pour avoir renouvelé la pensée politique contemporaine en s’inspirant de l’ancien, sont de dignes représentants de cette tendance. La pensée antique est le point de départ d’une réflexion sur leur propre temps.
Hannah Arendt était une admiratrice sérieuse de la Grèce antique, d’abord découverte au Gymnasium, puis dans les écrits de Platon et d’Aristote, auprès de Martin Heidegger, et enfin sous les plumes des grands historiens de son époque: Fustel de Coulanges, Jakob Burckhardt, Ulrich von Wilamowitz-Moellendorf et Werner Jaeger. Son intérêt pour la Grèce n’a jamais été strictement scolaire. Initiée au grec dès l’âge de douze ans, époque où elle puise dans la bibliothèque de classiques grecs et latins constituée par son père, elle cultivera un amour pour les textes originaux qui perdurera jusqu’à la toute fin de sa vie. À différentes époques, elle participe à des cercles de traduction de grec, d’abord lors de ses études secondaires, puis au temps de ses études universitaires à Fribourg, enfin, à New York, à l’époque de son œuvre mature. En 1925, elle lit Platon en grec.
Découverte et redécouverte de Platon
Une fois complétées ses études secondaires au Gymnasium de Königsberg et passé l’Abitur, Hannah Arendt amorce des études de théologie, pour se tourner ensuite vers la philosophie, à Fribourg. Elle y fait une rencontre déterminante, celle de Martin Heidegger. Celui-ci lui fait découvrir Platon, dans le cadre de son séminaire sur Le Sophiste, en 1925. Aujourd’hui publié, le texte de ce cours est précieux non seulement pour comprendre certaines lignes directrices du rapport de Heidegger à Platon, qui a évolué entre ce moment et les années 1940, mais aussi pour analyser différents aspects de la réception de Platon chez Arendt. En 1966, Arendt écrit à Heidegger que «ses pensées retournent sans cesse au séminaire sur le Sophiste», commentaire témoignant de l’empreinte durable laissée par Heidegger, et le Platon présenté dans ce cours, sur la réflexion arendtienne. Karl Jaspers a relevé dès 1956, l’importante dette contractée par Arendt à l’égard des interprétations heideggériennes, avec lesquelles il était en désaccord. Dans un séminaire présenté en 1960, «Political Philosophy or Philosophy and Politics», Arendt déclarait sa préférence pour l’approche de Platon développée par Heidegger, lequel est «préoccupé uniquement par ce qui préoccupait Platon», à celles de Leo Strauss et Eric Voegelin, qui, estime-t-elle, «croient que la tradition est valide», ou encore, à celle de Werner Jaeger qu’elle cite pourtant souvent dans ses écrits.
Durant plus de deux décennies, Arendt délaissera la philosophie, notamment sous l’effet de la radicalisation du climat politique et social en Allemagne au tournant des années 1930. Après avoir soutenu sa thèse de doctorat sur le concept d’amour chez Augustin, préparée sous la direction de Jaspers, elle s’intéresse de plus près à la question juive, s’engage dans l’activisme sioniste et s’adonne à un journalisme engagé. Ce sera le cas durant toute la période de son exil, qui débute en 1933. Une fois installée aux États-Unis, dont elle devient citoyenne en 1941, elle rédige une série d’articles sur la situation des Juifs et des camps, lesquels servent de matière première au désormais classique The Origins of Totalitarianism.
Ce livre l’a confrontée à une série de questions fondamentales, éthiques et politiques, qu’elle entreprend d’explorer une fois la rédaction complétée, en 1950. Cette année est cruciale: elle consacre le retour d’Arendt à la philosophie – à laquelle elle dira toujours préférer la théorie politique – et sa redécouverte des Grecs et de Platon. L’année 1950 est aussi celle de sa réconciliation avec Heidegger, avec lequel elle avait rompu tout lien en 1933, époque de son ralliement au nazisme. Elle lui pardonnera cette «grosse bêtise», selon l’expression qu’il a forgée lui-même, sans pour autant l’oublier. Outre les motivations théoriques de l’intérêt d’Arendt pour Platon, ses retrouvailles avec Heidegger, survenues en début d’année, n’y sont probablement pas étrangères. Ses rencontres avec celui-ci ont pu éveiller chez elle le souvenir du Heidegger d’avant le nazisme, du séminaire sur le Sophiste, du maître à penser, mais aussi de l’amoureux éphémère, et rappeler Platon à son bon souvenir. Arendt et Heidegger entretiendront toute leur vie des sentiments particuliers l’un pour l’autre, dont témoignent leurs lettres. En octobre 1950, Arendt annonce à Jaspers qu’elle relit Platon et que «son grec revient doucement». Heidegger évoque ce retour dans une lettre du 18 décembre 1950, où il écrit qu’il est «parvenu, tout comme elle, aux Grecs en empruntant plusieurs chemins». En 1954, année où Arendt présente les premiers travaux dans lesquels elle critique Platon, lors de conférences à l’Université Notre Dame (dont est issu le texte publié posthume «Philosophy and Politics»), Heidegger écrit qu’il aimerait beaucoup revoir ses écrits sur Platon, notamment le séminaire sur le Sophiste, et lire de nouveau les dialogues.
Bien qu’Arendt ait souhaité discuter de Platon avec lui, elle ne semble pas en avoir eu l’opportunité, Heidegger ne prêtant jamais l’oreille à ses préoccupations philosophiques, s’est-elle plainte à Jaspers. Leur correspondance ne comprend d’ailleurs aucun échange sérieux à ce sujet. Arendt a néanmoins continué de suivre le fil de la réflexion de Heidegger autour de Platon. D’abord, dans le tristement célèbre discours du rectorat de 1933, que connaissait Arendt: cette allocution était ponctuée de références directes ou obliques à la République. Elle a parfois eu accès à des transcriptions de cours donnés par Heidegger, au moyen de notes prises par des étudiants, mais il n’est pas certain que ç’ait été le cas de ses cours des années 1930 sur Platon, parus de manière posthume sous le titre Vom Wesen der Wahrheit: Zu Platons Höhlengleichnis und Theätet. En revanche, elle cite dans ses écrits l’essai inspiré de ces cours, publié en 1942 sous le titre «Platons Lehre von der Wahrheit». Les positions théoriques qu’y défend Heidegger diffèrent grandement des cours dont il est inspiré. Il a changé d’avis sur le statut de la vérité, une question non moins cruciale pour son interprétation de Platon que pour sa philosophie en général. Heidegger a mis en avant, tour à tour, deux conceptions de la vérité, dont on trouve des traces dans la lecture arendtienne de Platon, mais aussi dans la pensée politique d’Arendt. La «tyrannie de la vérité» qu’elle attribue à Platon est compatible avec la conception que Heidegger prête au philosophe grec en 1942, celle de la vérité comme orthotès. Celle-ci résulte de l’homoiosis, qui consiste en «un accord de la connaissance et de la chose elle-même». L’orthotès consacre la prééminence de l’idea et de l’idein sur l’aletheia: Platon est tenu responsable de la disparition de ce second type de vérité, que Heidegger lui attribuait durant les années 1930. La vérité comme orthotès est centrale aux discussions d’Arendt sur les Idées platoniciennes et sur la politique de la poiesis, thématique à laquelle est consacré le chapitre 6. Quant à l’aletheia, qui signifie non-voilement, Heidegger commençait à façonner cette conception de la vérité dès les années 1920. Elle s’infiltre dans la description arendtienne des examens socratiques, puis elle est sous-jacente au critère d’apparence qu’elle impose à l’action, la parole et l’opinion. Ces deux conceptions concurrentes de la vérité signalent la présence, chez Heidegger, de deux Platon. Nous rencontrons une dualité similaire chez Arendt: son Platon politique et son Platon éthique correspondent, resp...