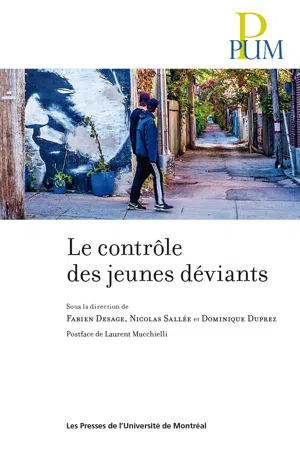![]()
1. Approches savantes et approches politiques
de la délinquance juvénile:
des liaisons dangereuses
Gérard Mauger
Si, dans la perspective de Durkheim (1900), «nous appelons crime tout acte puni», le crime ainsi défini est indissociable de la peine (comme, par extension, la déviance l’est de la stigmatisation), c’est-à-dire de la «réaction sociale» et du contrôle qu’elle induit. De ce point de vue, la déviance étant inséparable du contrôle social, l’étude de la sociogenèse des déviances, qui constitue l’objet des théories de la délinquance, est elle-même liée à celle du contrôle social. La perspective de Foucault (1975) prend acte de ces connexions entre les dispositifs de coercition et les éléments de savoir correspondants. Dans ce cadre, savoir et pouvoir sont inséparables: ils s’impliquent directement l’un l’autre: «il faut constater, écrit Foucault, que le pouvoir produit du savoir; que pouvoir et savoir s’impliquent directement l’un l’autre; qu’il n’y a pas de relations de pouvoir sans constitution corrélative d’un champ de savoir, ni de savoir qui ne suppose et ne constitue en même temps des relations de pouvoir». C’est dire que, dans la perspective de Durkheim comme dans celle de Foucault, les approches savantes de la délinquance ont partie liée avec les approches politiques qui les permettent et s’en inspirent.
Pour présenter ces approches savantes de la délinquance juvénile, on pourrait adopter la perspective ouverte par la sociologie et l’histoire des sciences: de façon générale, il s’agirait, dans ce cadre, de rapporter ces approches savantes à leurs conditions historiques, sociales et institutionnelles de production. Plus classiquement, on pourrait également les exposer dans la logique de la dissertation ou du manuel en les ordonnant en fonction des paradigmes concurrents, quitte à devoir introduire des clivages plus ou moins factices entre des travaux présentés comme emblématiques d’une «école». J’adopterai successivement ces deux perspectives, mais sans pouvoir tenir tout ce qu’elles promettent. Plutôt qu’une ébauche de sociohistoire des approches savantes, j’essaierai d’indiquer, en effet, quelques-uns des problèmes qu’elle soulève. Plutôt qu’un exposé académique des théories de la délinquance juvénile dans toute leur extension, j’essaierai d’énoncer les grandes lignes de ce que pourrait être un paradigme commun, moins soucieux d’accentuer les clivages que d’identifier les perspectives similaires ou complémentaires. Il s’agira en quelque sorte de prendre au pied de la lettre la métaphore de «la boîte à outils théoriques» dans une perspective cumulative qui s’efforce de tirer parti de la loi des lucidités et cécités croisées: ce qu’un «point de vue» permet de voir condamne presque toujours à ne pas voir ce qui pourrait l’être en changeant de «point de vue».
Pour une sociohistoire des approches savantes
Le problème de la délinquance juvénile est socialement construit par la coopération ou la concurrence entre différentes catégories d’interprètes ou de «réparateurs» qui proposent différentes modalités de définition, de qualification, de construction théorique du problème et différentes formes de prise en charge. Ces interprètes ou réparateurs appartiennent à différents champs, plus ou moins autonomes, ou à différentes professions plus ou moins indépendantes. Comme le note Durkheim (1930), plus leurs fonctions se rapprochent, plus elles sont appelées à se combattre: satisfaisant par des moyens différents à des besoins semblables, il est inévitable qu’elles cherchent à empiéter les unes sur les autres. C’est une situation de ce genre qu’avait étudiée Robert Castel (1973) à propos du «cas Pierre Rivière» présenté par Michel Foucault («Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère…»). Le dossier constitué permettait de prendre la mesure de «la concurrence que se livraient les instances pénale et médicale» au cours de la première moitié du XIXe siècle en France et de son enjeu: «substituer partiellement un mode de contrôle à un autre». De façon générale, «les professions similaires se font une concurrence d’autant plus vive qu’elles sont plus semblables», concluait Durkheim (1930). C’est dans cette perspective que s’inscrit la sociologie des professions du sociologue américain Andrew Abbott (1988). Selon lui, les professions sont des «groupes de métiers appliquant un savoir abstrait à des cas concrets». Le «système des professions» est le système formé par les professions engagées dans la lutte pour les «territoires». Le pouvoir professionnel réside dans la capacité à maintenir le contrôle d’un territoire, c’est-à-dire dans le pouvoir de définir un problème, de faire reconnaître la validité de ses traitements, de se soustraire à la comparaison, de s’allier aux élites dirigeantes et d’obtenir le soutien de l’État. Initialement, selon Abbott, l’efficacité des solutions proposées détermine in fine la délimitation des territoires, mais, 15 ans plus tard, il insiste surtout sur le poids de l’État dans l’issue des luttes pour la reconnaissance.
En ce qui concerne la délinquance juvénile, on peut schématiquement distinguer trois catégories de professionnels engagés (interprètes et réparateurs) – juristes, médecins et sociologues – ou plutôt trois «champs» – juridique, médical, sociologique – dont il faudrait étudier les rapports et qui sont eux-mêmes traversés par des luttes de concurrence internes. Trois champs dont il faudrait également étudier les relations avec le champ bureaucratique, le champ politique et le champ médiatique. Faute de pouvoir esquisser ici une véritable sociohistoire des approches savantes et politiques de la délinquance juvénile, j’indiquerai les grandes lignes d’une périodisation possible de l’histoire de ces approches, j’ébaucherai ensuite l’étude de leur circulation entre les États-Unis et la France et j’indiquerai enfin deux principes d’intelligibilité de leurs rapports de force.
Des éléments pour une histoire de l’approche savante
En 1885, Garofalo rassemble l’ensemble des approches savantes du crime (sociologie, psychologie, psychiatrie, histoire, droit, médecine, police technique, anthropologie) sous l’appellation de «criminologie». Selon Foucault (1975), l’apparition de cette nouvelle discipline illustre de façon idéal-typique la naissance des sciences humaines: «un savoir, des techniques, des discours scientifiques se forment et s’entrelacent avec la pratique du pouvoir de punir». Au cours des années 1880-1914, la médecine, sous ses différentes formes (anatomie pathologique, aliénisme, médecine légale, hygiène publique) domine les «sciences du crime», mais des tensions se font jour entre déterminisme anatomopsychologique et philanthropie. La «sociologie criminelle» apparaît au tournant du siècle avec la psychosociologie de Tarde et le mouvement durkheimien qui, revendiquant l’explication du social par le social, rompt avec la vision biomédicale qui dominait le XIXe siècle. Au conflit initial entre psychologie et sociologie, c’est-à-dire aussi entre Tarde et Durkheim, succède en France un modus vivendi fondé sur un partage du territoire (au sens de Abbott). Ainsi, selon Henri Lévy-Bruhl (1963), l’objet de la criminologie (son «territoire») est double: le criminel et le crime. S’il concède l’étude des criminels à la biologie et à la psychiatrie, celle du crime revient à la sociologie. La coexistence entre disciplines rivales peut également s’opérer dans le registre de l’interdisciplinarité. Selon Philippe Robert (1973), la «volonté de synthèse entre psychologie et sociologie» est «latente dans toute la sociocriminologie du passage à l’acte» qu’il oppose à la «sociologie de la réaction sociale». Mais l’interdisciplinarité n’exclut pas nécessairement le partage du territoire. Selon Laurent Mucchielli (2004), on assisterait aujourd’hui à une sorte de partage implicite des objets: aux sociologues reviendraient les grandes enquêtes, la délinquance juvénile ordinaire et la délinquance des élites, les politiques publiques, les institutions pénales, etc., aux psychologues, les crimes de sang, les affaires sexuelles et l’expertise individuelle (les toxicomanes faisant figure, dans ce cadre, d’objet interdisciplinaire). Si ces approches savantes doivent quelque chose à la concurrence qui les oppose dans l’hexagone, on ne saurait en rendre compte sans montrer ce qu’elles doivent à la circulation internationale des idées.
De la circulation internationale
des approches savantes
Si l’on s’en tient aux approches sociologiques dans le contexte français, il apparaît que les théories de la délinquance juvénile en vigueur doivent beaucoup aux théories «étatsuniennes»: d’où l’importance d’une étude de leur importation et de leur réception.
La vitalité de la recherche sociologique sur la délinquance juvénile aux États-Unis semble liée à la pérennité d’une demande institutionnelle. Le panorama établi par Nicolas Herpin (1973) distingue quatre paradigmes: celui de l’École de Chicago (associé au concept de «désorganisation»), le «culturalisme» (associé au concept de «sous-culture»), le «fonctionnalisme» (associé au concept d’«anomie») et l’«interactionnisme» (associé au concept de «réaction sociale»). Ces paradigmes sont aujourd’hui «dépassés» selon Renaud Fillieule (2001) par le paradigme «actionniste» de Gottfredson et Hirschi (1990): «l’acteur rationnel» fait alors son entrée en sociologie de la délinquance. Cette remise en cause procéderait à la fois d’un progrès de l’instrument de mesure et d’une transformation morphologique du phénomène mesuré. D’une part, les enquêtes par autorévélation auraient remis en cause la corrélation entre pauvreté et délinquance. D’autre part, la croissance de la délinquance sous toutes ses formes dans la plupart des pays occidentaux à partir des années 1960 (c’est-à-dire dans une période où la croissance était forte et le chômage bas) resterait une énigme pour les théories culturalistes de la délinquance. Ce nouveau paradigme porte à conséquences politiques: il inspire les techniques de «prévention situationnelle» (il s’agit de rendre le passage à l’acte moins rentable et plus risqué), «la théorie de la vitre cassée» de Wilson et Kelling et la mise en place d’une «police de proximité». Schématiquement, le raisonnement est le suivant: une vitre se brise, progressivement les murs se couvrent de graffitis, peu à peu se dégage du site une impression d’impunité favorable à la déviance et à la délinquance, le sentiment d’insécurité s’installe, la «spirale du déclin» est engagée, la valeur des logements diminue, l’abandon et le délabrement des lieux en font un site propice aux agressions.
Comment rendre compte de la fortune étatsunienne, puis européenne, de ce paradigme actionniste? Ses partisans mettent en avant des raisons proprement scientifiques, comme sa capacité supposée à expliquer la croissance de la délinquance sous toutes ses formes ou la remise en cause de la corrélation entre pauvreté et délinquance par les enquêtes par autorévélation. Mais on peut aussi se demander ce qu’elle doit aux transformations du champ intellectuel (en particulier, à l’ascendant pris par l’économie néoclassique qu’illustre le retour en force, avec Gary Becker [1968], de la théorie de l’action rationnelle) et ce qu’elle doit aux transformations du champ politique (en particulier, au désenchantement vis-à-vis des programmes de «traitement» des délinquants et au déplacement de l’intérêt politique vers le «sentiment d’insécurité»). Le paradigme actionniste propose des solutions diamétralement opposées, mais qui reposent sur un même postulat utilitariste: renforcer les sanctions (pour accroître les coûts anticipés de la délinquance) et renforcer les contrôles (pour réduire les opportunités de pratiques délinquantes).
Si l’on revient au cadre hexagonal, comment décrire l’état des rapports de force entre approches savantes de la délinquance juvénile? Le vénérable «paradigme multifactoriel» (celui de la sociologie du «passage à l’acte») semble disparu des sciences sociales en même temps que le CRIV (Centre de recherches interdisciplinaires de Vaucresson), mais il reste dominant dans les univers professionnels liés au crime (police, justice, travail social). Quant à la recherche, elle s’est déplacée vers l’étude de «la réaction sociale» importée des États-Unis au début des années 1970 par Philippe Robert (1979): le Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales (CESDIP) a joué ici un rôle central. Pour rendre compte de la fortune du paradigme interactionniste, on peut mettre en avant des intérêts proprement scientifiques. Le déplacement qu’il induit de l’enquête des délinquants vers le système pénal-judiciaire facilite non seulement l’accès au terrain, mais il élève surtout l’objet de recherche dans la hiérarchie des objets scientifiques, plus ou moins décalquée sur celle de leur dignité sociale.
Mais sans doute faut-il tenir compte aussi d’intérêts politiques. Comme le note Howard Becker (1963), les théories de l’étiquetage «mettent en cause la moralité conventionnelle en refusant délibérément d’accepter sa définition de ce qui est ou de ce qui n’est pas déviant» et rencontrent ainsi l’horizon d’attente contestataire de l’époque, «l’humeur anti-institutionnelle» post-soixante-huitarde qui s’était étendue, avec la création du GIP (Groupe d’information sur les prisons) à l’univers carcéral et au travail social. Dans ce contexte, la publication de Surveiller et punir par Michel Foucault (1975) contribuait à l’anoblissement de l’objet et déplaçait l’intérêt savant des pratiques délinquantes vers la critique de «la carcéralité». «Il y a dans la justice moderne et chez ceux qui la distribuent une honte à punir, écrit Foucault (1975). […] Par l’effet de cette retenue nouvelle, toute une armée de techniciens est venue prendre la relève du bourreau […]: les surveillants, les médecins, les aumôniers, les psychiatres, les psychologues, les éducateurs».
Comment comprendre enfin le revival de la sociologie de la délinquance juvénile au cours des dix dernières années? Outre que la focalisation de l’intérêt médiatique et politique sur «les jeunes des cités», avec l’irruption des «violences urbaines» et «la montée du sentiment d’insécurité», ne pouvait manquer d’attirer l’attention des sociologues, l’émergence d’une jeune génération de chercheurs issus de «ces banlieues dont on parle» permet de comprendre l’essor des travaux ethnographiques (lié à leur plus grande facilité d’accès au terrain) et leur «éclectisme théorique paisible» par rapport aux polémiques antérieures et aux termes de la controverse (sociologie du passage à l’acte/sociologie de la réaction sociale).
Des rapports entre approches savantes
et approches politiques
Une analyse, même sommaire, de la réception des approches savantes – qu’il s’agisse du paradigme actionniste ou du paradigme interactionniste – montre ce qu’elle doit aux solutions politiques qu’elles impliquent ou qui en sont déduites. De façon générale, il faudrait étudier les rapports entre représentations savantes, politiques, professionnelles, médiatiques et profanes, mettre en évidence la place des approches savantes dans la formation des professionnels responsables du problème de la délinquance, analyser le rôle des théories dans l’inspiration des politiques publiques ou dans leur légitimation, étudier la contribution des sciences sociales à la mise en scène des représentations médiatiques, analyser l’appropriation de ces représentations par les profanes. Je m’en tiendrai ici à l’énoncé de deux principes d’intelligibilité des rapports entre approches savantes et approches politiques.
L’opposition entre liberté et déterminisme confronte les juristes aux médecins et les sociologues entre eux. Pour les juristes, qui défendent le dogme de l’autonomie de la volonté (Beccaria), les individus sont maîtres de leurs décisions et doivent être considérés comme pleinement responsables de leurs actes. À l’inverse, les médecins mettent l’accent sur «les conditionnements de l’activité humaine»: c’est ainsi l’imputation de la responsabilité qui permet à Freidson (1984) de distinguer la maladie du crime, c’est-à-dire des «actes déviants dont les gens sont tenus pour responsables ou dont ils doivent rendre compte». Cette opposition divise également les sociologues. C’est cette opposition – transfigurée – que retient, par exemple, Albert Ogien en distinguant «les théories causales de la déviance» («déterministes») et «les théories compréhensives de la déviance» (qui ménagent une place à la liberté des «acteurs»). Cette opposition porte à conséquences. L’antidéterminisme (propre en particulier aux «théories actionnistes» qui analysent la délinquance comme un choix rationnel orienté par une intention d’enrichissement) implique la responsabilité de «l’acteur», alors que le déterminisme l’en exonère. De façon générale, selon Fillieule (2001), les théories actionnistes sont solidaires des «politiques de dissuasion pénale», les théories multifactorielles, des «politiques de neutralisation», les théories classiques, des «politiques de réhabilitation». L’opposition entre «causes sociales» et «causes individuelles» confronte, au sein des théories dites «déterministes» (ou «positivistes»), ceux qui considèrent que la délinquance est due à une «nature criminelle» (Lombroso) ou à des «défauts de la personnalité» à ceux qui (dans la tradition de Guerry, Quételet, Ducpétiaux, Buret, Engels) l’attribuent à des «habitudes criminelles» liées aux conditions d’existence de certains groupes, donc aux structures sociales. Là où les premiers sont partisans de politiques de neutralisation des criminels, les seconds proposent une prise en charge psychothérapeutique alors que les troisièmes attendent la diminution (ou la disparition) de la délinquance de l’évolution (ou de la révolution) des structures sociales.
Un inventaire raisonné
des schèmes d’interprétation sociologiques
En retraçant quelques-uns des problèmes que devrait aborder une sociohistoire des approches savantes, j’ai été conduit à mentionner les principes de classement usuels de ces approches. Je voudrais y revenir en me limitant aux théories sociologiques de la délinquance et en proposant, de façon un peu iconoclaste, une mise en ordre délibérément cumulative. Il est vrai que cette démarche suppose des interprétations «libres» et des réinterprétations «orientées», mais elle procède d’abord d’une volonté de rupture avec les tactiques les plus éprouvées de la concurrence au sein des mondes savants, qui orientent plus ou moins explicitement la vision synchronique ou diachronique proposée des théories par rapport à la position de celui qui l’énonce et prétend «dépasser» ses concurrents. Revendiquant un éclectisme soumis à l’épreuve de l’enquête et du contrôle logique, cette mise en ordre abordera six problèmes privilégiés par telle ou telle approche, mais auxquels toute ambition d’interprétation sociologique est nécessairement confrontée.
Les territoires de la délinquance
Comment rendre compte de la localisation géographique des pratiques délinquantes? Thrasher (1927), puis Shaw et McKay (1942) ont montré qu’elles se sont développées à Chicago dans des espaces intermédiaires entre le centre administratif et commercial et la périphérie résidentielle où s’établissent les Noirs qui fuient le sud du pays et l’immigration récente et que les changements de population n’ont jamais modifié la nature «criminogène» de ces quartiers. De façon générale, les pratiques délinquantes se développent dans les sites délaissés par tous ceux qui sont en mesure de les fuir. Ainsi peut-on rendre compte à la fois de la pérennité des sites de la délinquance en dépit des changements de leur composition ethnique, de la mixité ethnique des bandes délinquantes (les relations de voisinage priment sur l...