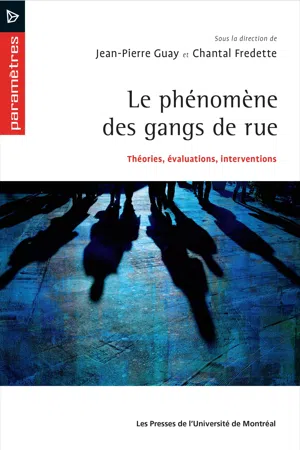![]()
Chapitre 1
Définir, classifier et mesurer
Jean-Pierre Guay, Chantal Fredette
et Sébastien Dubois
L’image actuelle des gangs de rue au Québec tire son origine d’une série d’événements violents qui leur sont attribués à la fin des années 1990 et qui ont mené à plusieurs opérations policières. Jumelés à un traitement médiatique important, ces incidents ont propulsé à l’avant-scène ce phénomène, jusque-là considéré comme de la petite délinquance, ne touchant que certains quartiers de Montréal et associé aux difficultés d’intégration des immigrants.
Aux États-Unis, les préoccupations relatives aux gangs de rue remontent au début du 20e siècle. L’intérêt porté au phénomène au Canada et au Québec est beaucoup plus récent. Jusqu’au début des années 2000, les chercheurs et les intervenants canadiens et québécois étaient davantage préoccupés par les groupes traditionnellement associés au crime organisé. Depuis, les gangs de rue attirent de manière croissante l’attention du public, ce qui perturbe le sentiment de sécurité. Les pressions exercées sur les décideurs et les organisations responsables de la répression sont nombreuses. Cet intérêt accru s’explique, entre autres, par le fait que les membres de gangs sont de grands producteurs de crimes, notamment de délits violents.
La contribution de l’association aux gangs à la production de la délinquance est largement admise en criminologie. Néanmoins, les mécanismes qui sous-tendent cette relation font encore l’objet de nombreux débats. Une partie des difficultés est attribuable aux problèmes de définition. S’ils peuvent apparaître secondaires, ces problèmes ont un impact direct sur la mesure de l’ampleur du phénomène et de ses manifestations. À l’évidence, ils remettent en question la qualité des données recueillies, ce qui mène à différentes dérives en ce qui concerne les politiques et les interventions.
Définir et mesurer les gangs de rue
À l’heure actuelle, un des seuls consensus concernant la question des gangs de rue est qu’il n’existe pas d’unanimité quant à la façon de les définir. Il n’existe pas non plus de méthode commune pour identifier leurs membres. À première vue, l’utilité réelle d’une bonne définition peut sembler triviale. Pourtant, il est difficile de proposer une définition cautionnée par l’ensemble des intervenants préoccupés par la question, et ce, même après 80 ans d’efforts suivant la toute première proposée par Frederic Thrasher (1927). Les défis sont nombreux pour quiconque tente de proposer une définition consensuelle.
La capacité d’une bonne définition à circonscrire adéquatement le phénomène figure parmi les principaux problèmes. Elle devrait permettre de couvrir l’ensemble des manifestations, sans toutefois en sous-évaluer ou surévaluer l’importance. De la même façon, la définition d’un membre devrait permettre de correctement identifier les personnes qui le sont, sans toutefois inclure les gens qui partagent des similitudes avec eux, mais qui ne correspondent pas aux critères d’identification. En d’autres termes, la définition doit correspondre au maximum de vrais positifs, c’est-à-dire les vrais membres. Une définition dont les critères seraient trop restrictifs mènerait à une sous-évaluation du phénomène (faux négatifs), alors qu’une autre aux critères trop vagues laisserait croire à un trop grand nombre de gangs ou de membres (faux positifs).
Une partie des difficultés à proposer une définition utile est liée au fait que la notion de gang et de membre est chargée des représentations populaires. Pour certains, ce concept nord-américain devient même difficilement transposable à d’autres contextes socioculturels (Matsuda et coll., 2012). De plus, la diffusion médiatique de la culture de gang a permis à celle-ci de s’intégrer à une culture plus générale, notamment celle des adolescents qui sont de plus en plus nombreux à adopter le style vestimentaire ou certaines attitudes typiquement liés aux gangs. La définition du gang et le processus d’identification des membres doivent donc tenir compte de ce phénomène de mimétisme, en plus d’offrir les moyens de distinguer le membre de l’adolescent commun.
L’exercice de proposer une définition consensuelle et des critères d’identification des membres est difficile. Les multiples propositions souffrent plus du fait de leur imprécision menant à la surévaluation de l’ampleur du phénomène que de critères trop restrictifs. Une telle surévaluation peut avoir de nombreux impacts, dont la surestimation de la présence des gangs de rue, qui joue sur le sentiment de sécurité de la population. Elle a aussi pour effet d’orienter les politiques concernant le contrôle et la répression. Un bon exemple de définition surinclusive est cité en exemple par Klein et ses collègues (2001). En 1995, un sondage mené par le National Youth Gang Center dénombrait 30 818 gangs aux États-Unis et près de 846 428 membres. La définition utilisée était: «A group of youths or young adults in your jurisdiction that you or other responsible persons in your agency or community are willing to identify or classify as a ‘gang’». Sur cette base, 24% des répondants ont inclus dans leur estimation les groupes sataniques et 58% les graffiteurs. Une telle définition ne permettait pas de diriger l’attention du répondant vers le phénomène initialement envisagé.
Pour contrer les problèmes de sous et de surreprésentation, Klein et Maxson (2006) proposent de différencier les éléments définitionnels des éléments descriptifs. En d’autres termes, les chercheurs et les théoriciens devraient distinguer les critères nécessaires de ceux qui sont utiles. Les éléments définitionnels sont décrits comme minimaux et nécessaires, alors que les éléments descriptifs permettent de qualifier les groupes. Par exemple, le caractère illégal des activités d’un groupe constitue sans l’ombre d’un doute un élément définitionnel. Un gang de rue ne saurait en être un s’il n’était pas impliqué dans des activités illégales. En contrepartie, les éléments concernant le port de signes distinctifs peuvent être utiles sans toutefois être nécessaires. Contrairement au caractère illégal des activités, on verrait bien un gang de rue ne pas partager ou exhiber de symboles de reconnaissance. Les éléments descriptifs ne sont donc pas distinctifs, mais ils permettent d’apprécier les différences entre les différents groupes. Pour Klein et Maxson (2006), une bonne définition ne devrait donc contenir que des éléments définitionnels et éviter de recourir aux éléments descriptifs.
L’inclusion d’éléments descriptifs peut poser un certain nombre de problèmes. Au Québec, on se réfère généralement à la définition du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), laquelle fut révisée en 2003 conjointement avec le ministère de la Sécurité publique du Québec. La définition proposée va comme suit: «Le gang de rue est un regroupement plus ou moins structuré d’adolescents et de jeunes adultes qui privilégient la force et l’intimidation du groupe pour accomplir des actes criminels, et ce, dans le but d’obtenir pouvoir et reconnaissance ou de contrôler des sphères d’activités lucratives».
En regard des travaux de Klein et Maxson (2006), une telle définition, si utile soit-elle pour les autorités policières et gouvernementales, pose un certain nombre de problèmes. En effet, l’inclusion de différents éléments descriptifs (structure, but allégué et moyens privilégiés) fait en sorte qu’elle peut s’avérer surinclusive ou sous-inclusive selon les circonstances. Un groupe répondant à l’ensemble des critères mais sans réelle structure ne pourrait dans ce contexte être qualifié de gang de rue, alors qu’un groupe formé spontanément ou éphémère le pourrait. Si les constituants de cette définition ne tiennent pas compte des propositions de Klein et Maxson, ils posent aussi un certain nombre de difficultés relatives à l’utilisation et à la fidélité des critères. En effet, certains critères sont libellés de manière floue (on n’a qu’à penser au «regroupement plus ou moins structuré » ou au fait qu’il est particulièrement complexe d’inférer la motivation sous-jacente aux activités d’un groupe).
Le défi consisterait donc à documenter les éléments définitionnels, et à les distinguer des descriptifs. Après plusieurs tentatives d’élaboration d’une définition qui se voulait consensuelle, Klein et Maxson (2006, p. 4) proposèrent la définition suivante: «A street gang is any durable, street-oriented youth group whose involvement in illegal activity is part of its group identity». Les cinq composantes (pérennité, lien à la rue, jeune âge des membres, caractère illégal des activités et identité commune) constituent des éléments définitionnels nécessaires et suffisants. D’autres caractéristiques, comme le type de leadership, la cohésion, la composition du groupe en ce qui concerne le sexe ou l’appartenance ethnique, au même titre que l’argot, les vêtements, les tatouages ou les signes de mains, sont des éléments descriptifs, mais qui ne sont pas essentiels.
L’utilité d’une définition
Il existe plusieurs avantages liés à l’adoption d’une définition précise, opérationnelle et consensuelle. D’un point de vue méthodologique, elle permet de s’assurer que les chercheurs de différents milieux, horizons théoriques ou régions géographiques s’attardent à un seul et même objet de recherche. Plus concrètement, une définition commune permet de comparer les résultats de travaux émanant de différents groupes de recherche. D’un point de vue pratique, une bonne définition offre aux divers intervenants (policiers, avocats, juges, cliniciens, etc.) à la fois un langage commun et un ancrage valide pour orienter leurs décisions. Elle pourrait permettre d’éviter les dérives de la sur-identification et d’éviter du même coup que des jeunes non membres subissent les conséquences d’une identification à un gang alors qu’ils n’en font pas partie. Les conséquences d’une telle identification sont en effet nombreuses, allant d’une peine plus sévère à une prise en charge pénale plus contraignante, en passant par un traitement différent.
Le gang comme entité complexe
Les gangs de rue sont, pour ainsi dire, une catégorie diagnostique aux contours flous, aux manifestations variées qui fluctuent dans le temps et dans l’espace et sur laquelle peu de gens s’entendent. Même en présence d’une définition conceptuellement solide, le phénomène est marqué par sa grande hétérogénéité. Pour Platon, l’homme a depuis toujours tenté de comprendre son monde selon la nature même des choses, à l’organiser en fonction des catégories naturelles, voire à le découper à ses «articulations naturelles». Le recours au mécanisme par lequel on organise les personnes, les événements ou les endroits en catégories signifiantes vient tout naturellement. C’est une stratégie qui permet d’appréhender un phénomène complexe de manière généralement efficace. L’utilisation de la classification est en fait une stratégie d’économie cognitive (Sokal, 1974): connaître quelques éléments du tableau dépeignant un gang ou un membre permet d’extrapoler sur la dynamique de l’un ou de l’autre. Si la classification est omniprésente en sciences naturelles, elle l’est tout autant en sciences sociales. Il est difficile de ne pas se référer à un moment ou à un autre à un système classificatoire lorsqu’on étudie les comportements de déviance et de délinquance. La littérature est jalonnée de travaux sur la classification des gangs et de leurs membres.
Le recours à la classification est une stratégie cognitive offrant bon nombre d’avantages. Dans le cas des gangs de rue, elle peut permettre de mieux étudier les facteurs contribuant au phénomène, de déterminer les sous-groupes les plus problématiques et les interventions à préconiser en fonction de leurs dynamiques, de faciliter la prise de décision et de favoriser la communication entre les intervenants. De plus, l’usage de tels outils permet une économie importante d’énergie et de temps. Un nouveau groupe, s’il est classé dans un système valide, pourra faire l’objet d’une intervention efficace et ciblée en fonction de ses propriétés. Un nouveau membre à évaluer le sera plus efficacement, et sera orienté vers les stratégies d’action les plus prometteuses dans lesquelles les principaux écueils en matière de réadaptation pourront être évités.
En sciences sociales, les termes classification, typologie et taxinomie sont souvent utilisés de manière plus ou moins interchangeable. Le terme générique classification se réfère à la fois à une opération et à un système (Marradi, 1990). On peut organiser les opérations classificatoires en deux grandes familles: les systèmes monothétiques et les systèmes polythétiques (Brennan, 1987). Les systèmes monothétiques sont ceux dans lesquels la possession d’une seule caractéristique (classification) ou d’un ensemble restreint de caractéristiques (taxinomie) est nécessaire et suffisante pour faire partie de ce groupe. Par opposition, dans les systèmes polythétiques, aucun caractère ou ensemble restreint de caractéristiques n’est nécessaire et suffisant pour faire partie de ce groupe (typologie). En somme, on peut réduire le nombre de systèmes à trois: la classification, la taxinomie et la typologie.
La classification est une stratégie monothétique qui vise à utiliser une opération de subdivision fondée sur un critère unique (ex.: taille des groupes). Elle permet de produire la plus simple des structures, laquelle consiste en une liste de classes (on pourrait proposer une classification fondée sur le nombre de membres: petits groupes de 3 à 14 personnes, groupes moyens de 15 à 30 personnes et grands groupes de 30 personnes et plus). La classification a différentes qualités structurales qui lui sont propres. Elle permet généralement de produire des classes hermétiques ou mutuellement exclusives, souvent en désignant l’appartenance à une classe par la présence ou non d’un critère. L’identification de toutes les possibilités d’un critère est cependant quasi impossible, ce qui entraîne habituellement la création d’une catégorie résiduelle. L’exhaustivité ne peut être atteinte sans une telle catégorie puisque certaines unités n’appartiennent à aucune classe. Par exemple, un modèle visant à classifier les types de leadership peut exiger la création d’une catégorie «autres», à moins que le concepteur opte pour des catégories générales afin que tous les types de leadership puissent être classés. Dans ce cas cependant, le système souffrirait fort probablement de problèmes d’accord interjuges, c’est-à-dire que différents observateurs ne classeront pas les mêmes types de leadership dans les mêmes catégories.
La taxinomie, elle aussi monothétique, est fondée sur l’utilisation de plus d’un critère. L’utilisation de ces critères se fait de manière séquentielle, et l’ordre dans lequel les critères sont utilisés est crucial. Les modèles taxinomiques classiques en sciences naturelles sont ceux dans lesquels on trouve les genres, dans lesquels se retrouvent les espèces puis les variétés. Dans un système taxinomique, les variétés sont donc des variations des espèces, lesquelles sont des variations des genres. Une taxinomie hypothétique des gangs aurait pu être celle créée à l’aide de la taille du groupe et de l’appartenance ethnique des membres: un tel modèle permettrait de distinguer un certain nombre de sous-groupes fondés sur la taille au sein desquels on observerait différentes variantes fondées sur l’ethnicité. Bien que le système taxinomique laisse croire à l’identification d’entités fondamentalement distinctes en sciences naturelles (taxons), il n’en est pas de même dans les sciences sociales. En effet, la question de l’identification de catégories naturelles fait l’objet de plusieurs travaux, notamment en psychopathologie. À cet égard, les catégories naturelles, qui se réfèrent à des différences de nature et non pas d’intensité, sont peu nombreuses.
La dernière famille de stratégie classificatoire dérivée d’une stratégie agglomérative est la typologie. Elle est sans nul doute celle préconisée pour décrire les gangs de rue et leurs membres. La typologie est un système classificatoire polythétique. Lorsque plusieurs critères sont considérés simultanément, une typologie est produite et des types sont identifiés au lieu de classes. À cet égard, elle offre donc des prototypes aux frontières plus ou moins perméables plutôt que des catégories aux classes mutuellement exclusives. Pour contrer les problèmes liés à l’assignation des unités, des règles claires d’assignation doivent être développées. L’objectif de la typologie est d’organiser les unités selon des similarités perçues et ainsi de maximiser l’homogénéité au sein des types et les différences entre les types. Bien que le traitement simultané d’un grand nombre de critères soit attrayant, il est généralement préférable de concevoir le modèle à l’aide de stratégies d’analyses taxinomiques multivariées (Marradi, 1990). Ces dernières ont permis de combler certaines lacunes des typologies strictement théoriques, lesquelles sont souvent le fruit de l’observation et comportent un caractère spéculatif. L’avènement de la taxinomie numérique a certes permis d’étendre le nombre de variables utilisées pour concevoir les typologies, mais a posé le problème de la parcimonie. Bien que séduisante, la typologie n’est cependant pas sans limites. Parmi les plus importantes, on retrouve le fait que le passage d’une typologie émanant de la recherche à une utilisation quotidienne de celle-ci ne peut être possible sans la mise à plat de règles claires d’assignation des unités aux types. Plus simplement, les critères d’assignation doivent être clairement définis et les règles doivent être explicites pour déterminer à quel type chaque unité appartient, sans quoi la typologie est difficilement utilisable.
Plusieurs chercheurs en sont venus à proposer des systèmes classificatoires et des typologies théoriques des gangs et de leurs membres. Pour Klein et Maxson (2006), les typologies de gangs prennent généralement deux formes: celles fondées sur des éléments comportementaux et celles fondées sur des critères structuraux. Les premières organisent les types sur la base des profils de comportements et d’activités les plus communs. C’est dans ce cadre que certains chercheurs ont proposé différents types, comme le gang conflictuel, le gang violent ou le gang prédateur (Cloward et Ohlin, 1960; Huff, 1989; Yablonsky, 1970). Or, les typologies fondées sur les manifestations comportementales éludent une caractéristique propre à la majorité des gangs, soit le polymorphisme criminel (Klein et Maxson, 2006). Les typologies fondées sur des critères structurels proposent quant à elles d’organiser les types de groupes en fonction de leurs caractéristiques sociales. Dans cette perspective, Klein et Maxson ont déployé des énergies pour contourner les limites associées à l’utilisation des critères comportementaux en proposant une typologie fondée sur six critères structurels: taille, présence de sous-groupes, étendue de l’âge des membres, durée d’existence, défense d’un territoire et polymorphisme criminel. À l’aide de ces critères, les auteurs ont défini cinq groupes relativement communs: les gangs traditionnels, néo-traditionnels, compressés, collectifs et spécialisés.
Les gangs traditionnels existent généralement depuis plusieurs générations (souvent plus de vingt ans). Ils sont composés de plus d’une centaine de membres âgés de neuf à 30 ans qui se scindent ...