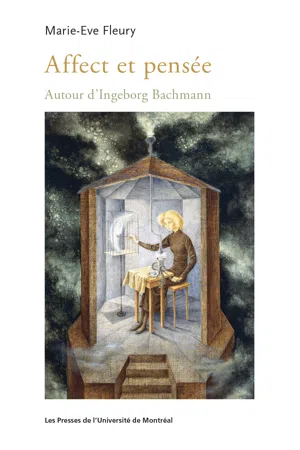![]()
CHAPITRE 1
Images de la souffrance
La recherche de l’équilibre est mauvaise parce qu’elle est imaginaire
Simone Weil
Le Bonheur serait l’affect pur, celui auquel ne se mêle aucune pensée. Ni la peur, ni l’angoisse, ni la souffrance, car celles-ci sont provoquées par le choc de la rencontre entre l’être humain et le monde, entre deux êtres humains, de la première énigme, du premier mur: aussitôt entre en jeu une conscience, malheureuse. «Pourquoi n’y a-t-il pas de mur du Bonheur ni de mur des Jubilations? Comment s’appelle le mur que je longe toutes les nuits?» Il n’existe et n’existera jamais qu’un mur des Lamentations. En fait le bonheur, en tant qu’affect, n’est pas plus pur que la peur. Tous les deux s’emparent de nous, nous font perdre pour un instant tous nos moyens, empêchent toute réflexion, submergent toute conscience, ne s’expriment qu’à travers les réactions physiques les plus violentes: larmes, cris, de douleur et de joie, tremblements, gestes brusques et forts, irréfléchis. Aucun, dans son immédiateté, n’est plus vrai ou plus faux que l’autre, ils sont tous deux brutalement réels; plus ou moins réels, plus vrais ou plus faux que la conscience qu’ils rendent muette un instant, c’est une différence qui ne peut pas être établie. Elle trahit la vérité de l’immédiat, la réalité du bonheur ou de la souffrance, la conscience qui vient interposer entre nous et la vigueur de nos sentiments sa médiation malhonnête, qui pose sur le visage de l’horreur et de la douleur un drap blanc conceptuel – sans que ce geste, en aucune manière, les fasse disparaître –, qui nous fait prendre ce maudit recul intellectuel qui rend tout faux et convenu, en comparaison de l’impression de vivacité et de réalité que laissent en nous les sensations les plus soudaines. Mais celles-ci, à leur tour, sont douteuses, même trompeuses; elles aussi peuvent n’être qu’apparences, que réactions émotives conditionnées par notre milieu, notre éducation. La conscience pourra en décortiquer la fausseté. Que nous reste-t-il, entre les mensonges du sentiment et ceux de la conscience, pour savoir ce qui est réel? Le mensonge par excellence, l’invention libre qui détruit, recrée, joue avec le réel, s’en moque, le grossit, le rapetisse jusqu’au seuil du néant et de l’abstraction: l’art. Le bonheur en est absent, lui qui est souvent l’affect-mensonge, l’affect-écran placé devant la souffrance, omniprésente, inévitable, pour ne pas la voir, pour ne pas reconnaître son existence. Il n’a plus alors la puissante véracité de l’affect, mais est, comme l’art, la construction imaginaire d’un esprit souffrant et, à la différence de l’art, le refus de toute pensée. Pourquoi lire, pourquoi écrire un livre? «Pour qu’il nous rende heureux…? Par Dieu, nous serions tout simplement aussi heureux si nous n’avions pas de livres.»
Ne se passerait-il pas [plutôt] la chose suivante: que le poème nous rende malheureux, parce que c’est ce à quoi il parvient et parce qu’il existe de nouveaux poètes qui sont à même de nous rendre malheureux? Qu’à cause de tout cela, le poème nous fasse faire intérieurement un bond, un bond dans la connaissance, sous l’impulsion duquel nous réexécutons celui qui a déjà lieu?
Le bonheur est stérile car il ferme les yeux, endort et aveugle, fait rêver et berce d’illusions; la souffrance donne naissance à la fois à l’œuvre d’art et à la pensée, pousse à la réflexion. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux! N’y a-t-il pas toujours un accent douloureux dans la voix de celui qui demande: pourquoi? S’il est possible de se mentir aussi bien sur son bonheur que sur sa souffrance, qui, toutefois, s’échafaudera un malheur, s’élaborera des tourments pour souffrir davantage? Même la tragédie, même le mélodrame sont plus supportables que la réalité, car ils prennent fin, ils sont faux, ils ne sont pas la vie vivante. La création artistique, aussi harassante et difficile soit-elle – car elle est une forme de souffrance que l’écrivain s’impose à lui-même, une lutte contre lui-même et contre le monde –, est généralement une tentative, sinon de masquer la souffrance, du moins de la contrôler, de la canaliser momentanément, de la comprendre un peu afin, peut-être, de l’alléger, mais de l’éliminer, jamais; de mieux la supporter, pour un instant. La littérature est une forme d’échappatoire en même temps qu’une forme de compréhension qui ne tolère aucune évasion ni aucune solution et l’écriture, pour l’écrivain malheureux, la tentative absurde et désespérée, la seule possible, d’être heureux. L’homme du sous-sol de Dostoïevski vit dans son sous-sol une vie retirée, dans sa tête hirsute une vie livresque, faite de phrases bien tournées et d’effets pour faire bien, mais un jour, la vie vivante, «par manque d’habitude», le terrasse presque au point de l’étouffer. Ce qu’il écrit alors, avec la plus dure honnêteté, racontant ces événements bouleversants, «ce n’est plus de la littérature, c’est une peine de redressement», car si «nous sommes tous d’accord, au fond de nous, que c’est mieux dans les livres», c’est seulement pour oublier «la véritable vie vivante» au point d’en perdre l’habitude, si bien que «de nous tous, c’est [lui], sans doute, qui ressor[t] le plus “vivant”» de son extrême abjection, de sa plongée volontaire et consciente au plus noir et au plus glauque du sous-sol, de lui-même. «Pour ce qui me concerne personnellement [dit-il], tout ce que j’ai fait c’est, dans ma vie, d’amener à la limite ce que, vous-mêmes, vous avez peur d’amener ne serait-ce qu’à la moitié, tout en prenant, en plus, votre lâcheté pour du bon sens – ce qui vous console, et qui vous berne.» Aucun soulagement dans ce genre de littérature qui tient moins de l’invention narrative que de la montée à l’échafaud, que de l’exposition sur la roue, les membres brisés, que de l’humiliation publique. Bien sûr il s’agit de l’invention de Dostoïevski, de la représentation de la mise à nu d’une âme, de la confession écrite d’un personnage, d’un livre, de littérature, mais d’une littérature qui n’a rien à voir avec l’oubli de la vie vivante, plutôt tout avec la vie pleinement vécue, rien avec le bonheur, tout avec la souffrance, rien avec l’évasion hors de la réalité, tout avec l’effort toujours vain mais toujours répété de l’atteindre, de la comprendre, de l’exprimer; et c’est précisément parce qu’il s’agit de littérature qu’il ne s’agit pas tant des mensonges de la réalité, de ces repères factices, de ces conventions et autres drogues spirituelles qui nous permettent de la traverser à peu près heureux et tout à fait inconscients, mais davantage d’atteindre le sous-sol, de creuser toujours plus loin sous la surface de cette vérité d’apparat à la recherche de la vérité, d’une vérité non vraie, moins fausse, plus fausse. Quand chanterons-nous l’Exultate Jubilate? À l’occasion, dans un moment d’oubli. Sinon jamais. Jamais. À une distance infiniment indéterminée dans le temps, au terme inenvisageable de l’épreuve. Et encore moins écrira-t-on un jour un livre qui soit comme le motet de Mozart. Avec la littérature, nous devons nous contenter de livres ayant pour titres «Genres de mort», «Les ténèbres d’Égypte», «Trois assassins», «Souvenirs de la maison des morts», Baudelaire et l’expérience du gouffre, Les révélations de la mort, De l’inconvénient d’être né, et j’en passe, ou d’œuvres inachevées, des lettres non terminées, des livres ouverts, jamais des fins heureuses ou dernières, car, à écrire sans arrêt sur le désespoir et la souffrance du monde, on finit par s’anéantir soi-même et par tout laisser en plan, suspendu, brouillon. Si parfois certains titres évoquent le bonheur ou une vie au moins neutre, ni trop torturante ni trop jouissive, comme La vie est un rêve, Le ciel de Bay City, Les yeux du bonheur, Va savoir, le contenu de ces livres n’est jamais heureux, puisque, chacun à leur façon, ils sont et mettent en scène une prise de conscience, ils sont et placent devant la pensée du lecteur des mystères, des murs, des gouffres insondables. Son livre sur le bonheur, son livre qui devra répandre partout et pour tous la joie, son livre qui aura pour titre Exultate Jubilate, la narratrice de Malina ne pourra jamais l’écrire; il sera finalement «un livre sur l’enfer» ou Les secrets de la princesse de Kagran, «la légende d’une femme qui n’a jamais existé» – et encore cette légende est-elle triste, ne connaît pas la fin heureuse des contes de fées: «elle tomba tout ensanglantée de son cheval et balbutia dans son délire en souriant: je le sais bien, je le sais!» Heureuse de sa souffrance; toujours accompagnent le savoir le cœur brisé et l’épreuve, rarement le contentement.
Car il n’y a pas une telle chose qu’un livre qui nous rende heureux, il n’existe pas, pour l’être humain, une telle chose que le pur bonheur. L’importune réflexion, quand elle entre en scène, c’est-à-dire quand, au contact du monde, nous constatons qu’il nous est fondamentalement incompréhensible, que, n’étant pas réductible à nous-mêmes, il ne nous est pas aussi familier, n’est pas aussi rassurant que notre propre intimité – à supposer que ce soient là les qualités de cette dernière, à supposer qu’il n’y ait pas aussi, en nous-mêmes, d’inquiétantes obscurités –, quand, provoquée par le mystère de l’autre, elle se met en branle et veut trouver, comme remède à ses angoisses et à son ignorance, des réponses à ses questions, elle ne manque pas d’apporter avec elle, en guise d’offrande empoisonnée à l’esprit qu’elle visite, la souffrance. Autant à son origine que durant son cheminement la pensée est liée à la douleur, d’où il résulte que tout savoir et toute vérité doivent naître et baigner dans la souffrance. Je n’exagère pas. Mais il faut comprendre la souffrance comme la cruauté d’Artaud, dirigée avant tout contre soi-même.
Cruauté n’est pas en effet synonyme de sang versé, de chair martyre, d’ennemi crucifié. […] La cruauté est avant tout lucide, c’est une sorte de direction rigide, la soumission à la nécessité. Pas de cruauté sans conscience, sans une sorte de conscience appliquée. C’est la conscience qui donne à l’exercice de tout acte de vie sa co...