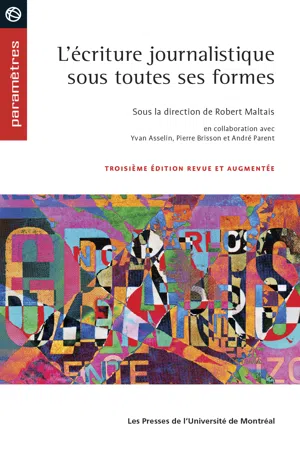![]()
Chapitre 1
L’art de raconter
ROBERT MALTAIS
Beaucoup de jeunes rêvent de faire du journalisme. La plupart du temps, leur vision est quelque peu naïve et idéalisée, tout comme l’était la mienne au même âge.
À l’âge de 10, 11 ans, il m’arrivait de jouer au reporter. Mais la réalité du journalisme a peu à voir avec les aventures d’un Tintin reporter, sorti tout droit d’une bande dessinée. Grand voyageur devant l’éternel, Tintin consacrait bien peu de temps, dans ses albums, à la prise de notes, à l’interview et à la rédaction de ses articles. Au fait, quand l’avons-nous vu écrire, ce cher Tintin?
Pourtant, dans la vraie vie, l’écriture compte pour beaucoup dans la production journalistique, sans égard au type de média pour lequel on travaille. Comparativement à la parole, l’écriture appelle une plus grande réflexion, un recul. Aussi l’écriture de presse se situe-t-elle au cœur du présent ouvrage.
Mais avant de se pencher sur l’écriture journalistique, pourquoi ne pas commencer par s’interroger sur cette étrange profession, diront certains observateurs extérieurs, qu’est le journalisme?
Qu’est-ce que ce métier qui rassemble à la fois en son sein intellectuels, gens de plume, de parole et de pouvoir? Ce métier, Voltaire le considérait comme le plus difficile du monde, parce qu’il écrit l’Histoire au quotidien.
LE RÔLE DE LA PRESSE
À ses débuts, le journalisme donnait passablement dans la presse d’opinion et d’approximation. En France, par exemple, la presse a longtemps été essentiellement polémiste. Ce n’est que progressivement qu’a émergé en Occident un journalisme d’information, conscientisé à l’importance de l’exactitude des faits et à la recherche, non seulement de la vérité, mais d’une certaine objectivité. Un concept qu’il faut cependant relativiser.
De façon assez unanime, les artisans de la presse se perçoivent comme les mandataires du grand public. Leur rôle consiste à témoigner de tout fait ou événement à caractère public, voire d’intérêt public, qu’il soit d’ordre social, politique, économique, culturel, environnemental ou sportif. Dans cet esprit, les journalistes sont les yeux et les oreilles du public. Un rôle qui n’est pas sans appeler une responsabilité sociale.
Le journalisme agit à la fois comme miroir social et moteur de changement de la société, par sa couverture événementielle, ses analyses de l’actualité et ses prises de position publiques dans une multitude de textes d’opinion diversifiés.
Les journalistes témoignent quotidiennement de la vie de la Cité. Leurs témoignages permettent aux citoyens de participer véritablement à la vie de la collectivité, grâce à des médias d’information agissant comme ciment de la communication sociale.
Sur le plan des valeurs, l’action de la presse joue un double rôle, tantôt comme lieu de renforcement de celles-ci, tantôt comme lieu de leur remise en question.
Ce sont des valeurs d’humanisme, d’égalité et de justice sociale qui donnent une légitimité à la pratique du journalisme. Il ne faut cependant pas faire preuve d’angélisme, car bien des périls guettent la pratique de ce métier. En particulier, le recours à un sensationnalisme desservant, au bout du compte, le bien commun.
On ne peut par ailleurs aborder la question de la liberté de presse sans parler de son corollaire, le droit du public à l’information. Quel est le fondement de la liberté de presse, sinon le droit du public à être informé? La presse ne saurait exister sans sa finalité, soit les citoyens et citoyennes à qui elle adresse le lot d’informations qu’elle produit.
Par voie de conséquence, la légitimité même de la presse repose sur le droit du public à l’information.
Au-delà de la noblesse des idéaux poursuivis par ce que nous appellerons la grande presse au service du public, la raison d’être d’une catégorie de médias a moins à voir avec des standards élevés de qualité qu’avec les exigences du tirage, de la cote d’écoute et de la rentabilité. Que penser, entre autres, de cette multitude de feuilles à potins qui polluent le paysage médiatique ou de chaînes radio et télé au sein desquelles divertissement, information et publicité font bon ménage au point de se confondre? Cette critique peut également s’étendre aux réseaux sociaux.
Pour certains médias, on l’aura compris, l’information n’est qu’une marchandise comme une autre, et comme dans toute logique de marché, elle se doit d’être rentable au même titre que tout autre bien commercial.
Cependant, pareille vision de l’information fait abstraction du fait que l’information n’est pas une marchandise ordinaire, mais possède une dimension publique indéniable. Elle doit être considérée comme un service public de premier plan, car la circulation de l’information contribue au maintien de la vie démocratique.
LE MÉTIER DE JOURNALISTE
Pour être apte à écrire, tout journaliste doit connaître, voire maîtriser, quelques notions de base qui, bien qu’élémentaires, n’en demeurent pas moins fondamentales dans la pratique du métier.
Il faut d’abord faire la distinction entre intérêt public et curiosité publique. L’intérêt public doit être à la base même de tout acte journalistique. S’il est difficile de définir l’intérêt public parce qu’il s’agit d’un concept en constante mouvance, on peut convenir qu’il s’étend à tout ce qui est nécessaire au citoyen pour qu’il participe pleinement à la vie en société.
La signification est la notion clé de l’intérêt public, le barème de mesure de l’importance sociale de la nouvelle, de son impact et de ses conséquences pour l’ensemble de la population.
À l’opposé, la notion de curiosité publique correspond à une forme de voyeurisme social qui a très peu à voir, en vérité, avec la notion de bien commun. Mais ne soyons pas naïfs ni aveugles. La presse jaune ou de caniveau prolifère sur la planète. Ce ne sont pas que des nouvelles qu’offrent ces canards à leur public, mais bien souvent des potins et des rumeurs non confirmés. Étonnamment, ces journaux et ces magazines réussissent à intéresser un grand nombre de lecteurs inconditionnels et font des affaires d’or.
Sur le terrain de l’événement, les journalistes, comme témoins sociaux, ne sont pas et ne peuvent pas être de simples courroies de transmission des acteurs de l’événement. Leur indépendance d’esprit, leur capacité d’observation et d’analyse, tout comme leur jugement, n’ont de cesse d’être interpellés. Ici, le verbe penser prend tout son sens.
Peut-on pratiquer le métier de journaliste sans une saine distance critique face aux acteurs des événements? La réponse est assurément non.
À quoi peut bien correspondre une distance critique raisonnable à une époque où on a enterré le concept de l’objectivité? À la conscience de notre subjectivité, c’est-à-dire de la dimension subjective découlant de notre propre vision du monde, de nos valeurs, de nos préjugés. Et à une indépendance vis-à-vis toute forme de pouvoir, de doctrine et d’idéologie.
Nous entrons ici de plain-pied dans le vaste domaine de l’éthique professionnelle. Le droit du public à une information de qualité apparaît alors comme le fondement de l’éthique journalistique. Au cœur de cette éthique, on retrouve quelques règles fondamentales auxquelles adhère tout journaliste digne de ce nom: rigueur et exactitude des faits, équilibre des points de vue, honnêteté intellectuelle et impartialité.
La connaissance et la maîtrise de la déontologie nécessitent, on l’admettra, beaucoup plus de nuances. Mais nous ne nous étendrons pas sur ce sujet, car tel n’est pas l’objet de ce livre. Contentons-nous de préciser qu’il existe d’importants guides déontologiques sur la pratique du journalisme au Québec auxquels on peut se référer en tout temps, notamment ceux de la Fédération professionnelle des journalistes et du Conseil de presse.
RACONTER EST UN ART
L’écriture journalistique possède son propre style, mais doit s’appuyer sur la connaissance et la maîtrise de la langue. D’une certaine manière, ce mode de rédaction transcende, dans les grandes lignes, les différents médias d’information, qu’il s’agisse de journaux, de magazines, de la radio, de la télévision ou du Web. Une interinfluence perpétuelle existe entre tous ces médias. Si la presse écrite a longtemps influencé le mode de rédaction des nouvelles à la radio et à la télé, l’inverse est également vrai. C’est maintenant au tour des médias sociaux d’influencer les médias traditionnels. Quoi qu’il en soit, tous les médias partagent un certain nombre de traits de personnalité communs.
Bien sûr, ces différents médias ont aussi leurs singularités, un mode d’expression qui les différencie, qui constitue leur spécificité. Mais ils puisent, à la base, dans un même bassin de références de style.
Or, le style de l’écriture journalistique est dénudé: «C’est son efficacité à véhiculer un message qui prime. Elle n’a de justification que par rapport à son public», comme l’écrit avec justesse l’auteur Jacques Mouriquand. On est donc loin de la littérature, au sens premier du terme.
Quels sont ces traits communs?
Le premier objectif que partagent les médias d’information: capter l’attention du public, voire le captiver, en lui racontant une histoire vraie. Figurez-vous que le conteur du Moyen Âge n’est pas mort! Il court toujours dans les médias du XXIe siècle.
À notre époque hautement technologique, la population est plus que jamais inondée d’informations diverses, de messages de toutes catégories, quand ce n’est pas de publicités qu’on lui assène tous les jours à travers une mer de messages, dans lesquels abondent les superlatifs.
Notre matériau est la langue. Nous ne sommes certes pas les seuls à jongler avec ce merveilleux outil de travail: nombre d’écrivains, de poètes, de publicitaires, de communicateurs et de simples citoyens l’utilisent eux aussi, chacun à leur manière. C’est dans ce contexte concurrentiel que la rédaction d’un texte journalistique devient un art. Un art difficile et subtil.
Le but de l’information à caractère journalistique diffère radicalement de celui de la publicité, de la propagande, du communiqué de presse, lesquels tendent à vendre tantôt un produit, tantôt une idéologie, tantôt un message orienté, tous teintés d’un haut degré de subjectivité.
À la recherche de la vérité la plus objective possible, l’information journalistique vise simplement et purement à informer le public de la vie de la collectivité humaine. De ses grandeurs et de ses misères. Or, pour être en mesure d’intéresser son public avec un contenu sérieux, il s’agit surtout d’éviter de le chloroformer avec une écriture austère, morne et sans vie.
Tout texte de presse vise d’abord à aller à l’essentiel. Pour distinguer les éléments essentiels des éléments accessoires, il existe une étape préalable: celle de la réflexion sur l’histoire à rédiger, sur son contenu. Cette étape présuppose un recul, un moment d’arrêt consistant à bien soupeser chacun des éléments d’information issus de notre collecte de données et qui tisseront le fil de notre histoire.
Nous sommes donc à l’étape de la réflexion où il est nécessaire de prendre un temps d’arrêt minimal pour se centrer sur son histoire.
Première question à se poser: Ai-je vraiment une nouvelle entre les mains, porteuse d’éléments d’actualité inédits et d’intérêt public? Seconde question: Si tel est le cas, de quoi s’agit-il au juste?
Ce sont ces questions que vous posera habituellement votre chef de pupitre, d’une manière moins formelle, dès que vous franchirez le seuil de la salle de rédaction au retour d’une affectation, en vous demandant plus simplement ce que vous ramenez de votre couverture. Pour répondre à cette question, vous devrez alors formuler en quelques mots l’essentiel de votre histoire. C’est une étape souvent salutaire, car vous êtes alors appelé à nommer sommairement, parfois même à découvrir, les éléments qui se situent au cœur de votre histoire.
Au retour de la couverture d’un événement, voici un autre moyen suggéré pour en faciliter la rédaction: essayez de résumer votre nouvelle en un seul paragraphe. En effet, le premier paragraphe de votre texte doit aller au cœur de l’affaire. Vous développerez ensuite vos idées par ordre d’importance décroissante.
En règle générale, toute nouvelle essaie de répondre aux ...