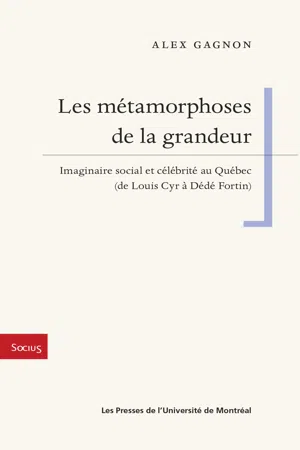![]()
QUATRIÈME PARTIE
Les yeux de Karla Homolka
![]()
Evil had not been visited upon the community, like an invasion by some alien force; it had walked and smiled and lived among them. It had said good morning at Tim Hortons and good evening at the Swiss Chalet. It had shared their parks and their pints of beer, and gone to sleep in a little pink house. Evil had become so normal that you would not or could not—and did not—recognize it.
Michael Posner, Chatelaine, février 1994
57, Bayview Drive
Le 29 juin 1991, près de St. Catharines en Ontario, le lac Gibson recrache les membres d’un cadavre découpé, encastrés dans des morceaux de ciment. C’est le corps de Leslie Mahaffy, une adolescente enlevée, séquestrée, violée et assassinée dans les semaines précédentes. En avril 1992, dans la même région, on retrouve en bordure d’une route le corps nu de Kristen French, victime des mêmes sévices. La communauté ontarienne est durement ébranlée. La presse sensationnalise l’affaire. Les autorités locales créent une escouade spéciale (Green Ribbon Task Force).
À l’hiver 1993, l’investigation connaît un dénouement inattendu. Sévèrement battue par son mari Paul Bernardo, une jeune inconnue, Karla Homolka, quitte son domicile (le 57 Bayview Drive, à Port Dalhousie) et porte plainte. Alarmée, lors d’un entretien avec la police, par la progression de l’enquête entourant l’homicide des deux adolescentes, elle se rend au cabinet d’un avocat, confesse son implication dans les crimes et entame des négociations de peine avec la Couronne. Elle accuse Paul Bernardo des meurtres et se présente elle-même comme une spectatrice et complice forcée; elle révèle l’existence de vidéocassettes compromettantes, le couple ayant filmé le supplice (mais pas les meurtres) des deux jeunes «esclaves sexuelles»; elle avoue enfin, du même souffle, le rôle qu’elle a joué dans la mort considérée jusque-là «accidentelle» de sa jeune sœur Tammy (droguée et violée par le couple, celle-ci mourait asphyxiée, étouffée par ses vomissures, le 23 décembre 1990, dans le sous-sol du domicile familial à St. Catharines). En vertu d’une entente officiellement conclue en mai 1993, Karla Homolka plaide coupable à deux chefs d’accusation d’homicide involontaire et s’engage à témoigner contre son mari. Le 6 juillet, à l’issue d’un bref procès, un juge la condamne à une peine de douze ans d’incarcération, qu’elle purgera à la prison des femmes de Kingston (entre 1993 et 1997), puis au Québec dans les établissements pénitentiaires de Joliette et de Sainte-Anne-des-Plaines. Le 4 juillet 2005, à l’expiration complète de sa peine, elle réintègre la société et s’installe dans la région de Montréal. Condamné, en 1995, à l’emprisonnement à perpétuité pour les meurtres des deux adolescentes, reconnu coupable des «viols de Scarborough», une série d’agressions brutales commises vers la fin des années 1980, Paul Bernardo a pour sa part été déclaré «délinquant dangereux». Il est toujours aujourd’hui derrière les barreaux, sa demande de libération conditionnelle ayant été refusée à l’automne 2018.
Dans les dernières décennies de l’histoire canadienne et québécoise, aucune affaire criminelle n’a connu un retentissement aussi profond et durable que celui généré par le «couple maudit», qui n’a jamais complètement cessé de susciter la stupeur et l’indignation de la population. Apparus dans les médias en 1993, le nom et le visage de Karla Homolka s’imposeront durablement à la conscience et à la perception de la collectivité, objets d’une attention médiatique continue et d’une haine parfois violente. Le phénomène, bien sûr, émerge d’abord au sein du Canada anglophone, où il se développe avec une intensité particulière. Mais le Québec n’est pas épargné par l’affaire ontarienne; à partir des années 2000, la région de Montréal en devient même l’épicentre géographique et médiatique. Comme l’indiquent les rituelles formulations superlatives, «la criminelle la plus célèbre du pays» a fortement marqué l’imaginaire social contemporain.
Autour de Karla Homolka, le foisonnement discursif est tel qu’il défie d’emblée toute volonté de saisie exhaustive. De fait, son ampleur est monstrueuse et son rayonnement, international. Les bases de données numériques en donnent un appréciable aperçu: entre 1993 et 2019, la presse écrite montréalaise et torontoise à elle seule a généré plusieurs milliers d’articles sur la criminelle, auxquels s’ajoutent d’innombrables bulletins télévisés et radiophoniques, en anglais comme en français. Les archives francophones de Radio-Canada, par exemple, recensent plus de 300 documents télévisuels contenant son nom. Mais la liste est encore longue. Les journaux et stations de radio ont été inondés de lettres et d’appels d’indignation. Députés, ministres et services gouvernementaux ont aussi reçu du courrier: comme le confirment notamment les archives du Solliciteur général du Canada, nombreux sont les citoyens ayant pris la plume pour manifester leur mécontentement aux élus. Amorcée sur les ondes et dans les pages des périodiques, la discussion collective s’est aussi déroulée sur internet, dont l’implantation progressive dans la vie quotidienne accompagne l’évolution de l’affaire depuis le début des années 1990: Karla Homolka a largement alimenté les forums de discussion, et on trouve encore aujourd’hui, sur Facebook, une page («Watching Karla Homolka») consacrée à son histoire et à la surveillance de ses mouvements. Les productions culturelles ne sont d’ailleurs pas en reste. Plusieurs séries télévisées américaines et britanniques se sont inspirées de la criminelle. Des artistes l’ont mise en musique, des fictions l’ont mise en scène, des œuvres d’art l’ont représentée et des caricaturistes l’ont dessinée. À cet amoncèlement substantiel s’ajoute la production documentaire: depuis 1994, une quinzaine d’ouvrages et de chapitres de livres – le plus souvent des reconstitutions narratives de l’affaire, issues de la veine prolifique des true crime books sur les causes célèbres et les tueurs en série –, une dizaine d’émissions télévisées relevant de l’infodivertissement et un film américain (Karla, 2006) ont porté sur les crimes du couple ou sur Homolka en particulier. Car c’est sur elle surtout que l’attention s’est le plus souvent focalisée. Bernardo, certes, est célèbre et détesté, mais son homologue féminin est l’objet d’une colère et d’une fascination inégalées.
L’insistance, voire l’obsession collective que révèle cet énorme assortiment de mots, d’images et d’œuvres exige une réflexion; il n’a pourtant jamais reçu les honneurs d’une étude englobante et complète. Pourquoi certaines affaires judiciaires échappent-elles à l’oubli ou au silence dans lequel périssent rapidement la majeure partie des événements qui ponctuent la vie d’une société? À quoi tient l’infâme notoriété acquise par Homolka dans la société contemporaine? Quels sont les étapes et les mécanismes de son devenir-célèbre, quels sont les ressorts sociohistoriques de ce retentissement, les facteurs ayant permis à sa figure de s’imposer dans la mémoire collective et l’imaginaire social? Seule une analyse de l’ensemble répertoriable de ses représentations multiformes dans l’espace public peut fournir une réponse à ces questions.
Quelques chercheurs m’ont précédé sur cette avenue. Contrairement aux figures publiques étudiées dans les trois parties précédentes, Karla Homolka et sa célébrité ont suscité quelques travaux savants, qui proviennent exclusivement du monde anglophone. Ceux-ci empruntent des perspectives variées et souvent éloignées de ma démarche. Plusieurs d’entre eux portent sur Homolka elle-même (comme individu de chair et d’os), sur les aspects judiciaires de l’affaire, sur la violence et l’agentivité féminines et sur les rapports problématiques entre Homolka et le féminisme. D’autres abordent des questions similaires à celles qui seront ici examinées. Dans un ouvrage publié en 1994, Frank Davey a exploré la couverture journalistique des crimes et du procès d’Homolka: malgré plusieurs intuitions fécondes, la portée et la pertinence de son analyse apparaissent aujourd’hui limitées, la parution du livre étant antérieure à l’essentiel de l’affaire, qui ne connaîtra ses sommets médiatiques qu’entre 1995 et 2005.
L’excellent ouvrage que les criminologues Jennifer Kilty et Sylvie Frigon lui ont consacré en 2016 remédie partiellement à ces lacunes. À partir d’une étude approfondie de sa couverture dans les grands quotidiens du Canada anglais, les deux auteures ont cherché à comprendre «why we as a culture remain so incredibly fascinated by Karla Homolka». Leur réflexion a le mérite de mettre en lumière une pluralité d’éléments fondamentaux – je les reprendrai aux moments opportuns –, mais l’élucidation systématique du phénomène exige aussi une approche complémentaire et l’exploration de corpus jusqu’ici négligés: d’une part, leur étude porte presque exclusivement sur la matière textuelle de la presse, laissant de côté non seulement l’aspect graphique des journaux (dessins, photos, caricatures, etc.), mais aussi la dimension rhétorique et formelle des discours; d’autre part, elle n’examine que les journaux, excluant les médias télévisuels, la totalité des productions culturelles, les pratiques sociales et les autres sphères du discours (forums virtuels, correspondance, etc.); son champ de vision, enfin, se limite à l’univers anglophone. Les écrits sur Karla Homolka n’ont en fait jamais interrogé le volet spécifiquement québécois de l’affaire; elle a pourtant eu une vie dans l’espace francophone.
L’étude qui suit emprunte la voie ouverte par ces travaux tout en suivant ses propres sentiers. Elle vise, non pas à comprendre une personne, mais à restituer une figure publique et son évolution diachronique: ce qu’elle entend saisir, ce n’est pas Karla Homolka ni les crimes dont elle est accusée (on ne se prononcera pas ici sur leur nature ni sur l’être de la criminelle), mais la totalité des signes (lisibles, visible et audibles), pluriels et pourtant remarquablement cohérents, qui les font exister dans l’espace public des sociétés canadienne et québécoise. Comment, pourquoi la «célèbre meurtrière», comme on l’appelle encore dans les années 2000 et 2010, s’impose-t-elle aussi fortement dans les représentations collectives, où elle devient vite une incarnation féminine de la monstruosité? C’est la naissance et l’histoire de cette figure dans l’imaginaire, suivies dans leurs nombreuses ramifications socioculturelles, que les chapitres qui suivent s’efforcent de retracer.