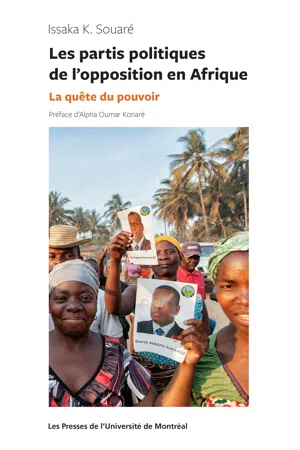![]()
Conclusion
La démocratie est devenue le discours rassembleur censé rapprocher les systèmes politiques et promouvoir la coexistence pacifique dans un monde autrefois divisé par les querelles idéologiques de la Guerre froide. Malheureusement, le triomphe de la démocratie est davantage une apparence qu’une réalité. S’il est vrai que la démocratie semble en passe d’être universalisée, cela est généralement dû au fait qu’elle a été banalisée au point qu’elle ne constitue plus la moindre menace pour les élites politiques de par le monde, qui peuvent dorénavant prétendre embrasser la démocratie et profiter de la légitimité qu’elle leur confère sans se soucier des exigences sans se soucier des exigences de sa pratique réelle.
Claude Ake, The Feasibility of Democracy in Africa, 2000, p. 7 (notre traduction de l’anglais).
Malgré la réintroduction du multipartisme sur le continent au début des années 1990 et nonobstant la nature relativement compétitive des élections présidentielles dans plusieurs pays africains, les victoires de candidats présentés par les partis de l’opposition ne sont pas encore à la hauteur de leurs propres attentes ni à celle du nombre élevé d’alternances pacifiques au pouvoir sur le continent. Comparativement à des régions similaires en matière de démocratie, notamment l’Amérique latine et l’Europe de l’Est, la fréquence des alternances politiques au sommet de l’État en faveur de l’opposition est très modeste sur le continent africain. Mais puisque certains partis d’opposition ont bien réussi à conquérir le pouvoir exécutif suprême, il fallait problématiser ce constat pour pouvoir expliquer la réussite de ces partis d’opposition et l’échec des autres.
À l’issue de cette étude, nous avons notamment trouvé que l’alternance partisane s’effectue généralement lorsque le système politique est bipartisan ou quand des partis d’opposition d’importance forcent sa bipolarisation en formant une coalition électorale cohérente. Ces deux hypothèses et leurs différents aspects (coalitions formées essentiellement de partis politiques et coalitions à base sociorégionale ou communautaire) sont des conditions presque incontournables. Nous avons trouvé très peu de déviation à cette règle parmi les 31 cas de victoire de l’opposition partisane en Afrique depuis 1990.
Le bipartisme facilite l’alternance, car ce système de partis signifie que deux partis principaux dominent dans le pays et ont plus ou moins le même poids politique. Cette donne facilite l’alternance dans la mesure où les électeurs voulant un changement de régime ont généralement une alternative crédible et bien identifiée, sauf en cas de considérations idéologiques irréconciliables. Cela est différent de la situation dans un système marqué par la prolifération de petits partis politiques. Ce premier facteur relève du cadre institutionnel d’un système politique et dépend de certains processus sociopolitiques et historiques dans les pays concernés.
La bipolarisation peut être un substitut au bipartisme comme condition nécessaire pour effectuer l’alternance entre deux partis politiques. C’est une action qui émane évidemment des stratégies et des calculs des acteurs politiques. Elle constitue d’ailleurs un moyen de contourner le cadre institutionnel de fragmentation des partis d’opposition. Il n’est peut-être pas exagéré d’affirmer ici que l’échec des partis d’opposition à conquérir le pouvoir exécutif dans bon nombre de pays africains ayant un système multipartite polarisé est, dans une grande mesure, dû à leur échec d’adopter cette stratégie.
Les stratégies des partis au pouvoir
Les stratégies des acteurs politiques ne se limitent pas à celles qui visent la conquête du pouvoir, ce qui limiterait l’analyse aux partis d’opposition. Or ces derniers sont en compétition avec les partis au pouvoir, qui adoptent leurs propres stratégies pour s’y maintenir. Nous avons reconnu ici le rôle des tactiques déloyales que peuvent employer certains partis au pouvoir pour empêcher toute victoire de l’opposition. Ces tactiques peuvent être utilisées dans le domaine de la réglementation institutionnelle de l’environnement politique, imposant des choix qui rendent la vie difficile aux partis d’opposition. Elles peuvent aussi relever d’un usage biaisé et partisan des forces de sécurité et d’autres structures de l’État afin d’empêcher l’opposition d’agir. En effet, il faut un minimum de fair-play pour que les stratégies propres à l’opposition puissent opérer sur le terrain de la compétition politique avec le parti au pouvoir.
Or il s’avère que la «fraude électorale» est l’une des stratégies auxquelles les partis au pouvoir sont réputés avoir recours dans les pays en voie de démocratisation, dont ceux du continent africain. La fraude prend des formes multiples et est employée à diverses étapes du jeu électoral. S’il est vrai que les partis au pouvoir ne sont pas les seuls à y avoir recours, ce sont eux qui l’emploient le plus et qui disposent le plus souvent des moyens nécessaires pour en tirer le maximum de profits. Elle a donc un impact certain sur les stratégies des partis politiques qui en sont victimes. Nous avons donc examiné à la loupe ce genre de pratiques.
La cooptation – au sens péjoratif – des membres de l’opposition par le régime au pouvoir est un exemple de ce type de pratiques. Elle est considérée par certains, comme Schadler (2002), comme une stratégie de corruption de l’opposition. Or, si le regard est porté uniquement sur l’acte de «cooptation», ou que le parti au pouvoir a employé des moyens autres que matériels (comme la promesse d’un poste gouvernemental) ou si ses moyens matériels ont été obtenus de façon normale, cet acte peut être considéré comme une simple stratégie électorale.
Même d’un point de vue purement normatif, si un leader de l’opposition se laisse corrompre par le parti au pouvoir alors qu’il sait pertinemment que cela compromettra les chances de l’opposition de conquérir le pouvoir et que cet acte de cooptation réussit néanmoins à le faire changer de position, on peut dire qu’un tel leader n’a pas d’idéaux à défendre. Il n’a pas de leçon de morale à donner, et l’on ne doit pas se soucier de son sort au nom du principe de moralisation du jeu politique. De toute évidence, cette personne ne cherche qu’à empocher quelques milliers de dollars ou se trouver un poste gouvernemental. Ceux qui, au nom du principe de moralisation du jeu politique en Afrique, voudraient reprocher aux partis au pouvoir d’avoir coopté l’opposition devraient d’ailleurs, au nom du même principe, les remercier d’avoir démasqué ces chefs corrompus ou disposés à l’être avant qu’ils ne parviennent au pouvoir suprême, avec tous les moyens et les possibilités d’enrichissement frauduleux que ce poste pourrait leur offrir.
De toute façon, dans une étude essentiellement analytique, la nature orthodoxe ou non de la stratégie employée par les acteurs politiques importe peu. Ce qui compte, c’est de noter que ces stratégies jouent un rôle prépondérant dans la réalisation de l’alternance par les partis d’opposition ou le maintien du statu quo par les régimes au pouvoir.
Les stratégies des partis d’opposition
Nonobstant les actes déloyaux de certains partis au pouvoir, nous avons trouvé que tous les «malheurs» de l’opposition ne peuvent pas être mis sur le dos de ces partis. L’opposition, à plusieurs égards, a sa part, voire une grande part des responsabilités. Le plus souvent, elle est éparpillée alors qu’elle sait pertinemment que seule la coopération pourrait l’avantager. Elle est financièrement trop dépendante et parfois minée par des querelles d’ego et de personnalités inutiles qui occasionnent des sentiments d’hostilité et de la compétition malsaine entre ses différents membres. Parce qu’elle ne s’active souvent que lors des élections, l’opposition a tendance à se focaliser sur des questions symboliques ou secondaires plutôt que de s’intéresser aux questions essentielles ou de régler ses querelles à l’avance et à distance des enjeux électoraux.
Nous avons donc montré les avantages de la formation de coalitions par les partis politiques de l’opposition et émis un avis négatif quant à l’efficacité à court terme du boycottage des élections comme stratégie électorale, notamment lorsqu’il a pour conséquence de faire sauter certaines étapes cruciales du processus électoral, comme le recensement des électeurs. Le boycottage peut cependant s’avérer bénéfique à long terme, selon l’usage qui en est fait et le rapport des forces en présence.
Nous avons trouvé que les manifestations de rue, qu’on peut assimiler à une version active du boycottage, peuvent contribuer à des réformes politiques à court terme. Mais poussées à l’extrême ou lorsque les acteurs politiques de l’opposition les ayant suscitées perdent le contrôle sur leurs militants, ou alors quand des bandits les infiltrent pour poser des gestes incivils ou criminels, ces manifestations peuvent être dommageables pour l’opposition. Elles sont donc une arme à double tranchant.
L’accroissement de la transparence
et de la crédibilité des élections
Un certain nombre de mesures peuvent accroître le degré de transparence et de cré...