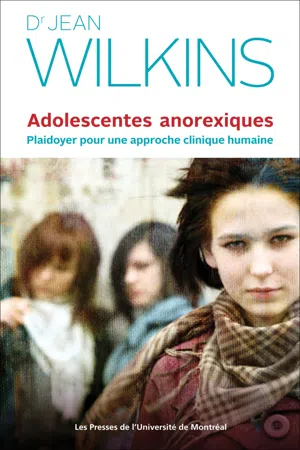![]()
Chapitre 1
Pédiatre en médecine de l’adolescence
L’anorexie mentale a été longtemps une maladie incomprise, mystérieuse et clandestine. Il aura fallu la publication de nombreux témoignages poignants de jeunes filles anorexiques et la médiatisation d’événements dramatiques tels que le suicide de Solenn Poivre d’Arvor, fille d’un célèbre journaliste français, pour que la maladie sorte de l’ombre.
En tant que pédiatre spécialisé en médecine de l’adolescence, je côtoie les pathologies de l’adolescence depuis trente-six ans et l’anorexie mentale depuis les années 1980. Ma pratique médicale auprès de milliers de jeunes filles qui se sont infligé des restrictions sévères de l’appétit m’a amené à considérer cette maladie comme essentiellement l’expression d’une impasse sur le plan identitaire, comme un dysfonctionnement du développement global à l’adolescence. L’anorexie mentale est une pathologie puissante et dévastatrice : la patiente renvoie dos à dos parents et intervenants de la santé, refuse tous les plans d’action et se sert du sentiment d’impuissance qu’éprouve son entourage face à elle pour entretenir sa dépendance à la maladie. Comprendre que la maladie est un refuge identitaire et accepter le fait que l’adolescente échappe à tous les protocoles rigides, chaque cas posant un défi, sont absolument essentiels pour tous ceux qui travaillent et interviennent auprès d’elle.
Qui est la jeune fille anorexique ? Comment le contexte social et familial favorise-t-il l’apparition de la maladie ? Quand et comment hospitaliser ces adolescentes en plein développement pubertaire, physique, psychique et identitaire ? Comment à la fois répondre à leur besoin inconscient de régression et les aider à construire leur personnalité et à habiter leur corps en pleine transformation ? Comment les aider à sortir de la spirale du contrôle ? Autant de questions que je me suis posées au cours de ma pratique hospitalière au centre hospitalier universitaire (CHU) de Sainte-Justine à Montréal et auxquelles j’apporte ici quelques éléments de réponse fondés sur mon expérience de clinicien de l’ado- lescence.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, un bref retour en arrière s’impose. Devient-on un pédiatre spécialisé en médecine de l’adolescence par hasard ?
Deux frères jumeaux
« C’est un garçon madame ! Et, surprise, il n’arrive pas tout seul!» Voilà probablement les premières paroles que j’ai entendues en arrivant au monde. Jacques, mon frère jumeau – un vrai, parfaitement identique –, serait né vingt minutes après moi, un 20 juin. Nous appartenons à la génération née avant l’avènement de l’échographie fœtale, mes parents n’ont su qu’à la naissance que nous étions deux. Une grande surprise, nous a-t-on raconté. Petits, fragiles et précieux – c’est ainsi que l’on nous décrivait –, nous avons été baptisés le jour même de notre naissance, c’était plus prudent.
Nos parents ont toujours pris soin de ne pas nous confondre. Je portais, dit-on, un ruban bleu au poignet qui permettait de me reconnaître. Consciemment ou inconsciemment, ils voulaient protéger notre individualité. Bien que systématiquement confondus par les autres – et d’ailleurs encore aujourd’hui –, mon frère et moi n’avons souffert d’aucun problème d’identité. Cette situation particulière liée à ma naissance a-t-elle pu influer sur ma décision de me consacrer aux jeunes filles à l’allure si fragile ? Le problème identitaire des anorexiques m’a-t-il interpellé au point de vouloir lui consacrer ma vie professionnelle ? Probablement que ma carrière de pédiatre n’est pas le fruit du hasard.
Ayant grandi dans une famille élargie comprenant père et mère, grands-parents maternels, tantes et oncles maternels, mon frère et moi, de même qu’une sœur aînée et un frère cadet, nous avons bénéficié d’un climat familial chaleureux et sécurisant. C’était tout le contraire de l’isolement que connaissent les nombreuses familles que je rencontre aujourd’hui dans ma pratique quotidienne. Ces parents ont un énorme besoin de soutien et de réconfort, pendant la maladie de leur fille ou, parfois, de leurs deux filles, car la maladie frappe deux membres de la même famille dans certains cas.
Naissance d’une vocation
J’ai fait mes études primaires au Jardin de l’enfance à Valleyfield, près de Montréal. Pour me rendre à l’école, je passais devant l’hôpital de ma ville et parfois je m’arrêtais devant une ambulance qui arrivait en trombe, gyrophares allumés et sirène en marche. J’étais impressionné. Le travail de ceux et celles qui prenaient en charge les malades me fascinait. Très tôt, j’ai su que, un jour, je serais médecin. Les études seraient longues et chères, mais, peu importait, nos parents nous disaient qu’ils étaient prêts à hypothéquer notre maison pour payer nos études.
Au collège, je n’étais pas un premier de classe; par contre j’avais de très bonnes notes en mathématiques, si bien que mon plan était tout tracé: si j’échouais en médecine, je m’orienterais vers l’actuariat. J’ai finalement présenté ma demande d’admission en médecine, qui com- portait entre autres épreuves une entrevue individuelle redoutée de tous. À juste titre. Je me souviens très bien du déroulement de l’entretien. À la question : « Depuis quand pensez-vous à la médecine ? » j’ai répondu : « Depuis toujours ! » « Et si vous n’êtes pas accepté ? » « Je n’ai jamais pensé que vous me refuseriez!» Aïe, c’était une gaffe, je ne voulais pas être arrogant, je recourais juste à l’humour dans un moment de grand stress. Quelques semaines après, on m’a informé que j’étais accepté. Et là, je savais que ça allait être difficile.
Cela a été difficile, en effet. Accumuler les heures de travail, assimiler des tas de connaissances, subir le stress des examens et de la compétition, ce n’est pas une sinécure. Pour devenir médecin, il faut être motivé. De plus, les dirigeants de la faculté avaient eu la brillante idée de placer les examens après le congé des fêtes, de sorte que nous avons dû passer nos vacances à étudier. Un mauvais souvenir. Plus tard, je contribuerai à apporter des changements profonds au programme des études médicales en tant que professeur à la faculté. Heureusement, j’ai noué durant cette période difficile des amitiés durables.
Mes débuts comme pédiatre
Une fois médecin, j’étais fier de mon parcours, je voyais enfin à quoi servait tout ce que nous avions appris et découvrais l’art de la pratique médicale. Intégrer les connaissances et les mettre en pratique de manière originale et créative, voilà ce à quoi je me suis appliqué durant toute ma carrière.
Dans mon milieu familial, je faisais partie de la première génération qui accédait aux études universitaires qu’elle pouvait choisir. Une fois admis en médecine, j’ai tout de suite su que je voulais me spécialiser en pédiatrie et m’installer dans ma petite ville natale qui m’avait si bien nourri dans tous les sens du terme. Je voulais rendre à ma communauté ce qu’elle m’avait donné. Le sort en a décidé autrement. C’est à Sainte-Justine à Montréal que j’ai commencé ma carrière et fait les trois premières années de spécialisation en pédiatrie. De très nombreuses heures de travail, des semaines interminables, des cas difficiles, mais c’était merveilleux d’apprendre le métier et d’exercer une profession aussi gratifiante. J’étais heureux.
Alors qu’il avait été jusque-là réservé prioritairement aux enfants, l’hôpital Sainte-Justine s’est mis à accueillir des enfants de plus en plus grands, puis des adolescents ayant des besoins précis et des problèmes tout à fait différents de ceux de la petite enfance. Devant l’afflux de nouvelles catégories de malades, le directeur du service de pédiatrie, le Dr Luc Chicoine, qui avait décelé chez moi une aptitude particulière pour le travail auprès des adolescents, m’a chargé de m’occuper de ces derniers dans mes heures de garde à l’urgence. La plupart du temps, je les soignais pour des intoxications aux drogues. C’est ainsi que j’ai découvert la toxicomanie, une problématique nouvelle pour nous les pédiatres, un territoire inconnu que nous devions explorer et définir. Je m’y suis totalement investi.
La médecine de l’adolescence
Envisageant de créer une unité de soins en médecine de l’adolescence à Sainte-Justine, le Dr Chicoine me proposa d’aller suivre une formation en médecine de l’adolescence qui se donnait alors seulement aux États-Unis. J’ai accepté sans hésiter et j’ai passé une année de formation post- doctorale au Montefiore Hospital and Medical Center, affilié au Albert Einstein Institute of Medicine à New York, de juillet 1973 à juin 1974, un programme très renommé à l’époque.
Ma formation a été très riche. Parmi tout ce que j’ai appris, ce qui m’a le plus servi concerne ma pratique médicale : j’ai compris durant mon année de spécialisation que je devrais toujours rester fidèle à moi-même et exercer mon métier à ma manière, en respectant mes convictions. Cet enseignement était d’autant plus précieux que j’avais conscience qu’une tâche gigantesque m’attendait à Montréal : mettre sur pied une unité de soins.
Bien que jeune et mal définie à l’époque, la médecine de l’adolescence m’a tout de suite passionné, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, je conserve d’excellents souvenirs de ma propre adolescence qui a été pour moi une période très créative et constructive. La confiance et la force que j’ai puisées dans ces années fondatrices expliquent certainement ma détermination et mon engagement dans la pratique médicale. Le désir d’aider chacun à vivre son adolescence, l’âge de tous les espoirs, cette époque privilégiée où l’avenir paraît totalement ouvert, m’a toujours habité.
De plus, la médecine de l’adolescence est une spécialité riche et originale, car elle n’est liée ni à un organe tel que le cœur (cardiologie) ou les poumons (pneumologie), ni à un système comme le système psychique (psychiatrie). Elle concerne une période clé de la vie, une période de croissance intense et de transformations de toutes sortes.
Axée sur la compréhension du développement complexe qui a lieu entre douze et dix-huit ans et qu’on appelle la puberté, la médecine de l’adolescence est depuis peu une spécialité reconnue comme telle au Canada. Après trente-six années de pratique dans le milieu pédiatrique et universitaire de Sainte-Justine, le Collège des médecins du Québec m’a décerné un diplôme en médecine de l’adolescence en août 2011. C’est donc en fin de carrière que je suis finalement reconnu comme expert en médecine de l’adolescence ; j’aurai été patient, tout comme mes patientes anorexiques m’ont appris à l’être.
![]()
Chapitre 2
L’apparition de l’anorexie en médecine de l’adolescence
La médecine de l’adolescence se développe à la fin des années 1960 aux États-Unis, au milieu des années 1970 au Québec et au début des années 1980 en Europe. Avant l’établissement d’une section en médecine de l’adolescence en 1974, rien n’était vraiment prévu pour les adolescents à l’hôpital Sainte-Justine, la plus grande structure pédiatrique francophone d’Amérique du Nord. Un vieux manoir situé à côté du bâtiment principal de l’hôpital avait été aménagé en 1973 pour accueillir et soigner les jeunes en état d’intoxication lié à l’« usage non médical de drogues », selon l’expression en usage. Cette unité pour adolescents installée hors des murs de l’hôpital témoigne de l’attitude ambivalente que manifestait l’administration à l’égard de cette catégorie de patients. De toute évidence, les adolescents n’étaient pas les bienvenus aux urgences principales.
À mon retour de New York en 1974, j’ai eu la chance de pouvoir ouvrir au sein du département de pédiatrie de l’hôpital Sainte-Justine et de la faculté de médecine de l’Université de Montréal la toute première section franco-phone de médecine de l’adolescence en milieu hospitalo-universitaire. J’ai supprimé la structure médicale du manoir et ai commencé à accueillir les adolescents dans l’hôpital même. Un bouleversement. Non seulement ces nouveaux patients entraient légitimement à l’hôpital, mais de plus ils étaient intégrés dans un environnement hospitalo-universitaire où la clinique, l’enseignement et la recherche s’entre-croisent sans cesse. C’était pour moi un privilège et une occasion à ne pas laisser passer. C’était aussi un défi de taille, car tout était à faire : accueillir, observer et traiter les patients en un temps record, les besoins et les demandes des adolescents changeant en effet très vite. C’est dans ce contexte d’urgence qu’avec une équipe restreinte d’intervenants, ô combien dévoués et motivés, mon aventure commence.
La génération yéyé
Afin d’expliquer comment et pourquoi la médecine de l’adolescence a surgi subitement dans le monde médical au cours des années 1970, prenant au dépourvu tous les professionnels de la santé, il faut rappeler le contexte sociologique de l’époque.
Tout d’abord, les adolescents n’ont jamais été aussi nombreux au Québec que dans ces années-là, le groupe des 10-20 ans dépassant en nombre le groupe des 0-10 ans. Cette démographie unique dans notre histoire a été en partie prévue sur le plan scolaire – il a fallu bâtir de nouvelles écoles secondaires pour les accueillir –, mais aucunement sur le plan de la santé.
Sur le plan social, tout vacille. À la guerre du Vietnam qui domine l’actualité internationale s’ajoutent les événements de Mai 68 en France, la libération sexuelle, les mouvements de contestation sociale et les grèves dans la fonction publique au Québec. L’arrivée au pouvoir du Parti Québécois en 1976, un parti séparatiste, va contribuer à créer dans la société une effervescence sans précédent, plus importante que celle qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale, au dire des historiens. Cependant, c’est la vague des séparations et des divorces qui aura, selon moi, les répercussions les plus profondes sur la santé mentale des adolescents. Les jeunes gens de cette génération font face à la contestation collective de leurs propres parents ; comment s’opposer à ces derniers, comment se distinguer d’adultes qui mènent leur propre révolution sociale et personnelle ?
Dans ce contexte en ébullition arrive donc en force une foule de jeunes en proie à de nouvelles difficultés. Des difficultés d’autant plus grandes que ces adolescents en pleine croissance et en train de forger leur propre identité agissent avec le degré de maturité correspondant à leur âge. Il est alors inévitable que surgissent des problèmes tels que la toxicomanie, qui est depuis devenue le fléau que l’on sait.
Le cannabis et ses dérivés sont les premières drogues douces qui aient été fournies en abondance sur le marché. Au cannabis s’est ajouté le LSD, très apprécié pour ses effets stimulants sur la création. (Les jeunes Américains qui reviennent assez abîmés de la guerre du Vietnam en consomment volontiers.) On voit alors défiler à l’urgence de Sainte-Justine des cas de bad trip, c’est-à-dire des réactions de toxicité aiguë due à de mauvais dosages.
La drogue accompagnait au début un mouvement de contestation qui s’inscrivait dans l’ère du temps, mais elle est devenue très rapidement un article de consommation récupéré par le monde interlope. D’adeptes, les adolescents deviennent victimes; les prix grimpent, les substances perdent de leur pureté, des mélanges de toutes sortes ainsi que de nouvelles molécules apparaissent et les effets néfastes s’accentuent : le décrochage scolaire s’étend, les troubles du comportement et les actes délinquants se multiplient. Devant cette vague de fond, notre équipe de soignants qui n’avait eu jusque-là affaire qu’à des consommateurs de drogues douces, doit se mobiliser et répondre aux besoins nouveaux et complexes des adolescents adeptes des drogues dures.
Les drogues dures
La morphine, une drogue dure utilisée par injection, est la plus consommée par les jeunes que nous recevons. Ils arrivent à l’urgence dans le coma, en arrêt respiratoire ou bien pleinement conscients. Souvent, dans un moment de lucidité, ils nous demandent de les aider à se sevrer. Même s’il s’agit parfois seulement de belles paroles – les adolescents vivent des difficultés sur les plans familial, scolaire ou juridique et veulent montrer qu’ils ont pris une sage décision –, nous faisons tout pour répondre favorablement à leur demande : nous les hospitalisons pendant une semaine, leur prescrivons au besoin des anxiolytiques, puis les suivons en clinique externe. Ces patients sont fidèles à leurs rendez-vous médicaux et tissent avec nous des liens thérapeutiques solides qui leur sont salutaires.
Notre plan thérapeutique convient à la presque totalité des adolescents. Malgré leur état de manque, ils arrivent à se conformer sans grande résistance à nos règles et à nos exigences. Du côté de l’administration, notre approche thérapeutique ne suscite aucune critique ; bien qu’en pleine détresse, les adolescents sont respectueux, polis et ne causent aucun dommage matériel dans l’hôpital. Les autorités sont rassurées.
Cette expérience auprès des toxicomanes m’a beaucoup apporté. Elle m’a permis de prendre conscience qu’ils affrontaient des problèmes complexes pour leur âge, qu’ils étaient sincères malgré l’échec des sevrages et que nous, les médecins, nous sentions trop souvent impuissants face à eux. Ce dernier point est particulièrement déroutant, car, en dépit de tous nos efforts, les décès par surdose surviennent en grand nombre et sont impossibles à prévenir. Selon moi, ces adolescents, parce qu’ils n’ont aucune prise sur la société, sont victimes de son évolution. À travers la toxicomanie, ils expriment un état de détresse amplifié par les effets des transformations psychiques et physiques qui s’opèrent à leur âge.
Marianne est une jeune fille que j’ai soignée à trois ou quatre reprises alors qu’elle se trouvait dans le coma. Pour payer ses doses de drogue, elle commettait des vols armée d’un faux fusil parce qu’elle voulait éviter de tirer sur quelqu’un. Elle a ainsi commis plus d’une trentaine de vols. Quelques années après, elle a été arrêtée et incarcérée dans une prison pour femmes et, du fait de sa beauté juvénile et de son immaturité, elle est rapidement devenue la proie sexuelle des autres détenues. Alors qu’elle avait dépassé l’âge de l’adolescence et disposait d’un avocat, elle a continué à me demander de plaider en sa faveur et voulait que je l’aide à obtenir un transfert vers une prison moins rude. Voilà le genre d’adolescents qui fréquentent notre hôpital ; des jeunes gens marginaux qui attendent un soutien constant.
La sexualité
Comme nous avons côtoyé des adolescents toxicomanes qui ont commencé à avoir une vie sexuelle active plus tôt que les autres, nous pouvions savoir quels étaient les problèmes de sexualité des jeunes à l’époque où la demande de soins liée à la libération sexuelle des années 1970 et 1980 a décuplé. De nouveau, nous avons dû nous ajuster à cette nouvelle réalité clinique: observer, comprendre et agir vite. D’abord prendre conscience que l’âge de la première re...